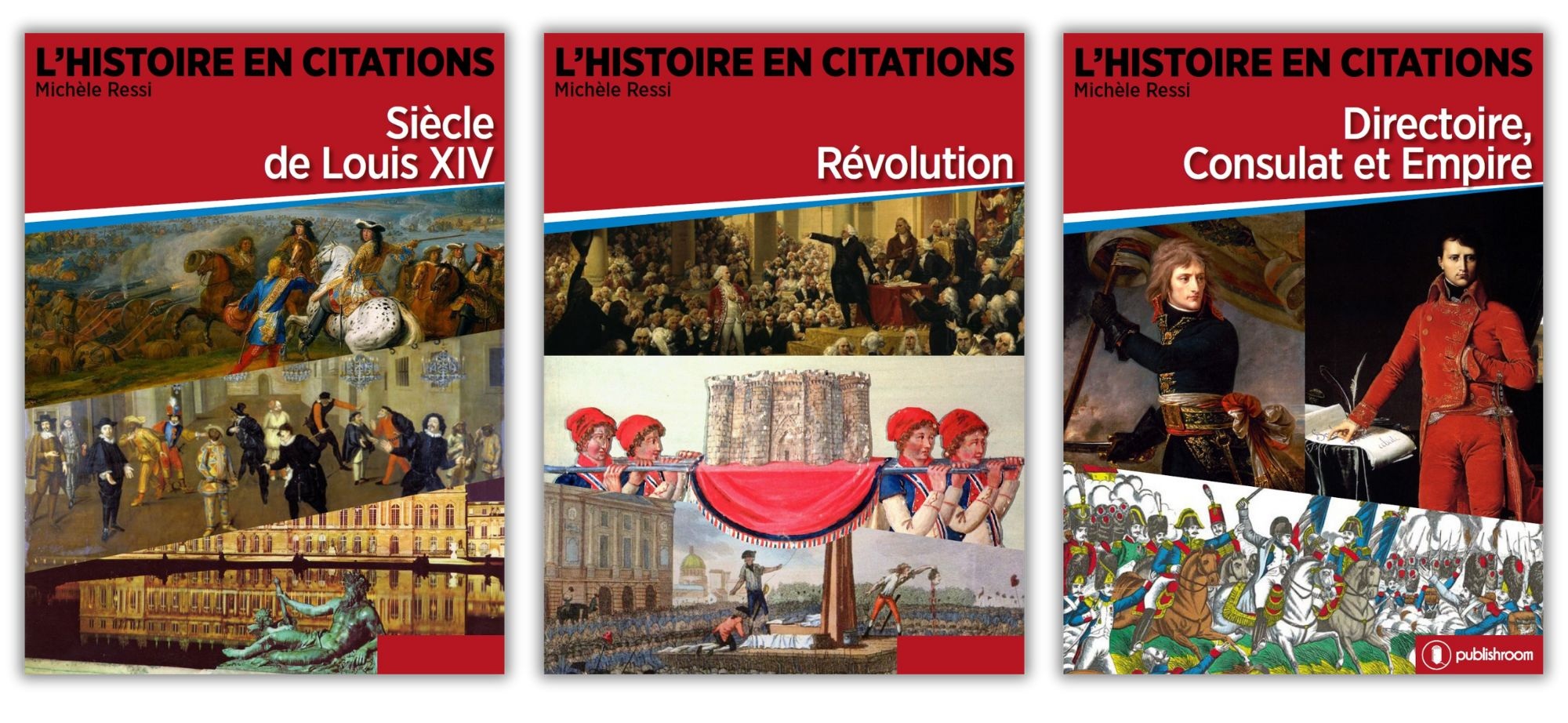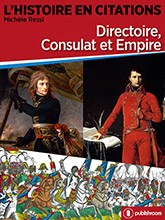 Second mariage de Napoléon, pour raison d’État. Il fait d’une pierre deux coups, en choisissant l’alliance avec l’Autriche (ennemie). Au final, un mauvais calcul.
Second mariage de Napoléon, pour raison d’État. Il fait d’une pierre deux coups, en choisissant l’alliance avec l’Autriche (ennemie). Au final, un mauvais calcul.
On ne peut pas jouer gagnant à tous les coups, l’empereur l’a compris trop tard.
À feuilleter pour tout savoir.
« Je me donne des ancêtres. » 1844
(1769-1821), château de Compiègne, 27 mars 1810
Metternich (1965), Henry Vallotton.
« Ivre d’impatience, ivre de félicité » , il apprend la valse (viennoise) et attend sa future femme, Marie-Louise : archiduchesse d’Autriche, descendante de l’empereur Charles Quint et petite-nièce de Marie-Antoinette. Napoléon, de petite noblesse corse (d’origine génoise), évoque volontiers « ma malheureuse tante Marie-Antoinette » et « mon pauvre oncle Louis XVI » . Cette union flatte son orgueil.
Il s’est décidé en février, dans une hâte qui a fort embarrassé l’ambassadeur d’Autriche à Paris (Schwarzenberg, successeur de Metternich à ce poste) : même pas le temps de prévenir l’empereur d’Autriche, Napoléon a déjà annoncé sa décision aux Français ! Mais personne ne peut rien refuser à Napoléon, même pas sa fille.
« L’Autriche fit au Minotaure le sacrifice d’une belle génisse. » Charles-Joseph de Ligne commente le mariage impérial, en authentique et vieux prince autrichien, avec des références mythologiques familières au monde de son temps. Mais qui pense à l’humiliation du père de la mariée, François Ier d’Autriche, empereur romain germanique ? Le mariage de Marie-Louise et de Napoléon a lieu le 1er avril 1810.
« C’est un ventre que j’épouse. » 1846
NAPOLÉON Ier (1769-1821). Le Fils de l’empereur (1962), André Castelot
Napoléon confirme la référence à la « belle génisse » sacrifiée par l’Autriche et assume le rôle du Minotaure prédateur, sans y mettre les formes. Il manifeste tant de hâte qu’on parle d’un enlèvement, plus que d’un mariage. La cérémonie religieuse a lieu le 2 avril 1810. Marie-Louise a 18 ans, il vit une lune de miel de trois semaines qui le comble et sa seconde femme lui donnera un fils, le 20 mars 1811 : le roi de Rome.
« Mon mariage m’a perdu, l’Autriche était devenue ma famille, j’ai posé le pied sur un abîme recouvert de fleurs. » 1847
NAPOLÉON Ier (1769-1821). Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’empereur Napoléon III (1858)
En 1810, François Ier, empereur d’Autriche, lui a donné sa fille pour sceller la paix, au lendemain de ses défaites. Trois ans après, conseillé par Metternich, il se joindra aux alliés de l’Europe contre son gendre : sixième et dernière coalition, qui amène la chute de l’Empire.
L’empereur déchu confie à Montholon, compagnon de son dernier exil : « Un fils de Joséphine m’eût rendu heureux et eût assuré le règne de ma dynastie. Les Français l’auraient aimé bien autrement que le roi de Rome. » Il est même possible qu’Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine qu’il a adopté, ait fait l’affaire. Dans la famille, c’est l’un des plus dévoués à l’empereur, excellent soldat jusque dans la débâcle en Russie, prince d’une extrême élégance, qui se révélera bon mari et bon père. Mais l’on ne réécrit pas l’histoire.