Anonymat (du grec ἀνώνυμος / anṓnumos, « qui n’a pas reçu de nom, anonyme » ), qualité de ce qui est sans nom (ou sans renommée).
« En France et sous nos rois, la chanson fut longtemps la seule opposition possible ; on définissait le gouvernement d’alors comme une monarchie absolue tempérée par des chansons. » 815
FÉNELON (1651-1715), Dialogues des morts (1692-1696)
L’histoire de France par les chansons existe bel et bien. Souvent anonyme, la chanson fut l’une des rares formes d’opposition possible et de surcroît très populaire, sous l’Ancien Régime. À l’heure de la Révolution, c’est la voix du peuple qui s’exprime sur tous les tons, le joyeux « Ça ira » devenant un appel au meurtre des « aristocrates à la lanterne » sous la Terreur. Les réseaux sociaux n’ont rien inventé…
D’autres formes d’expression non signées existent. Les pamphlets sont souvent cruels, voire injurieux : quelque 6 500 mazarinades contre Mazarin Premier ministre haï, avant les poissonnades visant la Pompadour (maîtresse de Louis XV), née Jeanne Poisson. Les épigrammes raillent à plaisir et avec esprit, comme les épitaphes après la mort de leur victime. L’une des plus célèbres est quand même attribuée à Rousseau, écrite sur la tombe de Voltaire. Autres moyens d’opposition populaire : pancartes et affiches, cris du peuple associés aux manifestations, « basses Lumières » qui sapent les bases du régime aussi sûrement que les pensées philosophiques au XVIIIe siècle, cahiers de doléances à la veille de la Révolution… jusqu’aux slogans de Mai 68 encore et toujours cités. Tout fait Histoire !
Cas particuliers, des textes célèbres sont nés anonymes, à commencer par La Chanson de Roland au Moyen Âge. Le Discours de la méthode (1637) et les Lettres persanes (1721) n’ont été revendiqués par l’auteur qu’après publication et grand succès : Descartes et Montesquieu. On n’est jamais trop prudent, avec la censure royale.
Des auteurs se dissimulent sous l’anonymat d’un pseudonyme. Henri Beyle en avait une centaine, dont le plus connu, Stendhal signant Le Rouge et le noir (1830) et La Chartreuse de Parme (1839). Autres cas, les femmes écrivant sous un nom d’homme : George Sand ne se cache pas vraiment, contrairement aux quatre sœurs Brontë, dont Charlotte devenue Currer Bell pour signer un best-seller mondial, Jane Eyre (1847). Quelques cas extrêmes sont quasi-pathologiques – intéressants, mais anecdotiques.
À la fin du XXe siècle, l’anonymat total est de règle dans l’art urbain ou Street-art né aux États-Unis : acte de vandalisme ou expression contemporaine originale ? Banksy, star anonyme, s’expose au musée, se vend aux enchères. D’autres artistes restent masqués pour des raisons politiques ou personnelles. C’est un phénomène aussi ancien que l’expression humaine. Faut-il contrôler ou censurer ? C’est un vrai problème de société. Quelques-uns s’en amusent : « La célébrité n’est pas facile à assumer, je ne vois rien de pire, si peut-être, l’anonymat. » Guy Bedos.
Reste le problème de l’anonymat dans les réseaux sociaux. « Nouveaux réseaux, vieux débat. L’ordre contre la liberté ? Le piège est là. » À vous de juger.
MOYEN ÂGE
« La Chanson de Roland […] est le plus ancien monument de notre nationalité […] Ce n’est pas seulement la poésie française qu’on voit naître avec ce poème. C’est la France elle-même. » 95
Louis PETIT de julleville (1841-1900), l’un des traducteurs de la Chanson de Roland (anonyme)
C’est dire l’importance de ce premier grand texte en langue française, chanson de geste de la fin du XIe siècle.
Il existe neuf manuscrits de ce poème épique : le manuscrit d’Oxford du début du XIIe siècle est le plus complet et le plus ancien, en anglo-normand. Identifié en 1835, considéré par les historiens comme le texte faisant autorité, c’est lui que l’on désigne quand on parle sans autre précision de la Chanson de Roland : 4 002 vers, transmis et diffusés en chant par les troubadours et jongleurs, et célèbre bien au-delà de la France. La composition est parfois attribuée à un certain Turold, mentionné dans le dernier vers : « Ci falt la geste que Turoldus declinet. » Mais c’est peut-être le nom d’un troubadour.
La composition est parfois attribuée à un certain Turold, mentionné dans le dernier vers : « Ci falt la geste que Turoldus declinet. » Mais c’est peut-être le nom d’un troubadour.
L’escarmouche entre les Vascons (Basques) et l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne va donner naissance, trois siècles et demi plus tard, à la première chanson de geste en (vieux) français, poème épique de quelque 4 000 vers, maintes fois traduits, et célèbre bien au-delà de la France.
Passage héroïque, celui où le preux Roland refuse de sonner du cor, ce que lui conseille le sage Olivier, préférant se battre et risquer la mort, plutôt que d’alerter Charlemagne et de trouver le déshonneur. « Olivier dit : « Les païens viennent en force, / Et nos Français, il me semble qu’ils sont bien peu. / Roland, mon compagnon, sonnez donc votre cor : / Charles l’entendra et l’armée reviendra. » / Roland répond : « Ce serait une folie ! / En douce France j’en perdrais ma gloire. / Aussitôt, de Durendal, je frapperai de grands coups ; / Sa lame en saignera jusqu’à la garde d’or. / Les païens félons ont eu tort de venir aux cols : / Je vous le jure, tous sont condamnés à mort. » »
Mais Roland va périr avec son compagnon, et toute l’arrière-garde des Francs. Charlemagne le vengera en battant les païens (Sarrasins) avec l’aide de Dieu ; et le traître Gamelon, beau-frère de Charlemagne et beau-père de Roland, qui a organisé le guet-apens par jalousie, sera jugé, condamné à mort et supplicié.
« Après la panse vient la danse. » 138
Dicton populaire. Dictionnaire de l’Académie française (1694), au mot « panse »
On mange, on boit, on s’amuse bien au Moyen Âge, au château comme au village, hors les temps de famine, de peste, de guerre.
Plus clairement que de longs commentaires, ce dicton infirme la version d’un Moyen Âge sombre et triste, en opposition avec la Renaissance qui va suivre, au « beau XVIe » siècle, lui-même opposé à la terrible période des Guerres de Religion.
« En ces temps, étaient les loups si affamés qu’ils entraient de nuit dans les bonnes villes et passaient souvent la rivière de Seine et aux cimetières qui étaient aux champs, aussitôt qu’on avait enterré les corps, ils venaient la nuit et les déterraient et mangeaient. » 330
Journal d’un bourgeois de Paris (chronique anonyme des années 1405 à 1449)
Œuvre anonyme écrite par un Parisien.
C’est la Guerre de Cent ans. Hiver 1421-1422. La misère n’est pas égale dans tout le royaume. La « France anglaise » demeure la plus pauvre, avec la Normandie occupée par les garnisons, écrasée par les impôts, et les campagnes bordelaises qui se remettent lentement des récentes dévastations.
« À toute personne qu’ils [les écorcheurs] rencontraient, ils demandaient : Qui vive ? Si on était de leur parti, on était simplement dépouillé de tout ; si on était du parti adverse, on était volé et tué. » 352
Journal d’un bourgeois de Paris (chronique anonyme des années 1405 à 1449)
Année 1440. La paix d’Arras laisse « sans emploi » les bandes de mercenaires bourguignons. Voici revenu le temps des Grandes Compagnies et des routiers.
RENAISSANCE ET GUERRES DE RELIGION
« Quand ce dur printemps je vois
Je connais toute malheureté au monde
Je ne vois que toute erreur et horreur
Courir ainsi que fait l’onde. » 557Chanson du Printemps retourné (vers 1586). Anonyme
La chanson reprend le poème célèbre de Ronsard : « Quand ce beau printemps je vois… »
Et elle détourne les vers. C’en est fini de ce temps (qui n’était déjà pas si calme). La Ligue (ultra-catholique) sème le vent et va récolter la tempête, cependant que la littérature s’apitoie sur la France à nouveau déchirée.
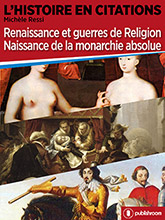 NAISSANCE DE LA MONARCHIE ABSOLUE
NAISSANCE DE LA MONARCHIE ABSOLUE
« Vive Henri IV
Vive ce roi vaillant !
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de se battre
Et d’être un Vert Galant ! » 605Vive Henri IV, chanson anonyme. Chansons populaires du pays de France (1903), Jean-Baptiste Weckerlin
Ce premier couplet est contemporain du roi.
Au fil des siècles, d’autres s’ajoutent, à mesure qu’Henri IV devient l’un des mythes de l’histoire de France. Au XVIIIe siècle, le culte du bon roi Henri atteint son apogée. La Partie de chasse d’Henri IV (1774), pièce de Charles Collé qui reprend la chanson, triomphera après les foudres de la censure – la comparaison se fait fatalement au désavantage de Louis XV qui n’est plus le Bien-Aimé, en fin de règne.
Quant au caractère public des amours royales, il dépasse la médiatisation qu’en fait aujourd’hui la presse people. Que ce soit pour applaudir ou médire, pour dire la vérité ou répandre la rumeur, les chansons et les pamphlets (souvent anonymes) sont les premiers médias populaires.
L’amour des femmes est quand même le point faible du roi, qui mettra en danger la paix du royaume pour littéralement courir après sa dernière maîtresse, Charlotte Marguerite de Montmorency : elle a 15 ans, et lui 56.
« Voici le preux Henry, le monarque françois,
À qui Mars a cédé tout l’honneur de la guerre,
Rien n’importe qu’ici tu n’entendes sa voix
Quand le bruit de ses faits remplit toute la terre. » 609Quatrain sous une gravure d’Henri IV (1599). « The Politics of Promiscuity : Masculinity and Heroic Representation at the Court of Henry IV » , Katherine B. Crawford, French Historical Studies (printemps 2003)
Même si cela relève de son « génie propre » et de sa raison d’être, l’anonymat n’est pas toujours critique !
Le roi est souvent représenté comme un chevalier de la Renaissance, galopant, épée pointée sur l’ennemi. On le voit aussi en imperator romain couronné de lauriers, quand ce n’est pas en Hercule gaulois ou en Atlas portant la Terre. Ces images apologétiques ne sont pas toujours signées.
« Tu fais le catholique
Mais c’est pour nous piper
Et comme un hypocrite
Tâche à nous attraper,
Puis, sous bonne mine,
Nous mettre en ruine. » 626Pamphlet ligueur (anonyme). La Satire en France ou la littérature militante au XVIe siècle (1886), Charles Félix Lenient
Ni la conversion ni le sacre ne peuvent rallier les catholiques irréductibles (baptisés parfois papistes) : la vingtaine de tentatives d’assassinat qui marqueront tout le règne d’Henri IV le prouvent assez.
« Hérétique point ne seras
De fait ni de consentement.
Tous tes péchés confesseras
Au Saint Père dévotement […]
En ce faisant te garderas
Du couteau de frère Clément. » 635Les Commandements d’Henri (1597). Petites ignorances historiques et littéraires (1888), Charles Rozan
Les prétendus commandements sont au nombre de dix, dans ce pamphlet papiste en forme de parodie. Rappelons que frère Clément fut l’assassin d’Henri III.
La conversion d’Henri IV semble suspecte aux ultra-catholiques, plus chrétiens que le pape qui finit par lui accorder son absolution (septembre 1595), incitant Mayenne (gouverneur de Bourgogne) et la maison de Lorraine à faire la paix avec le roi. Le maréchal de Joyeuse (gouverneur du Languedoc) et le duc d’Épernon (gouverneur de Provence) ont suivi, obtenant leur grâce et se soumettant, moyennant finances ou avantages personnels. Henri IV sait pardonner – en bon politique plus encore qu’en bon chrétien. Mais les Espagnols, partis de Paris, n’ont pas quitté le royaume et restent une menace toujours présente.
« Sire, ne soyez point courtois
À ces rebelles Rochellois
Point de pardon : il faut tout pendre !
Vous m’avez donné la maison
D’un parpaillot. S’il faut la rendre,
Je serai sot comme un oison. » 700Les Rochellois, chanson anonyme. Annales (1830), Société académique de Nantes et du département de la Loire inférieure
Malgré la tradition qui en fait un droit, le pillage est interdit, d’où les murmures des vainqueurs désabusés, entrant dans la ville, le 1er novembre 1628.
Après quinze mois de siège, les trois quarts des habitants ont péri (22 500 morts) et l’on n’ose pas fêter cette amère victoire des Français contre des Français. Fortifications rasées, franchises municipales supprimées : la ville ne s’en remettra pas de longtemps.
« Ce fou n’a qu’une idée, abattre la maison d’Autriche […] Il déclenchera la guerre générale et les hordes de barbares se jetteront sur le trottoir français. » 705
Pamphlet contre Richelieu. Mazarin (1972), Paul Guth
En cette année 1630, que d’opposants à la politique anti-habsbourgeoise de Richelieu ! Le très catholique cardinal de Bérulle est mort (octobre 1629), mais il reste le garde des Sceaux Michel de Marillac (farouchement antiprotestant et prônant la paix et l’alliance avec l’Espagne), le frère du roi qui est de tous les complots, la reine et la reine mère, à présent très hostile au cardinal et âme du parti dévot.
Richelieu, de son côté, paie des publicistes à gages pour mener une propagande anti-espagnole incessante, d’où une guérilla de libelles et de pamphlets. À dater de mai 1631, La Gazette, hebdomadaire de Théophraste Renaudot, organe officieux du gouvernement, a pour but de réduire les « faux bruits qui servent souvent d’allumettes aux mouvements et séditions intestines » . Elle use de son monopole officiel pour diffuser les nouvelles et faire passer les articles transmis par le roi et Richelieu : tirage moyen de 1 200 exemplaires, qui deviendront 12 000 au siècle suivant. Organe officiel du ministre des Affaires étrangères sous le nom de
« Je pense, donc je suis. » 722
René DESCARTES (1596-1650), Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la dioptrique, les météores et la géométrie, qui sont des essais de cette méthode (1637)
Texte philosophique publié anonymement par Descartes à Leyde le 8 juin 1637. Ce discours marque une rupture avec la tradition scolastique, jugée trop « spéculative » . Événement majeur dépassant le cadre de la littérature pour devenir fait de société. Le titre est à lui seul une citation et tout un programme. La formule lapidaire, restée célèbre, va déclencher, avec quelques autres, des polémiques qui finiront par la mise à l’Index des œuvres de Descartes, après sa mort.
Philosophe, mathématicien et physicien, l’auteur s’est prudemment réfugié dans la proche, protestante et bourgeoise Hollande, pour poursuivre son œuvre. La condamnation de Galilée par le Saint-Office n’est pas si lointaine (1633). Coupable d’avoir affirmé, contre la Bible, que la Terre tourne autour du Soleil, et non l’inverse, l’astronome italien aurait dit : « Et pourtant, elle tourne ! »
Descartes a d’autres audaces, et la première est simple : il faut vérifier par le raisonnement toutes les idées ou vérités reçues. C’est cela, l’essentiel de sa méthode. Mais c’est une rupture avec tout ce qui est enseigné dans les universités. Le cartésianisme aura des vertus déstabilisantes et des conséquences scientifiques que l’auteur ne soupçonnait pas !
« Quand les Français prendront Arras,
Les souris mangeront les chats. » 727Message en deux octosyllabes, affiché par les Espagnols sur une des portes de la ville d’Arras, printemps 1640. Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France : depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe (1837), J. Michaud, J. J. F. Poujoulat
L’humour du peuple espagnol s’affiche contre l’ennemi français. L’Artois (chef-lieu Arras), province réunie à la couronne sous Philippe Auguste, passa aux ducs de Bourgogne, puis aux Habsbourg d’Espagne, par héritage.
Le siège d’Arras par les Français est un épisode de la guerre de Trente Ans qui déchire l’Allemagne, de 1618 à 1648. Richelieu intervient dans ce conflit, entrant en « guerre ouverte » contre l’Espagne (alliée de l’Allemagne) en 1635. Il faut éviter l’encerclement de la France par les possessions des Habsbourg. Les premières batailles sont des défaites. Mais l’armée réorganisée, la flotte reconstituée, le concours assuré d’un des meilleurs généraux du temps, Bernard de Saxe-Weimar (mort trop tôt, en 1639), vont permettre aux Français de regagner du terrain.
« Quand les Français rendront Arras
Les souris mangeront les chats. » 728Écrit sur une des portes de la ville d’Arras que les Français ont prise, le 9 août 1640. Le Magasin pittoresque (1839), Édouard Charton
On a seulement enlevé le « p » , ce qui change tout. Les Français répondent sur le même ton, mais l’humour fait rarement référence aux animaux, alors qu’ils sont très présents – les chevaux indispensables à la guerre, les animaux de la ferme dans une France agricole à 90%.
Cette victoire et quelques autres mènent à un renversement des forces en Europe, au bénéfice de la France et au détriment de l’Empire d’Allemagne et de l’Espagne, donc de la puissante maison d’Autriche (les Habsbourg).
 SIÈCLE DE LOUIS XIV
SIÈCLE DE LOUIS XIV
« Notre France est ruinée,
Faut de ce Cardinal
Abréger les années,
Il est auteur du mal. » 751La Chasse donnée à Mazarin, chanson populaire anonyme. Bulletin de la Société de l’histoire de France (1835), Renouard éd
Le cardinal Mazarin succédant au cardinal de Richelieu est également détesté, en raison de la crise des subsistances et de la lourdeur des impôts nécessaires pour financer la guerre. Le peuple taillable et corvéable à merci chante : « Pour payer les subsides / J’ai vendu mon godet / Ma poêle, ma marmite / Jusques à mon soufflet / Moi, pour payer les tailles / J’ai vendu mes moutons / Je couche sur la paille / Je n’ai pas le teston [monnaie royale] / Moi, j’ai chose certaine / Vendu un gros pourceau / Mes chèvres et mes gélines / Pour payer les impôts. »
« Grand Cardinal, que la fortune
Qui t’élève en un si haut rang,
Ne te fasse oublier ton sang,
Et que tu es de la commune. » 758Avertissement des enfarinés. La Vieille Fronde, 1648 (1832), Henri Martin
Le peuple déteste cet Italien de petite extraction qui, au terme d’une irrésistible ascension, possède un si grand pouvoir, en quelque sorte volé à la régente, puis au jeune roi devenu majeur.
Mazarin accumule une immense fortune. À sa mort, il fait don à l’État de ses collections et de sa bibliothèque personnelle : la Mazarine, première bibliothèque ouverte au public dès 1643, bâtie dans l’aile gauche du palais de l’Institut, édifié à ses frais.
« Je voudrais bien étrangler
Notre pute de Reine !
Ô gué, notre pute de Reine. » 761Mazarin, ce bougeron, mazarinade. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
L’attaque directe contre la vie privée est une constante à l’époque : la règle de cet art pamphlétaire et chansonnier est de ne rien respecter ; et les reines pas plus que les rois n’ont de « vie privée » , au sens moderne du mot. Attaqué aussi, et même en premier, le cardinal détesté : « Mazarin, ce bougeron / Dit qu’il n’aime pas les cons / C’est un scélérat / C’est un bougre ingrat… »
« Je plains le sort de la Reine ;
Son rang la contraint en tout ;
La pauvre femme ose à peine
Remuer quand on la f… » 762Le Frondeur compatissant, mazarinade. Nouveau siècle de Louis XIV, ou poésies-anecdotes du règne et de la cour de ce prince (1793), F. Buisson
Dès la mort de Louis XIII dont les chansons célébrèrent les insuffisances conjugales, voilà que l’on soupçonne les relations d’Anne d’Autriche avec « Mazarin ce bougeron » . Michelet rapporte, dans son Histoire de France : « Mazarin commença dès lors l’éducation de la reine, enfermé toutes les soirées avec elle pour lui apprendre les affaires. La cour, la ville ne jasaient d’autre chose. »
On jasa beaucoup, on supposa tout, y compris un mariage secret. Anne d’Autriche nia toujours, assurant même que Mazarin « n’aimait pas les femmes » , mais laissa gouverner le cardinal, mieux qu’elle n’avait jadis laissé régner son royal époux.
« Point de paix, point de Mazarin ! Il faut aller à Saint-Germain quérir notre bon Roi ; il faut jeter dans la rivière tous les mazarins. » 781
Cris du peuple de Paris assiégé, début mars 1649. Mémoires du Cardinal de Retz (posthume, 1717)
Des pourparlers de paix s’engagent entre la cour (à Saint-Germain) et le Parlement de Paris.
Mais il y a des opposants irréductibles, une part du peuple se soulève, neutralise les échevins et les magistrats fidèles au roi (les « mazarins » ). Cependant que les Grands deviennent le « piètre état-major d’une révolution incertaine » (Georges Duby). On retrouve le duc de Beaufort (le roi des Halles refaisant le coup de la Cabale des Importants), l’inévitable de Retz (porté par son ambition politique et bientôt perdu par ses propres subtilités), le prince de Conti – « un zéro qui ne multipliait que parce qu’il était prince du sang » , selon de Retz – et la belle duchesse de Longueville (frère et sœur du Grand Condé qui se bat dans le camp du roi). Et tout ce beau monde se querelle ou s’aime, intrigue, hésite, fanfaronne, enchaîne les volte-face et s’étonne de tant d’audace.
Les nouvelles des révolutionnaires de Cromwell vont terrifier les plus rebelles : ils ont osé exécuter le roi Charles Ier d’Angleterre !
Le président du Parlement de Paris, Molé, signe alors la paix de Rueil, le 11 mars 1649 : au prix de concessions mutuelles, c’est la fin (provisoire) de la Fronde parlementaire.
« Faut sonner le tocsin, din-din
Pour pendre Mazarin. » 793La Chasse donnée à Mazarin, chanson. Bulletin de la Société de l’histoire de France (1835), Renouard éd
« Prendre » est devenu « pendre » ! Le Parlement de Paris, qui l’a banni en janvier 1649, met sa tête à prix en décembre 1651 : 50 000 écus, payables par la vente de sa bibliothèque et ses collections (471 tableaux de maître référencés à sa mort). Mazarin, confondant parfois ses affaires et celles de l’État, a déjà accumulé une immense fortune.
Le cardinal a de nouveau pris la fuite avec la reine, et rejoint le jeune roi à Poitiers. Le Parlement envoie des émissaires dans les provinces, tente de les soulever contre Mazarin, mais nul ne bouge.
Turenne, à la tête de l’armée royale, bat Condé qui a recruté de son côté une armée espagnole.
Condé se réfugie dans Paris (avril 1652), ses partisans y font régner la terreur. La Grande Mademoiselle (fille du Grand Monsieur, Gaston d’Orléans) se lance dans la Fronde à cœur perdu.
« Tel qui disait : « Faut qu’on l’assomme ! »
Dit à présent : « Qu’il est bon homme ! »
Tel qui disait : « Le Mascarin !
Le Mazarin ! Le Nazarin ! »
Avec un ton de révérence
Dit désormais : « Son Éminence ! » » 795Pamphlet pour Mazarin (1652). Histoire de la Bibliothèque Mazarine depuis sa fondation jusqu’à nos jours (1860), Alfred Franklin
Juste retour des choses. La France est à bout de souffle et Paris se lasse de tant d’excès, après la journée des Pailles et le massacre qui s’ensuit. Les bourgeois deviennent hostiles à Condé, qui fuit à son tour aux Pays-Bas espagnols – la Belgique actuelle.
Cependant que les marchands de Paris et les officiers de la garde bourgeoise rappellent le jeune roi qui rentre – définitivement cette fois, et triomphalement ! Le 21 octobre 1652, Louis XIV s’installe au Louvre.
Et Mazarin, rappelé par le roi et la reine mère, rentre à son tour. L’opinion s’est complètement retournée.
« Fils de roi ; père de roi ; jamais roi ! » 864
Horoscope anonyme de Louis de France. Le Siècle de Louis XIV (1751), Voltaire
On fredonna une chanson sue ce thème : « Fils de roi, père de roi / mais jamais roi lui-même » .
Le Grand Dauphin (Monseigneur) naît le 1er novembre 1661. Fils aîné de Louis XIV, il sera père de Philippe V roi d’Espagne, mais meurt de la petite vérole à 50 ans, avant d’avoir pu accéder au trône.
Il n’est pas certain qu’il l’ait ardemment désiré, vu son caractère un peu mou et son éducation un peu rude. Il reporta toute la fierté de son sang royal sur son deuxième fils, le duc d’Anjou (les deux autres moururent jeunes), revendiquant l’héritage de la couronne d’Espagne, sur laquelle sa mère Marie-Thérèse d’Autriche (infante espagnole) lui a donné des droits.
Les astrologues étaient régulièrement consultés en ces époques où superstition, sorcellerie et magie faisaient partie de la vie quotidienne – le Grand Siècle est en cela plus proche de la Renaissance que des Lumières. Mais de nos jours, la classe politique reste une clientèle fidèle des devins, encore très sollicités.
« Colbert avait un grand-père
Qui n’était pas si savant
Ni si riche que son père
Ni si dur aux pauvres gens. » 881Colbert avait un grand-père, chanson anonyme. Fouquet, surintendant général des finances, d’après les documents d’archives et les mémoires (1908), Albert Savine, François Bournand
Choisir un bourgeois pour ministre est une initiative royale mal acceptée des Grands. Mais le peuple lui-même se méfie : la fortune rapide de Colbert devient suspecte. Autre raison de son impopularité : les impôts accrus ou créés, indirects et particulièrement injustes, causant des émeutes fiscales. 1675 sera l’année de la révolte du papier timbré – notamment en Bretagne.
« Ci-gît l’auteur de tous impôts
Dont à présent la France abonde.
Ne priez point pour son repos
Puisqu’il l’ôtait à tout le monde. » 892Épitaphe (anonyme) de Colbert, 1683. Dictionnaire de la mort (1967), Robert Sabatier
Les ministres des Finances sont souvent impopulaires et Colbert, par sa rigueur, le fut tout particulièrement.
La Mort de Colbert est le titre d’une chanson connue, en cette fin d’année 1683 : « Caron étant sur le rivage, / Voyant Colbert, dit aussitôt : / Ne vient-il pas mettre un impôt / Sur mon pauvre passage. » (Dans la mythologie, Caron avec sa barque permet aux âmes d’accéder au royaume des morts, mais il exige un péage, pour franchir le fleuve Styx.)
Les impôts accrus ou créés, indirects et particulièrement injustes au siècle de Louis XIV, ont causé des émeutes fiscales, comme en 1675 : révolte du papier timbré, notamment en Bretagne. Autre raison d’impopularité : la fortune rapide de ce fils de bourgeois anobli, mal vu par les Grands, et suspect au peuple.
« Si Bossuet touchant le pur amour
À Fénelon est si contraire
Il parle en évêque de Cour
Qui ne connaît que l’amour mercenaire. » 920Bossuet et Fénelon (1698), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
On ne badine pas avec la religion (officielle) et cette « chanson » est naturellement anonyme, d’autant plus qu’elle attaque Bossuet l’« évêque de cour » , ardent défenseur de l’absolutisme politique et du droit divin des roi, chargé par Louis XIV d’enquêter sur le quiétisme à la mode. Strict légaliste, Bossuet craint que cette doctrine ne détourne les croyants de la pratique religieuse et des dogmes, pour aboutir au déisme. En vertu de quoi il condamne l’hérésie dans sa Relation sur le quiétisme (1698). Fénelon réplique, et les deux prélats jadis amis s’opposent publiquement. Bossuet l’emporte. Le pape condamne Fénelon, dont Louis XIV précipite la disgrâce.
« Pleurez, pleurez jouvenceaux,
Monsieur descend dans la bière !
À ses yeux vous étiez beaux,
Mais las ! il perd la lumière. » 925La Mort de Monsieur (1701), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Philippe, duc d’Orléans, frère du roi, meurt à Saint-Cloud le 8 juin. Mari de la princesse Palatine et père du futur Régent, il fut réputé pour son homosexualité et son amour des rubans, fards et cornettes. D’où des couplets dont les moins osés sont : « Le bon prince avait raison / Quand le beau sexe on cajole / Une telle liaison / Est sujette à la vérole / Mais le cul d’un beau garçon / Dans aucun risque ne jette / Point de génération / Dans ce plaisant tête-à-tête. » La chanson ne pouvait prévoir le mal de la fin du XXe siècle, qui touchera d’abord les homosexuels, dans les « années sida » .
« Ah ! que votre âme est abusée
Dans le choix de tous les guerriers.
Faut-il qu’une vieille édentée
Fasse flétrir tous vos lauriers ? » 929Contre Maintenon, chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Première visée, Mme de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV. L’influence de cette femme de tête sur le roi vieillissant fait jaser. Le peuple épuisé, ruiné, lassé d’une gloire dont il voit les faiblesses, la prend pour bouc émissaire. Cependant que la guerre de Succession d’Espagne tourne au drame, avec des troupes moins combatives, sous des chefs militaires aussi médiocres que La Feuillade, Marcin, Villeroy (ou Villeroi).
« Ne blâmons pas Villeroy,
Il fut choisi par le Roy ;
Mais blâmons tous ce grand prince
Qui sut faire un choix si mince. » 930Sur le maréchal de Villeroy, chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
L’opinion évolue : si tout va mal, le responsable en est le roi. Cette accusation directe est signe de temps nouveaux.
François de Neufville, duc de Villeroi (ou Villeroy), maréchal de France, fils du gouverneur de Louis XIV, resta toujours son ami. Il remplace le prestigieux maréchal de Luxembourg à la tête des armées et ne cesse d’accumuler les défaites. Ainsi le 23 mai 1706 à Ramillies, triste épisode de la guerre de Succession d’Espagne, marquée par une débandade de l’armée franco-bavaroise en quatre heures, d’où 20 000 morts et la perte de la Belgique.
La chanson passe en revue les autres personnages jugés indignes du règne, divers ministres, le boiteux du Maine (fils légitimé de Mme de Montespan), la Maintenon reine. La France vit plus que jamais en « monarchie absolue tempérée par des chansons » .
« Louis, avec sa charmante,
Enfermé dans Trianon,
Sur la misère présente,
Se lamente sur ce ton :
Et allons, ma tourlourette
Et allons, ma tourlouron. » 934Louis avec sa charmante, chanson anonyme. Le Nouveau Siècle de Louis XIV ou Choix de chansons historiques et satiriques (1857), Gustave Brunet
La crise économique et sociale ronge le pays, et même à la cour, les marchands exigent d’être payés comptant, pour livrer au roi le linge à son usage personnel. Louis XIV, très éprouvé, trouve un réconfort moral auprès de Mme de Maintenon, mais il est de plus en plus conscient de la gravité de la situation.
« Un homme d’esprit me disait l’autre jour que le gouvernement de la France était une monarchie absolue tempérée par des chansons. » 993
CHAMFORT (1740-1794), Pensées, maximes et anecdotes (posthume, 1803)
Rappelons ce mot du siècle de Louis XIV, repris par Eugène Scribe en 1834, dans son Discours de réception à l’Académie française : « En France et sous nos rois, la chanson fut longtemps la seule opposition possible ; on définissait le gouvernement d’alors comme une monarchie absolue tempérée par des chansons. »
Le plus souvent anonyme, la chanson était l’une des rares formes d’opposition possibles. Au siècle des Lumières, elle garde cette fonction.
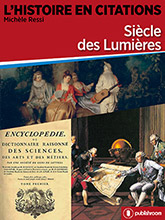 SIECLE DES LUMIÈRES
SIECLE DES LUMIÈRES
« Et ce prince admirable
Passe ses nuits à table
En se noyant de vin
Auprès de sa putain. » 1073Pamphlet (anonyme). Chansonnier historique du XVIIIe siècle (1879), Émile Raunié
L’impopularité du Régent s’exprime par des vers publiés ou chantés, rarement signés – prudence oblige. Aucun des princes qui vont gouverner la France n’échappera désormais à ce genre d’écrits. Louis XV le Bien-Aimé mourra haï du peuple. Et Marie-Antoinette, dauphine adulée, devenue reine, sera la cible de pamphlets par milliers.
« Lundi, je pris des actions,
Mardi, je gagnai des millions,
Mercredi, je pris équipage,
Jeudi, j’agrandis mon ménage,
Vendredi, je m’en fus au bal,
Et samedi, à l’hôpital. » 1083Lundi je pris des actions (1720), chanson de rue. Histoire du vaudeville (1899), M.E. Prioleau
Tout est prétexte à chanson populaire ! L’édifice fragile du « Système de Law » s’effondre en 1720, au terme d’un emballement affolé : chute des dividendes, perte de confiance des porteurs, spéculation à la baisse de banquiers rivaux (les frères Pâris), trop forte émission de billets que la banque ne peut rembourser à vue, panique boursière. Et les compagnies créées dans les colonies n’ont pas eu le temps de rapporter les richesses espérées.
La bourse de la rue Quincampoix est fermée en mars, la débâcle financière générale provoque des émeutes en juillet. Le 21, une semi-banqueroute est prononcée, un arrêt du 10 octobre retire tout usage monétaire aux billets de banque de Law (il y en avait pour plus de 10 milliards de livres). John Law, devenu entre-temps contrôleur général des Finances, prend la fuite et mourra ruiné aux Pays-Bas.
« Ah ! Ah ! Monsieur est Persan ! C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? » 1086
MONTESQUIEU (1689-1755), Lettres Persanes (1721), première édition anonyme
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, est un homme qui se plaît à se dire heureux, dans son siècle épris de bonheur. C’est aussi le premier-né des philosophes dits des Lumières. Magistrat fortuné, il écrit pour se distraire, avant de se consacrer tout entier à une œuvre dont le titre le plus sérieux est L’Esprit des lois (1748).
Il a commencé par un petit ouvrage plaisant, publié à Amsterdam, anonyme et « persan » : trois précautions valent mieux qu’une pour déjouer la censure ! Le masque ne trompe personne et le subterfuge rend l’auteur célèbre : sa réputation de bel esprit est faite, et sa critique des mœurs contemporaines, fort hardie sous l’apparence badine, séduit le public des salons. Ainsi la lettre XXX raille la curiosité naïve et indiscrète des Parisiens du temps, pour tout ce qui sort de l’ordinaire. Cette curiosité « encyclopédique » sera l’une des qualités du siècle des Lumières.
« De par le Roi, défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu. » 1103Épigramme (anonyme) à la porte du cimetière Saint-Médard, fin janvier 1732. Dictionnaire philosophique (1764), Voltaire
L’affaire des convulsionnaires du cimetière Saint-Médard, cas spectaculaire de transe collective, défraie la chronique durant cinq années, créant un trouble à l’ordre public du plus mauvais effet.
Finalement, le Parlement approuvera l’ordonnance royale qui a ordonné la fermeture du cimetière. Et le jansénisme est discrédité. Le vieux cardinal Fleury espère pouvoir gouverner en paix, et rétablir les finances de la France.
« Nous étions vingt ou trente
Brigands dans une bande,
Tous habillés de blanc,
À la mode des…
Vous m’entendez ?
Tous habillés de blanc
À la mode des marchands. » 1137La Complainte de Mandrin (1755), chanson anonyme
L’auteur est anonyme, mais le texte semble bien daté de l’année de sa mort. Tout est fait pour rendre Mandrin sympathique, humain, proche du peuple.
Bandit de grand chemin, prenant la tête de contrebandiers et de faux saulniers (faisant le trafic du sel), il forme une troupe disciplinée qui s’attaque aux fermes générales et aux greniers à sel avec une incroyable audace. « On prétend que Mandrin est à la tête de 6 000 hommes déterminés ; que les soldats désertent pour se ranger sous ses drapeaux et qu’il se verra bientôt à la tête d’une grande armée » , écrit encore Voltaire.
En 1754, il a mené six campagnes contre les fermiers généraux, collecteurs d’impôts haïs du peuple, qui prélèvent des taxes sur les marchandises et en gardent les trois-quarts – la plus connue est la gabelle, sur le sel, indispensable à la conservation des aliments.
Il faudra plusieurs détachements d’Argoulets (troupe spéciale) envoyés illégalement en Savoie (royaume sarde) pour que Mandrin soit pris, sitôt jugé, et roué vif, le 26 mai 1755 – il meurt à 30 ans.
« Soubise dit, la lanterne à la main,
J’ai beau chercher ! où diable est mon armée ?
Elle était là pourtant hier matin.
Me l’a-t-on prise, ou l’aurais-je égarée ?
Ah ! je perds tout, je suis un étourdi !
Mais attendons au grand jour, à midi.
Que vois-je ! Ô ciel ! que mon âme est ravie !
Prodige heureux ! La voilà, la voilà !
Ah ! ventrebleu, qu’est-ce donc que cela ?
Ma foi, c’est l’armée ennemie. » 1148Épigramme au lendemain de la défaite de Rossbach, 5 novembre 1757. Histoire de France pendant le XVIIIe siècle (1830), Charles de Lacretelle
Paris célèbre les défaites avec un humour qui n’appartient vraiment qu’à ce temps ! On ridiculise le prince de Soubise, protégé de la Pompadour et favori du roi. C’est le moins talentueux des amis de la marquise. Et c’est un triste épisode de la guerre de Sept Ans (1756-1763) : après les premières victoires viennent de nombreux revers, sur terre comme sur mer.
« C’est le ton de la nation ; si les Français perdent une bataille, une épigramme les console ; si un nouvel impôt les charge, un vaudeville les dédommage. » 1149
Carlo GOLDONI (1707-1793), Mémoires (1787)
Cet Italien de Paris connaît bien notre pays et notre littérature. Surnommé le Molière italien, invité par Louis XV, il s’installe définitivement à Paris en 1762. Il écrit en français pour la Comédie-Italienne (rivale de la Comédie-Française), devient professeur d’italien à la cour. Il sera également pensionné sous Louis XVI. Il rédige ses Mémoires à la fin de sa vie, pauvre, malade, presque aveugle, mais exprimant toujours sa gratitude pour la France – même si la Révolution supprime sa pension à l’octogénaire.
« Autrefois de Versailles
Nous venait le bon goût,
Aujourd’hui la canaille
Règne et tient le haut bout.
Si la cour se ravale,
De quoi s’étonne-t-on ?
N’est-ce pas de la halle
Que nous vient le poisson ? » 1163Poissonnade de 1749. Chansonnier historique du XVIIIe siècle (1879), Émile Raunié
Le dictionnaire de la langue française s’en tient à la définition culinaire de la poissonnade : « repas collectif principalement composé de poissons et fruits de mer. » Mais la marquise de Pompadour est née Jeanne-Antoinette Poisson « comme tout le monde » et sera particulièrement chansonnée pour son patronyme.
Même si le peuple reproche son origine non noble à la dame, c’est de la cour que part le plus souvent ce genre de pamphlets (anonymes). La personne du roi est également attaquée.
« Oh ! la belle statue ! oh ! le beau piédestal !
Les Vertus sont à pied et le Vice à cheval. » 1177Vers anonymes écrits sur le socle de la statue équestre de Louis XV. Le Vandalisme de la Révolution (1993), François Souchal
La statue de Bouchardon, inaugurée à Paris le 2 juin 1765 sur la place Louis-XV (aujourd’hui place de la Concorde) est entourée de quatre figures symbolisant les vertus.
Louis XV le Bien-Aimé a perdu la Pompadour et pas encore trouvé la du Barry : entre deux favorites officielles, les dames ne manquent pas, surtout de très jeunes demoiselles, discrètement abritées dans le Parc-aux-Cerfs à Versailles, fournies par des parents consentants, ignorant elles-mêmes l’identité de leur royal amant et mariées à des courtisans sitôt qu’engrossées. Dit-on. La marquise de Pompadour, maquerelle vigilante, veillait à ce que le roi ne s’attache durablement à aucune. Disait-on aussi. Le règne est celui de toutes les rumeurs et la vie amoureuse de ce roi très sensuel et à présent haï est un sujet de choix.
La cruauté populaire s’exercera jusqu’à la mort de l’ex « Bien Aimé » .
« Ami des propos libertins,
Buveur fameux, et roi célèbre
Par la chasse et par les catins :
Voilà ton oraison funèbre. » 1195Chanson anonyme à la mort de Louis XV (1774). Vie privée de Louis XV, ou principaux événements, particularités et anecdotes de son règne (1781), Mouffle d’Angerville
« On l’enterra promptement et sans la moindre escorte ; son corps passa vers minuit par le bois de Boulogne pour aller à Saint-Denis. À son passage, des cris de dérision ont été entendus : on répétait « taïaut ! taïaut ! » comme lorsqu’on voit un cerf et sur le ton ridicule dont il avait coutume de le prononcer » (Lettre de la comtesse de Boufflers).
« Plus bel esprit que grand génie,
Sans loi, sans mœurs et sans vertu,
Il est mort comme il a vécu,
Couvert de gloire et d’infamie. » 1230Épigramme, juin 1778, attribuée à Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), à la mort de Voltaire. Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages (1826), Sébastien Longchamp
Quatrain anonyme, car non signé. L’attribution est vraisemblable, la haine de Rousseau pouvant in fine se venger de l’humour voltairien dont l’auteur avait usé et abusé.
Rousseau mourra deux mois après, à Ermenonville. Fin d’une longue guérilla philosophico-polémique, qui ne fit honneur à aucun des deux personnages, si talentueux (ou géniaux) fussent-ils.
« Plus scélérate qu’Agrippine
Dont les crimes sont inouïs,
Plus lubrique que Messaline,
Plus barbare que Médicis. » 1242Pamphlet contre la reine. Vers 1785. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
Dauphine jadis adorée, la reine est devenue terriblement impopulaire en dix ans, pour sa légèreté de mœurs, mais aussi pour ses intrigues et son ascendant sur un roi faible jusqu’à la soumission. L’affaire du Collier va renforcer ce sentiment.
La Révolution héritera certes de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, mais aussi des « basses Lumières » , masse de libelles et de pamphlets à scandale presque toujours anonymes où le mauvais goût rivalise avec la violence verbale, inondant le marché clandestin du livre et sapant les fondements du régime. Après le Régent, les maîtresses de Louis XV et le clergé, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée : quelque 3 000 pamphlets la visant relèvent, selon la plupart des historiens, de l’assassinat politique.
« Parlement à vendre
Ministres à pendre
Couronne à louer. » 1255Mots gravés sur les murs du Palais de justice, mai 1788. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Des meneurs crient au coup d’État. Des soulèvements éclatent partout en France, orchestrés par une campagne de cabales et de pamphlets. En Languedoc à Toulouse, en Bretagne à Rennes, on manifeste. En Dauphiné à Grenoble le 7 juin 1788, on se soulèvera pendant la « journée des Tuiles » .
« Tremblez, tyrans, votre règne va finir. » 1256
Écriteau anonyme placé au Théâtre des Italiens, sur la loge de la reine, mai 1788. La Reine Marie-Antoinette (1889), Pierre de Nolhac
Le roi essaie de faire passer les édits par lit de justice. Les Parlements organisent la résistance, font la grève de la justice, et demandent la réunion des États généraux. Les remontrances succèdent aux remontrances, les émeutes aux émeutes. Le roi doit fixer la date de la convocation tant redoutée : au 1er mai 1789.
Le 16 août 1788, c’est la banqueroute : l’État suspend ses paiements. Brienne démissionne, Paris illumine et brûle son mannequin.
« Grand prince, votre bienfaisance
De nos maux peut tarir le cours.
Rendez vous aux cris de la France :
Rappelez Necker à votre cour. » 1257Ô toi qui sais de la finance (1788), chanson anonyme. Sur le timbre de Réveillez-vous belle endormie Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Le 25 août 1788, le roi se décide à rappeler Necker. On célèbre le disgracié :
« O toi qui sais de la finance / Mettre les secrets au grand jour,
Tu seras chéri de la France / Tu seras chassé de la cour.
Par une noble confiance, / Tu veux mériter notre amour.
Tu connais l’esprit de la France, / Ce n’est pas celui de la cour.
Tu voulais que la récompense / Du mérite fût le retour,
C’était bien le vœu de la France, / Que n’est-ce celui de la cour ? »
25 août 1788, le roi se décide à rappeler Necker – le peuple applaudit et Mirabeau s’exclame : « Voici enfin M. Necker roi de France ! » Lié au duc d’Orléans et partisan d’une monarchie constitutionnelle, il ironise au rappel de Necker qui devient ministre principal (ministre d’État) : c’est l’homme de la dernière chance pour cette monarchie.
Le banquier suisse prête 2 millions à l’État sur sa fortune personnelle, en trouve quelques autres, le temps de tenir jusqu’aux États généraux. Et convoque une seconde Assemblée des notables, pour novembre.
« Ces grands États généraux
F’ront-ils du brouet d’andouille ?
Ces messieurs s’ront-ils si sots
Que d’s’en retourner chez eux bredouilles,
Quand par miracle un bon roi
Veut faire l’bien d’si bonne foi ? » 1259Motion des harengères de la halle (1788), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Le peuple, reconnaissant au roi de la convocation des États généraux, a quand même un doute après l’échec de la précédente Assemblée des notables. « La convocation des États généraux de 1789 est l’ère véritable de la naissance du peuple. Elle appela le peuple entier à l’exercice de ses droits » , écrira Michelet dans son Histoire de la Révolution française.
« Vous qui nous traitez de racaille,
Si poliment,
Comme nous vous payerez la taille
Très noblement.
Vive le sauveur de la France,
Necker, vivat !
D’où ce héros tient-il naissance ?
Du tiers état. » 1264Le Tiers État, chanson de janvier 1789. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La chanson célèbre le roi et son ministre qui a obtenu, non sans difficulté, que le tiers ait à lui seul autant de représentants que les deux autres ordres réunis.
« Sire, il n’y a qu’un monarque dans votre royaume, c’est le fisc. Il ôte l’or de la couronne, l’argent de la crosse, le fer de l’épée et l’orgueil aux paysans. » 1315
Cahier de doléances de la ville de Marseille. Cité par Marcel Jullian, invité à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, matinale sur France Inter en 1989
Superbe style qui contraste avec le ton quotidien, terre à terre et souvent laborieux des quelque 50 000 cahiers rédigés en février-mars 1789, pour exprimer les revendications des Français.
Un cahier de doléances (du verbe doloir, dolere en latin) est un document dans lequel les assemblées chargées d’élire les députés aux États généraux faisaient part de leurs souhaits et leurs récriminations par écrit. Cet usage remonte au XIIIe siècle. Les cahiers de doléances les plus notoires restent ceux de 1789.
« Étant démontré, avec raison, qu’un noble ne peut représenter un roturier, ni celui-ci un noble, de même, un homme ne pourrait avec plus d’équité représenter une femme, puisque les représentants doivent avoir absolument les mêmes intérêts que les représentés : les femmes ne pourraient donc être représentées que par des femmes. » 1317
Cahier de doléances et réclamation des femmes, signé d’une Madame B.B. (cauchoise restée anonyme). « La revendication de la démocratie paritaire » , Marie-Blanche Tahon, Politique et Sociétés, volume XVII (1998)
Les femmes, c’est un peu le « quart ordre » de l’époque. Sous la Révolution va s’exprimer un courant féministe, mais les hommes qui gouvernent n’accorderont pas aux femmes les droits bientôt reconnus aux « nègres » et aux juifs. Elles auront seulement le droit de mourir sur l’échafaud.

