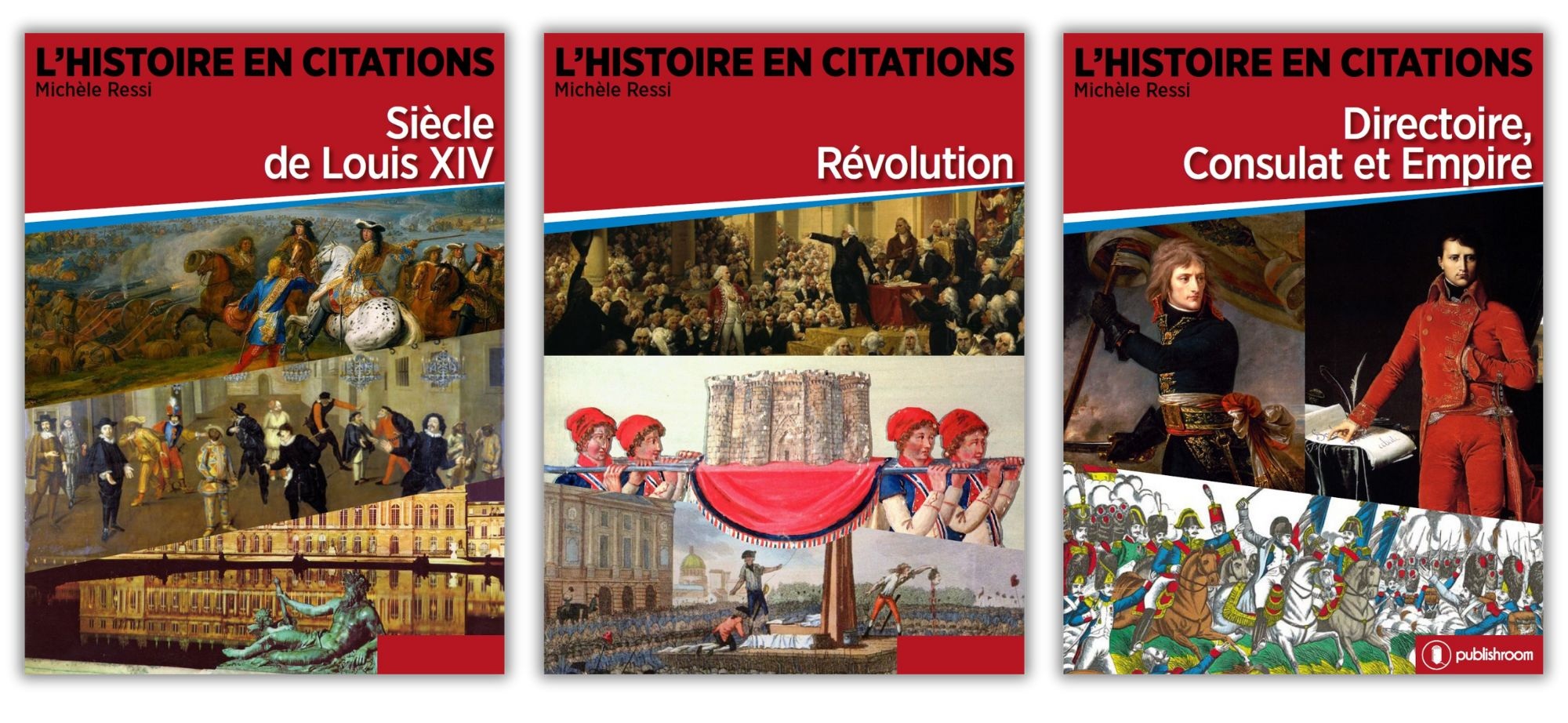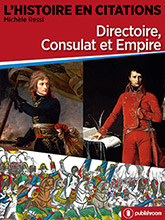 Le destin de l’Aiglon. Héros romantique et personnage de théâtre, il appartient à la légende napoléonienne, dans l’imaginaire collectif et par le génie de quelques auteurs.
Le destin de l’Aiglon. Héros romantique et personnage de théâtre, il appartient à la légende napoléonienne, dans l’imaginaire collectif et par le génie de quelques auteurs.
À feuilleter pour tout savoir.
« Le vingt-deuxième coup fut pour nous un coup de massue, il nous semblait tuer la race des Bourbons. » 1853
Baron François-Auguste Fauveau de FRÉNILLY (1768-1848), ultra royaliste, évoquant ce 20 mars 1811
20 mars 1811. Marie-Louise d’Autriche vient d’accoucher. Tout Paris explose de joie au vingt-deuxième coup, qui annonce la naissance d’un fils (une fille n’avait droit qu’à 21 coups, contre 101 pour un garçon), titré dès sa naissance « roi de Rome » , par référence au Saint-Empire romain germanique et à Charlemagne.
« Ma tombe et mon berceau seront bien rapprochés l’un de l’autre ! Ma naissance et ma mort, voilà donc toute mon histoire. » 2078
(1811-1832), mourant à 21 ans de tuberculose, 22 juillet 1832
Les Errants de la gloire (1933), princesse Lucien Murat (comtesse Marie de Rohan-Chabot).
Edmond Rostand, le dernier poète romantique du siècle, est un peu le second père de l’Aiglon et fit beaucoup pour sa gloire. Le rôle-titre est créé en travesti par Sarah Bernhardt (1900). À plus de 50 ans, star mondiale de la scène, elle triomphe en incarnant ce jeune prince.
Le fils de l’Aigle (Napoléon), ex-roi de Rome, éphémère Napoléon II, n’aura pas le destin rêvé par son père, ni même aucun rôle politique. Son grand-père maternel, François Ier d’Autriche, y veille, occultant autant que faire se peut le souvenir de l’empereur et le faisant duc de Reichstadt (petite ville de Bohême), tout en chérissant l’adolescent fragile.
« Ma vie politique est terminée. Je proclame mon fils, sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » 1951
NAPOLÉON Ier (1769-1821), 22 juin 1815
Il abdique une seconde fois, en faveur de son fils. Napoléon II est reconnu empereur le 23 juin par les Chambres des Cent-Jours. Non sans tumulte ! Et avec un argument juridique étonnant : dans le cas contraire, l’abdication serait nulle, et Napoléon, vaincu à Waterloo, pourrait repartir en guerre avec 50 000 hommes…
« Je préférerais qu’on égorgeât mon fils ou qu’il fût noyé dans la Seine plutôt que de le voir jamais élevé à Vienne comme prince autrichien. » 1960
NAPOLÉON Ier (1769-1821), fin 1815, après la seconde abdication
L’empereur déchu ignore encore que l’Aiglon sera précisément élevé à Vienne comme un prince autrichien, sous le nom de duc de Reichstadt – c’est l’« assassinat moral » tant redouté par le père pour son fils.
« Il y a différentes manières d’assassiner un homme : par le pistolet, par l’épée, par le poison ou par l’assassinat moral. C’est la même chose, au définitif, excepté que ce dernier moyen est le plus cruel. » 1776
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Correspondance
Qui veut la fin veut les moyens et l’assassinat du duc d’Enghien, sommairement jugé et fusillé de nuit, dans les fossés du château de Vincennes, sera « pire qu’un crime, une faute » .
L’assassinat moral, par calomnie, manipulation, fausses dénonciations, attaques propres à déshonorer l’adversaire, Napoléon a pratiqué tout cela, aidé par sa police, sa diplomatie, ses services secrets. Il en fut également victime, avec les innombrables opposants, intrigants ou ambitieux, ingrats ou traîtres à sa mémoire. Mais l’assassinat moral redouté plus que tout concerne son fils. Il savait la fragilité du prince et comme il serait exposé. La mort prématurée de l’Aiglon le sauvera, paradoxalement.
« L’Angleterre prit l’aigle et l’Autriche l’aiglon. » 1961
Victor HUGO (1802-1885), Les Chants du crépuscule (1835)
Les destins tragiques inspirent les poètes, et entre tous, les grands romantiques du XIXe siècle. Hugo sera d’autant plus « fan » de Napoléon le Grand qu’il détestera « Napoléon le Petit » , alias Napoléon III. Parvenu au pouvoir, le prince Louis-Napoléon prit ce nom, par respect de l’éphémère Napoléon II.
« Tous deux sont morts. Seigneur, votre droite est terrible. » 2079
Victor HUGO (1802-1885), Poème d’août 1832 (Napoléon II, Les Chants du crépuscule)
L’Aiglon meurt à 21 ans, le 22 juillet 1832, et Napoléon à 51 ans, le 5 mai 1821. La légende napoléonienne doit beaucoup au génie d’Hugo. Chateaubriand, passé à l’opposition après la mort du duc d’Enghien, est plus sévère, dans ses Mémoires d’outre-tombe : « Il avait le monde sous ses pieds et il n’en a tiré qu’une prison pour lui, un exil pour sa famille, la perte de toutes ses conquêtes et d’une portion du vieux sol français. » La mythologie impériale est également entretenue par le Mémorial de Sainte-Hélène : souvenirs, pensées, confidences de Napoléon en exil à Emmanuel de Las Cases, œuvre plusieurs fois réédité vu son succès, chaque édition étant revue et augmentée.