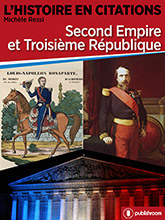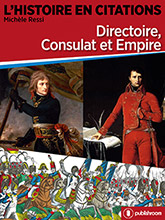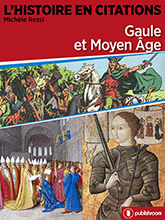Voici quelque 200 Mots, parfois apocryphes, mais toujours sourcés comme dans l’Histoire en citations.
La présentation chronologique montre qu’on ne mourait pas sous l’Antiquité ni même au XIXe siècle comme aujourd’hui. Autre leçon de l’histoire, on meurt souvent comme on a vécu, roi ou empereur, chef d’État ou militaire, chrétien ou athée, poète ou philosophe, dramaturge ou acteur, artiste ou scientifique, d’où le classement thématique en neuf catégories. Le sexe ou l’âge ne jouent guère et certaines « morts à contremploi » surprennent.
Quelques personnages cumulent deux ou trois mots de la fin : Jésus, Voltaire, Hugo… Une période se révèle particulièrement riche, la Révolution : pendant six ans, la guillotine tue beaucoup plus que la maladie ou la vieillesse et la situation donne du talent, voire du génie (improvisé ou pas).
Quelques mots sont bissés au fil des siècles, le plus fréquent étant le plus émouvant : « Maman. »
Au final, on notera l’étonnante variété de tons et de styles, entre le drame et l’humour, le courage et la peur, le lyrisme ou la pudeur, la simplicité quotidienne ou la pause pour l’éternité. Reste une impression dominante : la sincérité de ces derniers instants. À vous de juger, dans cet édito en quatre semaines.
III. Auteurs (philosophes, poètes, écrivains, dramaturges, journalistes, historiens…)
« Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette. »
SOCRATE (470 av J.-C.-399 av J.-C.). Encyclopédie Universalis.
Sacrifier un coq au dieu de la santé était rituel pour les agonisants dans l’Antiquité grecque. L’animal égorgé est remis au médecin en guise d’honoraires et Socrate voulait respecter la coutume à valeur symbolique : annonciateur du jour, le coq est garant de l’immortalité de l’âme.
Socrate charge donc Criton et ses amis de cette mission, avant de boire la ciguë, après sa condamnation à mort qu’il accepte « tout tranquillement, tout facilement » écrira Platon. À sa femme Xantippe pleurant de le voir périr innocent, il avait dit : « Aurais-tu préféré que je meure coupable ? » Autre mot de la fin cité.
Socrate est l’un des créateurs de la philosophie morale, mais il ne laisse aucun écrit. Ses disciples, Platon et Xénophon, ont contribué à maintenir l’image de leur maître, mis en scène dans leurs œuvres.
Déjà renommé de son vivant, Socrate deviendra l’un des penseurs les plus illustres dans l’histoire de la philosophie et une icône sans fin reprise et réinterprétée jusqu’à l’époque contemporaine. Au-delà de la sphère philosophique, c’est un personnage entouré de légendes, comparable à Jésus qui doit tant à ses disciples.
« Je désire aller en enfer et pas au ciel. J’y apprécierai la compagnie des papes, des princes et des rois, alors qu’au ciel ne s’y trouvent que les mendiants, les moines et les apôtres. »
MACHIAVEL (1469-1527) refusant l’aide d’un prêtre. Last Words, Last Words… Out ! (2020) Miguel S.Ruiz.
Humaniste de la Renaissance, né et mort à Florence, poète et auteur de théâtre, il reste comme théoricien de la politique, de l’histoire et de la guerre. Diplomate en mission auprès de la papauté et de la cour de France, il observe quinze ans durant la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes : Le Prince, son œuvre majeure dédiée à Laurent II de Médicis, sera nourrie de cette vision réaliste. Mais comment faut-il lire ces XXVI chapitres - plus souvent commentés que lus (comme Le Capital de Marx) !?
L’auteur sépare la politique de la morale et de la religion avec une radicalité machiavélienne, sinon machiavélique ! Le machiavélisme vu comme volonté de tromper donnerait donc une leçon de cynisme et d’immoralisme. Pour d’autres exégètes, son réalisme oppose faits politiques et valeurs morales, toute action politique obligeant l’homme d’État à trancher entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction.
Autre constatation : pas de politique sans mouvement, conflits et ruptures violentes. Si le recours à la force est admis, la rhétorique peut servir à convaincre l’autre. Reste la « virtù », mélange d’habileté, de puissance individuelle et de flair utiles pour contrer la force aveugle et la mauvaise fortune. Les deux interprétations de Machiavel s’opposent, alors qu’elles devraient se compléter dans le meilleur des mondes possibles – mais fatalement utopique.
« Je n’ai rien, je dois beaucoup, je lègue le reste aux pauvres … La farce est finie : tirez le rideau. »
RABELAIS (1494-1553). L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Deux mots de la fin en un ! On ne prête qu’aux riches. Et voici le troisième : « Je pars en quête d’un grand peut-être. » Moine (défroqué) et anticlérical, chrétien et libre penseur, médecin mais bon vivant affiché, cette riche personnalité a bien et beaucoup vécu, écrit et innové en presque tout pour devenir un classique d’un genre… unique en son genre. Reste la langue de Rabelais, d’une richesse foisonnante, innovante, affolante… et révolutionnaire. Elle nous étonne encore. Bien joué, l’artiste !
« Adieu, mes chers amis ; je m’en vais le premier pour vous préparer la place. »
Pierre de RONSARD (1524-1585). L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
« Prince des poètes et poète des princes », poète engagé (catholique et patriote) dans la tourmente des guerres de Religion, créateur de la Pléiade (groupe de huit poètes français), il a déjà perdu ses amis et confrères Du Bellay, Baïf, Belleau, Jodelle, mais aussi le jeune roi Charles IX qui adorait son précepteur et quelques personnalités politiques.
Outre sa surdité qui l’a empêché de faire carrière dans la diplomatie, ses crises de goutte se font de plus en plus invalidantes. Le sexagénaire s’éteint dans la nuit du 27 au 28 décembre 1585, entouré de ses amis Jean Galland (son éditeur), Claude Binet (avocat, poète et son premier biographe) et Jacques Davy du Perron (diplomate, poète et prélat), dans son prieuré Saint-Cosme de Tours, au cœur du Val de Loire qui lui est si cher.
« Ce n’est pas la mort que je crains, mais de mourir. »
Michel de MONTAIGNE (1533-1592). Friandises littéraires (2008), Joseph Vebret.
Philosophe de la sagesse et de la tolérance (vertu rare au temps des guerres de Religion), il pensait dans sa jeunesse à la mort en stoïcien pour qui « la grande affaire de l’homme est de se préparer à bien mourir. »
Il finira en sage épicurien. Il faut suivre la nature sans se soucier de la mort qui viendra toujours à son heure : « La mort est bien le bout, non pas le but de la vie ; la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. » Les Essais s’achèvent sur une invitation au bonheur de vivre. C’est le « Carpe diem » cher à Ronsard, lui-même inspiré d’Horace, poète latin.
« J’ai 30 000 livres de rentes… et je meurs ! »
Philippe DESPORTES (1546-1606). Friandises littéraires (2008), Joseph Vebret
Le poète eut son heure de gloire, comparé même à Ronsard, ce qui est excessif. Comblé d’honneurs et de biens, « le plus courtisan et le plus abbé des poètes » (selon le critique Sainte-Beuve au XIXe siècle) dut constater à son tour cette évidence : tout l’or du monde ne peut rien contre l’inéluctable.
« J’ai déjà un pied dans l’étrier. »
Miguel de CERVANTÈS (1547-1616). Last Words, Last Words… Out ! (2020) Miguel S.Ruiz.
Il fut d’abord soldat, perdant l’usage de sa main gauche (paralysée) suite à la bataille navale de Lépante (1571) au large de la Grèce, d’où son surnom de « Manchot de Lépante ». De retour vers l’Espagne en 1575, l’aventurier est capturé par les Barbaresques, fait quatre tentatives d’évasion, mais reste captif à Alger. En 1580, racheté en même temps que d’autres prisonniers espagnols, il regagne enfin son pays.
Marié puis séparé de son épouse, occupant diverses fonctions, il se voue alors à l’écriture. Le théâtre ne lui réussit pas, mais il a plus de chance dans le roman pastoral, avant de rencontrer la gloire avec LE personnage de sa vie. Il meurt hanté par son Don Quichotte (1605-1615), « Chevalier errant à la triste figure ». Tous les auteurs ont plus ou moins tendance à s’identifier à leurs personnages et dans ce cas, la frontière entre rêve et réalité se révèle particulièrement incertaine.
« Ne me parlez plus, votre mauvais style me dégoûte ! »
François de MALHERBE (1555-1628) interrompant son confesseur. Dictionnaire amoureux de l’Humour (2012), Jean-Loup Chiflet.
Poète officiel d’Henri IV et de Marie de Médicis, il passe du style baroque au classique et va influencer la langue française, l’une des grandes affaires du temps. Puriste à l’extrême, il le reste vraiment jusqu’à la fin et l’auteur l’emporte ici sur le chrétien - l’inverse étant plus courant, surtout à cette époque.
Mais le chrétien eut aussi son mot de la fin, résolu in extremis à se confesser « comme tout le monde » : « On ne fera pas un paradis exprès pour moi. »
« … Eh bien, Dante m’emmerde ! »
Lope de VEGA (1562-1635), mot de la fin et cri du cœur. Vous n’aurez pas le dernier mot ! Petite anthologie désinvolte des plus belles réparties (2006), Jean Piat et Patrick Wajsman. Également cité dans L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Poète espagnol créateur la comedia nueva (tragi-comédie), écrivain majeur du Siècle d’or, surnommé par son confrère Cervantès « le Phénix », « le Monstre de la nature », il écrit quelques 3 000 sonnets, 9 épopées, des romans, 1 800 pièces profanes, 400 drames religieux, de nombreux intermèdes… menant dans le même élan une vie d’aventures où les amours (coupables) se succèdent, jusqu’à une crise existentielle. Entré dans l’ordre religieux des Hospitaliers, ses besoins amoureux le porteront encore vers d’autres aventures. Bref, une riche nature !
Non conformiste jusqu’à la fin, il demande au médecin si sa mort est certaine, ayant une révélation à faire de telle nature qu’après, la vie deviendrait impossible. « Je vous écoute, mon fils. Quel est ce lourd secret ? – Eh ! bien Dante m’emmerde et m’a toujours emmerdé ! » Crime de lèse-Littérature contre l’auteur de la Divine Comédie, le « Père de la langue italienne », génie incontesté. Voilà, c’est dit, et « le Phénix » espagnol meurt.
« Je m’en vais ou je m’en va… L’un et l’autre se dit ou se disent. »
VAUGELAS (1585-1650). Dictionnaire des curieux (1880), Ch. Ferrand.
Grammairien, c’est en 1634 l’un des premiers membres de l’Académie française qui eut l’heur de plaire au cardinal de Richelieu. Il consacrera quinze ans de sa vie au Dictionnaire, prié par le cardinal de ne pas oublier le mot « pension » grâce à quoi il vit.
Comme nombre d’auteurs (et d’artistes en tous genres), la passion de son métier l’a suivi jusqu’à sa mort. Deux siècles plus tard, en 1851, Émile Littré (père du dictionnaire éponyme) aura le même mot de la fin souvent cité.
« Je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu’elle se remarie. Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. »
SCARRON (1610-1660). Dictionnaire amoureux de l’Humour (2012), Jean-Loup Chiflet.
Auteur du Roman comique, pensionné comme « malade de la reine », c’est l’un des seuls pamphlétaires osant signer ses mazarinades contre le tout puissant cardinal Mazarin. Infirme en fauteuil roulant (sans doute atteint d’une spondylarthrite ankylosante), il épouse à 42 ans une orpheline sans fortune de 16 ans.
Le premier mari de la future Madame de Maintenon ne pouvait imaginer que le second serait Louis XIV en personne, apparemment très attaché à « Madame de Maintenant », personnage très discuté par les contemporains comme par les historiens. Il est vrai qu’entre temps, la femme avait bien changé !
« Je ne sens autre chose qu’une difficulté d’être. Je ne croyais pas faire tant de façons pour mourir. »
FONTENELLE (1657-1757), âgé de 99 ans. L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Poète et philosophe, élu en 1691 à l’Académie française, on lui doit cette épigramme plaisante et toujours valable : « Sommes-nous trente-neuf, on est à nos genoux, / Sommes-nous quarante, on se moque de nous. » Fontenelle fut donc très courtisé, ne libérant son fauteuil que soixante-six ans après. Le mot de la fin de ce quasi-centenaire sera souvent cité par Sacha Guitry qui appréciait ce genre d’humour et mourut fort souffrant.
Le vieil académicien qui se lassait d’être « immortel » au temps où l’espérance de vie était beaucoup plus courte dit aussi plaisamment : « Il est temps que je m’en aille ! Je commençais à voir les choses telles qu’elles sont. »
« Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. »
VOLTAIRE (1694-1778), profession de foi manuscrite, 18 février 1778. Choix de testaments anciens et modernes (1829), Gabriel Peignot.
Ses derniers mots, soigneusement écrits de sa plume et destinés à être publiés, sont pour la tolérance, le combat de sa vie. Fort âgé et malade, il ne voulait pas rater son mot de la fin, autrement dit sa sortie. Mais il eut l’art de se ménager, tout en travaillant avec acharnement – les Œuvres complètes publiées par la Voltaire Foundation et l’Université d’Oxford comptent 203 volumes, dont une Correspondance monumentale - plus de 15 000 lettres sur un total parfois estimé à 40 000 ! Tout cela naturellement manuscrit.
Voltaire meurt cinq mois plus tard, le 30 mai - après que la Comédie Française ait rendu hommage à l’auteur tragique de retour à Paris pour l’événement, statufié de son vivant et aujourd’hui injouable. Les cendres du plus célèbre philosophe des Lumières seront transférées au Panthéon sous la Révolution - honneur partagé avec Rousseau.
« Je m’arrêterais de mourir, s’il me venait un bon mot ou une bonne idée. »
VOLTAIRE (1694-1778). Étonnant Sacha Guitry (1985), James Harding, Charles Floquet.
Sacha Guitry collectionnait les mots de la fin et ce (second) mot de Voltaire ne pouvait que l’enchanter par son esprit. Preuve que ce fameux esprit n’a jamais quitté l’homme de génie qui incarne le siècle des Lumière, souvent admiré mais parfois détesté – notamment par Rousseau, son meilleur ennemi, mort quelques mois après lui.
« Vous voyez comme le ciel est pur et serein. J’y vais… »
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Si peu de sérénité et tant de souffrances dans la vie de ce philosophe ! Il tranche sur ses confrères et fait exception à la règle du siècle des Lumières qui affiche son bonheur de vivre – du moins dans la classe des privilégiés.
Rousseau en fut cruellement et personnellement conscient dans sa vie et ses œuvres : « On a tout avec de l’argent, hormis des mœurs et des citoyens. » Réaction violente contre la décadence des mœurs d’un pays grisé par sa propre civilisation. Il juge en moraliste et philosophe, mais aussi en « pauvre » et « asocial », cette société où l’argent devient la mesure de tout, tandis que le plaisir, le luxe, la jouissance et parfois la débauche s’affichent.
Sincèrement épris de nature et de solitude (en cela déjà romantique), mais inapte à la vie sociale, incompris et déplorant de si mal communiquer, rebelle à toute contrainte, dégoûté de ce qui l’entoure et souffrant du contact des hommes jusqu’à la folie de la persécution, Jean-Jacques conclut dans un dernier paradoxe de ses Rêveries d’un promeneur solitaire : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. » De quoi souhaiter un au-delà plus clément… Que de mourants ont eu la même pensée.
« Ah ! mon ami, je m’en vais enfin de ce monde où il faut que le cœur se brise ou se bronze. »
CHAMFORT (1740-1794) à l’abbé Sieyès. Revue des Deux Mondes (1848) Tome III.
Poète et auteur de théâtre (à la mode), journaliste et surtout moraliste, enfant naturel qui surmonta ce handicap social pour devenir l’un des écrivains les plus appréciés des salons parisiens où il brille. La quarantaine venue, il vit une liaison passionnée avec la veuve d’un médecin du comte d’Artois. La mort brutale de cette femme le laisse désespéré.
Chamfort sera ensuite séduit par la Révolution, sans pouvoir être d’un camp ou d’un autre. Emprisonné, libéré mais à nouveau suspect, pour éviter la prison, il tente de se suicider au pistolet, puis au couteau – ratage total, une vraie boucherie ! On sauve le blessé perdant son sang, mais il reste affaibli, mourant quatre mois plus tard.
Autre mot de la fin prêté à Chamfort refusant l’extrême-onction de manière plaisante : « Je vais faire semblant de ne pas mourir. »
« Hélas ! je n’ai rien fait pour la postérité ; et pourtant, j’avais quelque chose là. »
André CHÉNIER (1762-1794), se frappant le front avant de monter à l’échafaud, 25 juillet 1794. Mot de la fin d’un poète. Dictionnaire de français Larousse, au mot « postérité ».
Le poète s’est engagé avec enthousiasme dans la Révolution, avant de s’opposer aux Girondins. Plutôt que d’émigrer, il tenta de sauver Louis XVI. C’était un suspect idéal ! Son frère cadet, Marie-Joseph Chénier, lui-même suspect, n’a rien pu faire pour le sauver.
C’est l’une des dernières victimes de la Terreur (guillotiné deux jours avant l’arrestation de Robespierre !) : avec autant de courage que de talent, de son « cœur gros de haine, affamé de justice », le poète de 32 ans crie jusqu’à la fin sa révolte contre les exactions, mourant en auteur désespéré de n’avoir pas achevé son œuvre. Cette insatisfaction récurrente et tenaillante se manifesta chez nombre d’artistes et de scientifiques.
« Bonne nuit tout le monde ! »
BEAUMARCHAIS (1732-1799). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Dernier mot lancé à la ronde, quand il va se coucher après une soirée entre amis. On le retrouve le lendemain matin, mort d’une apoplexie foudroyante dans la nuit du 17 mai 1799.
Beaumarchais eut une vie belle et bien remplie : aventurier, agent secret, trafiquant d’armes, affairiste tout terrain, procédurier souvent gagnant… et homme de théâtre génial. L’auteur du Barbier de Séville et du Mariage de Figaro battit des records d’audience et de popularité mérités à la veille de la Révolution, dans un siècle des Lumières où la théâtromanie fait fureur dans la bonne société – d’où l’obstination du génial Voltaire à écrire des tragédies, seul genre où la postérité ne lui reconnaît aucun talent.
« Il est temps de contempler l’éternité. »
RIVAROL (1753-1801). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Bel esprit fort caustique vis-à-vis des beaux esprits de son temps, bientôt grand écrivain politique défenseur de la monarchie, il voit la vertu révolutionnaire dans les idées des philosophes pourtant non révolutionnaires et se vante à sa manière : « Nous sommes le premier de tous les Français qui écrivîmes contre la Révolution avant la prise de la Bastille. »
Monarchiste et rare humoriste de cette époque tragique, Rivarol est un homme d’ordre. Il pressent le risque couru et quitte Paris le 10 juin 1792, peu de jours avant l’irruption des « brigands » dans sa maison. Espérant rentrer en France sous le Directoire, il fut près d’y parvenir après le coup d’État napoléonien du 18 brumaire, mais il tombe malade et meurt en exil à Berlin, le 11 avril 1801, à l’âge de 47 ans et sur ce mot de la fin somme toute fataliste…
« Je sens que je quitte la terre et non la vie. »
Bernardin de SAINT-PIERRE (1737-1814) réconfortant ses proches qui l’entourent. Friandises littéraires (2008), Joseph Vebret.
Écrivain et botaniste à cette époque où les nouvelles sciences (diffusées par l’Encyclopédie) tentent nombre de littéraires, il obtient en 1768 un brevet de capitaine-ingénieur et part pour l’Île de France (aujourd’hui Île Maurice). De retour à Paris, il devient l’un des rares amis de Rousseau dont il partage les valeurs naturelles qui font le charme de son roman le plus connu, Paul et Virginie (1788). Il décrit avec force les sentiments amoureux et la nostalgie du paradis perdu, inspiré par ses amours malheureuses avec Françoise Robin, très jeune femme du premier intendant des Îles de France et de Bourbon.
Au-delà du cadre exotique et de la société idyllique qu’il se plaît à décrire, Bernardin de Saint-Pierre expose dans ce roman sa vision pessimiste de l’existence, dans un registre pathétique et naïf propre à l’air du temps.
« Je sens déjà les fleurs pousser sur moi. »
John KEATS (1795-1821). Encyclopédie Universalis.
Poète anglais romantique, il appartient à la même génération que Lord Byron et Shelley.
Richesse mélancolique d’une imagerie sensuelle, imaginaire paroxystique tout en métaphore de son inspiration, langage poétique et lenteur étudiée – cela fait partie de son génie…
Son frère Tom meurt de la tuberculose (le mal du siècle) et John apprend qu’il est lui aussi atteint de cette maladie presque toujours mortelle – comparable au SIDA des années 1980. Dans un poème de jeunesse, il avait demandé dix ans de carrière poétique pour atteindre son but. Le destin en a décidé autrement. Même la passion amoureuse qui le mine restera inaboutie – cela se lit dans La Belle Dame sans merci (1819), métaphore d’un chevalier captif d’une femme-vampire. Sans plus d’espoir d’avenir, il appelle à lui la mort : « Je sens les fleurs pousser sur moi » répète-t-il avant l’heure. Il part en Italie, appelé par Shelley, mais choisit de mourir seul à Rome. Sa vie et son œuvre représentent l’archétype d’un certain romantisme, aux antipodes de nos Chateaubriand, Hugo et même Musset, l’enfant du siècle.
« Mehr Licht ! »
« Plus de lumière ! »:GOETHE (1749-1832). L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Telles furent les derniers mots de Goethe, deux fois répétés sur son lit de mort. L’anecdote, célèbre en raison du nom de l’auteur de génie unanimement reconnu, reflète l’ambiguïté fondamentale entre le visible et les idées. Le grand penseur des Lumières souhaitait-il par cette injonction accéder à un idéal de connaissance absolue ? Ou simplement, regard embué par l’épuisement extrême, le mourant réclamait-il qu’on ouvre les rideaux de sa chambre pour faire entrer la clarté dans l’intérieur trop sombre ? « Plus de lumière ! »
Ces derniers mots de Goethe sont devenus une expression allemande synonyme de « plus de savoir, plus de vérité… » Mais est-ce un espoir, une demande désespérée, un regret… Nul ne le saura jamais et ce mystère fait la force de ces mots.
« Huit jours avec de la fièvre ! J’aurais encore eu le temps d’écrire un livre. »,
Honoré de BALZAC (1799-1850) avant son agonie. Dictionnaire de la mort (1967), Robert Sabatier.
En plein délire, il appela l’un des personnages de sa monumentale Comédie humaine, médecin de son état : « Blanchon ! Appelez Blanchon ! Lui me sauvera ! » Jusqu’à la fin, fiction et réalité se mêlent chez cet infatigable géant des lettres, mort au tournant de la cinquantaine d’un excès de travail (et de café).
Il a écrit par passion et feuilletonné jusqu’à la limite de ses forces, mais c’était aussi pour payer ses dettes d’imprimeur, dans une entreprise économique malheureuse. L’argent fut un problème pour bien des artistes au XIXe, siècle du capitalisme roi et sauvage. Mais beaucoup profitèrent aussi du marché et de la nouvelle rentabilité des œuvres, libérés du mécénat après des siècles de dépendance personnelle parfois humiliante ! Hugo en est le plus illustre exemple.
« Pourquoi pas, dit-il, c’est son métier ! »
Heinrich HEINE (1797-1856) importuné sur son lit de mort par un prêtre répétant que Dieu lui pardonnerait. L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Le « dernier poète du romantisme » éleva le langage quotidien au rang de langue poétique et le récit de voyage au rang de genre artistique, offrant à la littérature allemande une légèreté qui lui faisait défaut. Pour preuve, peu de poètes furent aussi souvent traduits et mis en musique.
Journaliste critique et politiquement engagé, essayiste, satiriste et polémiste, Heine fut aussi admiré que redouté. Ses origines juives ainsi que ses choix politiques lui valurent hostilité et ostracisme. Ce rôle de marginal marque sa vie, ses écrits et l’histoire mouvementée de la réception de son œuvre, jusqu’au mot de la fin qui reste un défi à la religion.
« Dormir ! Enfin, je vais dormir ! »
Alfred de MUSSET (1810-1857). Classiques Garnier (en ligne).
L’« enfant du siècle » traîna une existence désenchantée, cherchant des stimulants dans la débauche et l’alcool, sans jamais parvenir à « étourdir sa misère ». Il avoue très jeune : « Ma machine est usée ». En 1839, il tente de se suicider, après un accès de désespoir : « J’ai perdu ma force et ma vie, / Et mes amis et ma gaieté; / J’ai perdu jusqu’à la fierté / Qui faisait croire à mon génie ». À partir de 1840, la souffrance physique le traque sans répit : crises de nerfs, fièvres, pleurésie, jusqu’à la maladie de cœur qui l’emporta. Il meurt en laissant échapper ce cri de lassitude infinie : « Dormir ! Enfin, je vais dormir ».
Mais selon certaines sources, son frère Paul de Musset, absent à ses derniers instants, aurait inventé ce mot de la fin shakespearien, d’ailleurs inspiré de Byron. On ne quitte pas la famille romantique et l’implacable logique existentielle qui marque ce siècle plus qu’aucun autre.
« Non ! Crénom ! »
Charles BAUDELAIRE (1821-1867). Friandises littéraires (2008), Joseph Vebret.
Encore un poète usé, épuisé par tous les excès et les Paradis artificiels. Foudroyé par plusieurs attaques d’apoplexie, paralysé du côté droit, ayant quasiment perdu l’usage de la parole, il ne peut que répéter ce mot sur tous les tons. « Comme un enfant, il le gémissait et le ricanait avec des hoquets de colère ou de joie » selon Jules Vallès, témoin.
Jean Teulé reprend le mot dans sa bibliographie du poète dit maudit : Crénom, Baudelaire ! (2020) Peu avant, insatisfait de lui-même et conscient de sa supériorité littéraire, il avait dit : « Seigneur, mon Dieu si vous existez, accordez-moi la grâce de produire quelques vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. » La postérité a donné raison au poète des Fleurs du mal devenu très populaire, quoique sans concession à son génie.
« Rien dessus, rien dessous. »
SAINTE-BEUVE (1804-1869). Souvenirs de jeunesse 1830-1850 (1896), Arsène Houssaye.
Autrement dit : Pas de ciel, pas d’enfer… Il se fit enterrer civilement, confirmant ce mot de la fin sans appel.
Le personnage est original plus que séduisant. Médecin avorté, romancier raté, Sainte-Beuve devient le critique littéraire le plus célèbre de ce XIXe siècle passionnément littéraire. Redouté, parfois haï pour sa méchanceté, ses partis pris de « Sainte-Bévue » et sa misogynie dans l’air du temps - Sand la « vache à écrire » en fut la victime attitrée -, il sait aussi faire partager ses passions. Romantique par nature (sans en avoir le physique !), il se lie avec Hugo, incarnation de ce courant dominant dans le nouveau théâtre des « Gilets rouges » et dans le roman roi - avant la veine naturaliste de Zola.
Sainte-Beuve inaugure surtout une méthode d’analyse critique typiquement française : la biographie de l’auteur, liée au contexte historique, donne les clés de l’œuvre, ce qui permet de la comprendre et de la juger. Point de vue critiquable et critiqué, mais payant et souvent utilisé, avec plus ou moins de talent et d’intelligence.
« Il va falloir être sérieux, là-haut. »
Henri MONNIER (1799-1877). Dictionnaire amoureux de l’Humour (2012), Jean-Loup Chiflet.
Auteur dramatique, caricaturiste et comédien, c’est un artiste aux talents multiples.
Connu pour ses nombreuses caricatures réunies dans plusieurs recueils, dont Scènes populaires dessinées à la plume et Scènes de la ville et de la campagne, auteur d’une dizaine de pièces de théâtre qui ne sont plus jouées (ni jouables ?), c’est le créateur de Monsieur Prudhomme, personnage grassouillet, conformiste, solennel et stupide qui s’impose selon Balzac comme « l’illustre type des bourgeois de Paris ».
On lui attribue aussi la fameuse boutade : « On devrait construire les villes à la campagne, l’air y est tellement plus pur ! » (autre auteur possible, l’humoriste Alphonse Allais).
« Je m’en vais ou je m’en vas, car l’un et l’autre se disent ou se dit. »
Émile LITTRÉ (1801-1881). L’Art de mourir (1932), Paul Morand.
Philosophe, médecin, journaliste, traducteur, lexicographe, il est surtout connu pour son Dictionnaire de la langue française qui fait toujours référence, le Littré.
Franc maçon, il est « baptisé » in extremis par sa femme très catholique, assistée de sa fille Sophie et de la religieuse garde-malade. Il aura donc droit à des funérailles chrétiennes. Sa dernière pensée fut quand même pour la langue française à laquelle il a tant donné, d’où ce mot de la fin aussi attribué en 1650 à Vaugelas, autre linguiste obsessionnel.
« Allez, sortez !… Les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n’en ont pas dit assez. »
Karl MARX (1818-1883) à sa femme de chambre qui lui proposait de noter ses dernières paroles. Last Words, Last Words… Out ! (2020) Miguel S.Ruiz.
Philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste prussien, Marx a déjà dit et écrit l’essentiel. Rappelons les derniers mots du Manifeste du parti communiste, cosigné avec Engels : « Puissent les classes dirigeantes trembler à l’idée d’une révolution communiste ! Les prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » Daté de 1848.
Rappelons le contexte historique. Deuxième République et printemps des peuples en Europe : les classes dirigeantes – mais aussi une partie des classes populaires reprises en main par les notables en France – vont si bien trembler que les prolétaires perdront ce combat social. Ce n’est qu’un épisode de la lutte des classes : le Manifeste en donne une théorie qui va marquer le monde pendant un siècle et changer plusieurs fois le cours de l’histoire.
Le socialisme de Marx s’oppose à celui de Proudhon et la guerre des idées s’accompagne d’une guerre des mots entre ces deux penseurs politiques que tout oppose. Né utopique au début du siècle, plus ou moins révolutionnaire à la fin, le socialisme reste l’idée neuve qui n’en finit pas de se renouveler, jusqu’à nos jours où les « ismes » ont perdu une partie de leur pouvoir - qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore.
« C’est ici le combat du jour et de la nuit. »;
Victor HUGO (1802-1885), dernier alexandrin prononcé lors de son agonie. L’Œuvre littéraire de Hugo - BNF - Expositions virtuelles.
Immensément populaire de son vivant et aujourd’hui encore, Hugo est le troisième auteur le plus cité dans l’Histoire en citations (après Napoléon et de Gaulle) et pour une bonne raison : ce poète et romancier à l’œuvre immense joua un rôle politique majeur dans la seconde moitié de sa longue vie.
À l’heure du trépas, il dit encore : « Je vois la lumière noire » avant de fermer les yeux. Dans la dernière phrase de son testament, il écrivit : « Je vais fermer l’œil terrestre mais l’œil spirituel restera ouvert plus grand que jamais. »
Il aurait dit aussi : « Allons ! Il est bien temps que je désemplisse le monde. » Victor Hugo avait 83 ans. Il meurt juste à temps pour avoir droit au Panthéon, rouvert en son honneur.
On lui prête encore quelques dernières paroles grand-paternelles (et banales) pour ce qui lui reste de famille, après la perte de ses quatre enfants. Il a eu deux fils, Charles mort en 1871 et François-Victor en 1873, sans parler de son premier enfant Léopold, mort à trois (mois (1823). Sa fille Léopoldine s’est noyée à Villequier en 1843, âgée de 19 ans et enceinte de trois mois. Adèle H. a perdu la raison, internée durant quarante ans et morte en 1915. Restent ses deux petits-enfants et l’Art d’être grand-père.
« Tu ne pourrais pas faire tes commissions toi-même ! »
Eugène LABICHE (1815-1888) à son fils qui lui demande de dire à son épouse morte combien il l’aime toujours. Paraboles d’un curé de campagne (2015), Pierre Trevet.
Vaudevilliste (presque) aussi célèbre que Feydeau, il nous laisse (entre 176 titres) Un chapeau de paille d’Italie (1851), Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), La Cagnotte (1864). Cruel observateur de la bourgeoisie dont il fait partie, il critique ce petit monde où l’argent est roi, reflet des mentalités sous le Second Empire. Mais après la guerre de 1870 et la Commune (1871), la mode passe, même s’il écrit encore. « J’ai toujours pensé qu’il y avait quelque chose de plus difficile à faire jouer que la première pièce… C’est la dernière. » Suite au relatif échec de La Clé (1877), il n’y aura plus de créations, mais des reprises bienvenues et son élection à l’Académie française en 1880 - reconnaissance de son talent, malgré l’indignation de Ferdinand Brunetière déplorant « l’invasion des genres inférieurs » et le refus de Victor Hugo de voter pour lui. En 1886, Labiche encourage le jeune Feydeau lors de la représentation de sa première grande pièce, Tailleur pour dames qui triomphe au théâtre de la Renaissance.
Souffrant de problèmes cardiaques, il meurt âgé de 72 ans, sur un mot d’auteur digne du meilleur boulevard.
« Eh ben ! je m’en souviendrai de cette planète. »
VILLIERS de L’ISLE-ADAM (1838-1889). Friandises littéraires (2008), Joseph Vebret.
Mais il dit aussi : « Adieu, les belles choses ».
Atteint d’un cancer, il ne peut plus travailler. Son ami Mallarmé doit ouvrir une « cotisation amicale » pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Transféré à la clinique des Frères Saint-Jean-de-Dieu à Paris le 12 juillet 1889, il rédige un mois après son testament pour reconnaître son fils Victor et il épouse la mère in extremis.
Anatole France lui rend un vibrant hommage : « Si ce dormeur éveillé a emporté avec lui le secret de ses plus beaux rêves, s’il n’a pas dit tout ce qu’il avait vu dans ce songe qui fut sa vie, il a laissé assez de pages pour nous donner une idée de l’originale richesse de son imagination. Il faut le dire, à la confusion de ceux qui l’ignoraient tant qu’il a vécu : Villiers est un écrivain, et du plus grand style. Quand il n’embarrasse pas ses phrases d’incidences aux intentions trop profondes, quand il ne prolonge pas trop les ironies sourdes, quand il renonce au plaisir de s’étonner lui-même, c’est un prosateur magnifique, plein d’harmonie et d’éclat. » On ne saurait mieux dire.
Cet auteur participe à la naissance du symbolisme français. Familier de l’irréel, il s’intéresse à l’occultisme. Idéaliste impénitent, le rêve seul l’enchante, nuancé d’une ironie sombre et sachant allier « les deux modes en secret correspondants du rêve et du rire » (Mallarmé). Les jeunes symbolistes saluent leur « initiateur en métaphysique » et le pape du surréalisme, André Breton, l’accueille dans son Anthologie de l’humour noir. Il préfigure même la science-fiction : dans l’Ève déchue, il crée l’« Andréide », réplique des automates d’antan conçue comme la réplique d’un être humain.
« J’irai sous la terre et toi, tu marcheras dans le soleil. »
Arthur RIMBAUD (1824-1891) à Isabelle sa sœur cadette, légataire universelle de son frère mort à 37 ans. Lettre d’Isabelle Rimbaud à leur mère ( juin 1891).
Dans une lettre à sa mère, elle dit de son frère mourant qu’elle dessine : « Ce n’est plus un pauvre réprouvé qui va mourir près de moi. C’est un juste, un saint, un martyr, un élu. » Et elle apprend enfin qu’il a écrit : « Sans les avoir jamais lues, je connaissais ses œuvres ! »
Adolescent fugueur de Charleville, bouleversé à 17 ans par la déclaration de guerre et la répression de la Commune, il chante Le Dormeur du val, jeune soldat surpris par la mort et les communardes sur les barricades, mêlant poésie, révolte, soif de révolution sociale et morale. Le surdoué s’inspire des poètes admirés – Hugo, Baudelaire, Théodore de Bainville – avant d’innover radicalement, visionnaire d’un univers perceptible à lui seul, sacrifiant son intégrité mentale et physique, bouleversant les codes poétiques et sociaux, tout à sa quête mystique. L’auteur des Illumination séduit Verlaine à la folie, mais à 20 ans, n’ayant publié (à compte d’auteur) qu’un seul recueil, les Saisons en enfer, il renonce à écrire. Il a compris l’impuissance des vers à « changer la vie ».
Devenu l’« Homme aux semelles de vent », il projette d’improbables voyages et part marcher à l’aventure jusqu’en Abyssinie. Explorateur et négociant (quincaillerie, bazar, vêtements, café, etc.), son unique « trafic d’armes » sans conséquence politique contribue à sa légende. Il s’épuise sous les soleils exotiques et revient mourir en France, échouant à Marseille, entrant dans la légende noire des poètes maudits. Sa sœur Isabelle va perpétuer sa mémoire et meurt à 57 ans, d’un cancer du genou comme son frère. Son mot de la fin reste un mystère, comme l’essentiel de sa poésie et sa vie même ! Plainte violente et douloureuse, est-ce reproche, gémissement, injonction ?
« Ôtez ce soleil de dessus l’Acropole ! »
Ernest RENAN (1823-1892). La Vie d’Ernest Renan, sage d’Occident (1961) François Millepierres.
Écrivain et philologue (porté sur l’allemand), philosophe et historien, curieux de science à l’image de son temps, il est séduit par les hypothèses de Darwin sur l’évolution des espèces. Une part essentielle de son œuvre se consacre aux religions avec son Histoire des origines du christianisme (7 volumes de 1863 à 1881). Le premier tome, la Vie de Jésus, déchire les milieux intellectuels : cette biographie doit être comprise comme celle de n’importe quel homme et la Bible soumise à un examen critique comme tout document historique. D’où la colère de l’Église encore toute puissante.
En 1865, il part en Égypte, en Asie Mineure et en Grèce : « Je savais bien, avant mon voyage, que la Grèce avait créé la science, l’art, la philosophie, la civilisation ; mais l’échelle me manquait. Quand je vis l’Acropole, j’eus la révélation du divin, comme je l’avais eue la première fois que je sentis vivre l’évangile, en apercevant la vallée du Jourdain des hauteurs de Casyoun. Le monde entier alors me parut barbare. » Prière sur l’Acropole (1865).
Autre texte de référence : Qu’est-ce qu’une nation ? (1882). Renan veut distinguer race et nation. Les nations naissent d’une association volontaire d’individus avec un passé commun : ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ni d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d›« avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore » dans l’avenir. Texte à méditer aujourd’hui encore.
Mais la dernière pensée de l’intellectuel revient à l’Acropole, quand il meurt à 69 ans – diverses affections ont raison de lui, en plus d’un embonpoint à peine exagéré par les caricatures. Reste le sens de ce dernier mot. C’est presque du Rimbaud… et ça s’oppose à son confrère Maupassant.
« Des ténèbres ! Oh ! des ténèbres. »
Guy de MAUPASSANT (1850-1893). Last Words, Last Words… Out ! (2020) Miguel S.Ruiz.
Lié à Flaubert et Zola, cet écrivain et journaliste laisse six romans, notamment Une vie et Bel-Ami, mais surtout ses nouvelles (parfois intitulées contes), dont Boule de Suif et Le Horla. Force réaliste, intervention du fantastique et profond pessimisme, avec une maîtrise stylistique absolue. Reconnu de son vivant, Maupassant reste par les nombreuses adaptations de ses œuvres au cinéma et à la télévision.
Mais il n’a écrit que dix ans (1880 à 1890), avant de devenir quasiment aveugle et de sombrer peu à peu dans la folie, pour mourir à 42 ans. Il se réfugie dans la solitude, avec une peur de la mort et une paranoïa peut-être héritées de sa mère dépressive et de son frère mort fou. La syphilis contractée dans sa jeunesse aggrave la situation, tandis que toutes les consultations et les cures ne changent rien.
La nuit du 1er janvier 1892, il tente de se suicider au pistolet (qui a été déchargé par précaution), casse une vitre pour s’égorger, mais en vain – cela rappelle l’infortuné Chamfort un siècle avant. Il est interné à Paris dans la fameuse Maison (clinique) du docteur Blanche à Passy. Il meurt de paralysie générale après dix-huit mois d’inconscience presque totale, le 6 juillet 1893. Les ténèbres auront finalement raison de toutes ses fêlures et ses fragilités.
D’autres auteurs mourants comme ils ont vécu trouveront un mot de la fin moins dramatique.
« Vous verrez qu’à mon enterrement, je ne pourrai pas aller jusqu’au cimetière. »
Henri MEILHAC (1830-1897). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Il souffre le martyr, cloué au lit par une crise de goutte, mais ce célibataire bon vivant, amateur de bonne chère et de jolies filles a encore le courage de trouver un « mot d’auteur » comme il en a tant fait, pour le bonheur des amateurs de théâtre dit « de boulevard ».
Auteur dramatique, librettiste d’opérettes et d’opéras, Meilhac rencontre Ludovic Halévy en 1860. Ils feront équipe près de vingt ans. Cette division du travail bien rodée donne les livrets des grandes opérettes d’Offenbach : La Belle Hélène (1864), La Vie parisienne (1866), La Grande-duchesse de Gérolstein (1867) et La Périchole (1868), sans oublier l‘opéra-comique mondialement célèbre de Bizet, Carmen (1875).
Henri Meilhac apportait en propre une fantaisie irrésistible, frôlant la loufoquerie. Gagnant beaucoup d’argent, il en dépensait tout autant, cherchant l’inspiration dans les restaurants mondains, les cigares et le champagne. La vie parisienne a beaucoup fait pour l’art et les artistes de l’époque.
« Je meurs vraiment au-dessus de mes moyens. »
Oscar WILDE (1854-1900), mourant et ruiné, recevant la note de frais de son médecin. Dictionnaire amoureux de l’Humour (2012), Jean-Loup Chiflet.
Écrivain, romancier, auteur dramatique et poète irlandais, mort à Paris le 30 novembre 1900.
Après ses études, il s’installe à Londres où il parvient à s’insérer dans la bonne société et les cercles cultivés. Au faîte de la gloire, alors que sa pièce maîtresse L’Importance d’être constant (1895) triomphe à Londres, il poursuit le père de son amant Alfred Douglas pour diffamation - il a entrepris de faire scandale sur son homosexualité. Au terme de trois procès retentissants, Oscar Wilde est condamné pour « grave immoralité » à deux ans de travaux forcés !
Ruiné, il écrit en prison De Profundis, longue lettre à son amant dont la noirceur contraste avec sa philosophie affichée du plaisir. Libéré en mai 1897, accueilli en France, il achève La Ballade de la geôle de Reading (1898), long poème sur l’expérience destructrice de la vie en prison. L’homme jadis fêté meurt dans le dénuement, âgé de quarante-six ans.
« On ne peut même pas compter sur la mort ! »
Jean MORÉAS (1856-1910) alors que son agonie se prolonge. Les Mots de la fin (1957), Claude Aveline.
Né à Athènes, fils de magistrat, Moréas reçoit une éducation française et vient à Paris en 1875 pour faire ses études de droit. Il fréquente les cercles littéraires, notamment les Hydropathes – étymologiquement, ceux que l’eau rend malades.
Il publie ses premiers recueils poétiques, Les Syrtes (1884) et Cantilènes (1886). Inspirés de Verlaine, ils pourraient se rattacher au mouvement décadent si l’auteur ne revendiquait pas l’étiquette « symboliste ». Mais il se détourne du symbolisme pour rompre avec l’hermétisme, opposant à l’obscurité et aux brumes du nord la lumière du monde gréco-latin. Il rompt ensuite avec ce « romanisme » pour épouser le néo-classicisme. Son recueil le plus célèbre, Stances (1899), illustre cette nouvelle ambition, dans une langue d’une pureté classique qui rappelle André Chénier. Éternel retour…
« Marinette ! Pour la première fois, je vais te faire une grosse, une très grosse peine. »
Jules RENARD (1864-1910). Tout sur tout : Petit dictionnaire de l’insolite et du sourire (1986), Claude Gagnière
Marinette, épouse fidèle et bien aimée – mais détestée des « renardiens », ayant détruit des passages du Journal comme bien des « veuves abusives » usant et abusant de leur droit moral pour respecter l’image souhaitée du défunt.
Cruel observateur de la société, Jules Renard n’épargne personne, pas plus le monde littéraire auquel il appartient en marginal assumé, que celui des ouvriers et de la misère qu’il critique en connaissance de cause. Il a vécu pauvrement, et surtout malheureux, dans la peau de Poil de carotte, roman autobiographique d’un enfant martyr à force d’être mal aimé, mais qui lui apporta finalement le succès et l’argent.
« Tirez, tirez, nom de… »
Charles PÉGUY (1872-1914) dans l’attaque qui précède la bataille de la Marne, 5 septembre 1914. Les Mots de la fin (1957), Claude Aveline.
Debout, exhortant sa compagnie à ne pas céder un pouce de terre française à l’ennemi, il vient de commander le tir à volonté, tandis que ses hommes le supplient de se coucher. Il tombe, tué d’une balle en plein front. Selon un de ses camarades de combat, il aurait eu le temps de murmurer : « Oh mon Dieu, mes enfants… »
Déclaré « mort pour la France », il a fini en militaire, mais Péguy reste comme auteur, poète, intellectuel engagé et chrétien écorché vif. L’humaniste souffrit plus que nul autre de la politique politicienne née sous la Troisième République, témoignant à la fois contre le matérialisme du monde moderne, la tyrannie des intellectuels de tout parti, les manœuvres des politiques, la morale figée des bien-pensants.
Rejeté de tous les groupes constitués parce que patriote et dreyfusard, socialiste et chrétien, suspect à l’Église comme au parti socialiste, isolé par son intransigeance et ignoré jusqu’à sa mort du grand public, c’est l’un des rares intellectuels de l’époque échappant aux étiquettes.
« Sauvez-moi, docteur ! Je veux vivre, j’ai tant à faire ! »..
Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Derniers mots, ultime prière du « poète combattant » de la Grande Guerre, grièvement blessé au combat, trépané, très affaibli et mort de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, deux jours avant la signature de l’armistice. En raison de son engagement durant la guerre, il est déclaré mort pour la France.
Il publie en 1913 Alcools, recueil de 50 poèmes (écrits de 1898 à 1913). Résumons les trois premiers : Zone, dernier écrit, met à l’honneur le Paris moderne à l’époque de la seconde révolution industrielle. Le Pont Mirabeau, sur le thème de l’eau, aborde le temps qui passe et son amour parti. L’image du pont symbolise le lien entre passé et présent, et les amours (ici avec Marie Laurencin). La Chanson du mal aimé détaille la vie sentimentale du poète souffrant de ne pas être aimé à sa juste valeur, inspiré par l’échec de sa relation avec une gouvernante anglaise, Annie Playden.
MAIS… si doué, si attachant soit-il, Apollinaire (né Polonais) usait et abusait comme presque tous ses confrères parisiens de « cocktails carabinés », mélanges explosifs d’origine norvégienne : décoction de viande dans du stout ou du porto, grog d’absinthe et de jus de citron mélangé par moitié de genièvre. L’absinthe, la « fée verte », alcool bon marché titrant plus de 70°, fit tant de ravages dans le peuple qu’ont l’interdit en 1915. Ses deux plus célèbres victimes, incontestables génies : le peintre Van Gogh mort fou et suicidé, Verlaine le poète (ami de Rimbaud), autre « mal aimé » dont la femme battue finit par fuir le domicile conjugal avec leur fille recueillies par Hugo. « Faits divers » inadmissibles un siècle après.
« C’est un peu tôt ! Vous auriez dû me prévenir. »
Edmond ROSTAND (1868-1918). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
De santé fragile, il meurt à 50 ans de la grippe espagnole qui fit plus de victimes que la Grande Guerre !
Son mot de la fin n’est pas sans panache, rappelant les derniers mot de Cyrano (1897), pièce qui l’a rendu célèbre avec le grand Coquelin dans le rôle-titre. Il doit aussi beaucoup à Sarah Bernhardt, star du théâtre français qui a créé l’Aiglon en 1900 - elle incarne en travesti et à plus de 50 ans le fils de Napoléon, jeune prince mort de tuberculose à 21 ans.
Rostand cesse d’écrire après l’échec (relatif) de Chantecler (1910). Patriote, il veut s’engager en 1914, mais c’est impossible en raison de son âge et de son état physique. Poète national adulé, il en fut profondément blessé, mais il s’engagera à sa façon, soutenant activement les Poilus qu’il va visiter sur le front, écrivant des lettres aux soldats, multipliant les textes patriotiques.
« Maman ! »
Anatole FRANCE (1844-1924). Petit dictionnaire de l’insolite et du sourire, Tout sur tout (1986), Claude Gagnière
Bien qu’âgé de 80 ans, l’un des écrivains les plus célèbres sous la Troisième République et la conscience de son temps murmura plusieurs fois le plus beau nom pour un enfant : « Maman ! » tout simplement précédé de … « C’est donc cela, mourir, c’est bien long ! »
« Maman » fut le dernier mot attribué à Jules de Goncourt, Marcel Proust, le peintre Toulouse-Lautrec, le compositeur Moussorgsky … et sans doute nombre de mourants sans témoins. Restent tous ceux qui l’ont pensé sans le dire.
« Oh ! je m’ennuie déjà. »
Francis de CROISSET (1877-1937) à sa femme. Brutales (1993), Philippe Cousin.
Auteur dramatique, romancier et librettiste « bien français » - quoique juif, né belge et d’origine allemande - tout ce qu’il sut faire oublier pour s’intégrer à la société parisienne de son temps avec talent. Il recherchait le scandale avec des comédies d’une audace calculée, devenant omniprésent dans la presse du temps par son œuvre et sa vie privée. La « com » a toujours existé, le théâtre en a profité plus que tout autre genre. Élégant, brillant et mondain, il inspire à Marcel Proust un personnage d’À la recherche du temps perdu.
Reste à signaler un petit chef d’œuvre du genre : Ciboulette, opérette en 3 actes et 4 tableaux, co-écrite avec Robert de Flers, musique Reynaldo Hahn, Théâtre des Variétés, 7 avril 1923.
« … Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux. »\
Stefan ZWEIG (1881-1942), Pétropolis (au Brésil), 22 février 1942, derniers mots de sa lettre d’adieu. Petropolis 1942 Ou la Dernière Nuit de Stefan Zweig (2006), Alain Pastor.
Juif né à Vienne, il représente l’élite viennoise fin-de-siècle. Il réussit dans tous les genres (roman, théâtre, nouvelle, essai, biographie), mais la montée du nazisme va tout détruire. Conscient du danger que représente Hitler plus tôt que la plupart de ses amis, il quitte l’Autriche pour l’Angleterre, avant d’être accueilli par le Brésil.
Désespéré par les nouvelles et les ravages de la guerre, inconsolable d’avoir perdu le « Monde d’hier » avec l’échec de la civilisation et la fin de l’âge d’or, dépressif dit-on (mais on le serait à moins…), il décide de s’empoisonner au véronal. Son épouse ne veut pas lui survivre. Le lendemain, le couple est retrouvé sans vie, main dans la main, avec cette lettre simple et bouleversante :
« Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j’éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m’a procuré, ainsi qu’à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j’ai appris à l’aimer davantage et nulle part ailleurs je n’aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l’Europe, s’est détruite elle-même. Mais à soixante ans passés, il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Les miennes sont épuisées par les longues années d’errance. Aussi, je pense qu’il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. »
« Foutaise ! »
Paul VALÉRY (1871-1945). Secrètes araignées (1996), André Brincourt.
« Un mot de pierre brute pour démolir tous les mots en stuc. » Rappelons l’un des plus connus : « Le temps du monde fini commence. » Regards sur le monde actuel (1931). « Espèce de poète d’État » (dit-il de lui-même), croulant sous les honneurs, il fut toujours lucide au monde. Dès 1919, la paix revenue, il lançait déjà ce cri d’alarme qui trouve un grand écho : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. »
Finir sur ce « Foutaise ! » peut être une manière de prendre distance avec tout, y compris lui-même…
« Vous essayez de me garder en vie comme un vieil objet de curiosité, mais je suis fini, je suis à bout, je vais mourir. »
Georges-Bernard SHAW (1856-1950) à son infirmière. Les Mots de la fin (1957), Claude Aveline.
Né en Irlande et mort en Angleterre, critique musical, dramaturge, scénariste, essayiste, acerbe et provocateur, pacifiste et anticonformiste, il obtient le prix Nobel de littérature en 1925. Militant politique séduit par le marxisme, il continue sa carrière d’auteur tout terrain, se marie, mais doit restreindre son activité pour cause de surmenage et renoncer à sa vie de bohème – à l’inverse d’autres talents ou génies. Il n’en reste pas moins actif et meurt à 94 ans des suites d’une mauvaise chute, refusant tout acharnement thérapeutique.
« J’ai peur que mes phrases ne deviennent grammaticalement incorrectes. C’est toujours la lutte entre le raisonnable et ce qui ne l’est pas… »
André GIDE (1869-1951). Mes étoiles – les rencontres qui ont éclairé mon chemin (2018). Michaël Lonsdale.
Les honneurs pleuvent sur le Gide d’après-guerre, maître à penser de sa génération, prix Nobel de littérature en 1947 pour son « intrépide amour de la vérité ». Il a rompu avec le communisme en 1937 (au retour de son voyage en URSS) et vécu la guerre comme une apocalypse (abandonnant la NRF et quasiment l’écriture, se repliant sur la Côte d’Azur, puis en Afrique du Nord).
Désormais, il ne songe plus qu’à sauver la culture de toute menace de totalitarisme et contrairement à Sartre, il ne croit pas que la littérature doive être politiquement engagée.
Malade despotique entouré de ses fidèles, victime d’une congestion pulmonaire à 81 ans, il s’achemine finalement vers une mort calme, dénuée d’angoisse et sans le sursaut religieux que certains guettaient toujours. Son mot de la fin demeure définitivement hermétique… Reste l’autre mot repris officiellement en titre par Roger Stéphane pour sa chronique éditée en 1989 : « Tout est bien ».
« Enfer n’existe pas. Stop. Donne-toi du bon temps. Stop. Préviens Claudel. »
André GIDE ( 1869-1951), télégramme reçu par Roger Nimier qui l’envoie à François Mauriac quelques jours après la mort de son « auteur ». Dieu est humour, tome 2 (2011) Bernard Peyrous, Marie-Ange Pompignoli.
Post-scriptum post mortem ? Rappelons que Gide et Mauriac vécurent douloureusement le conflit entre la morale religieuse et leur penchant homosexuel (plus caché, côté Mauriac toujours inquiet de son propre salut). Quant à Claudel, lui aussi très chrétien et torturé de nature (mais génial), c’est un autre cas.
En fait, ce télégramme mis en vente à l’hôtel Drouot et qui fit beaucoup parler… est un canular dû à Roger Nimier ou à Anne-Marie Cazalis (journaliste et poète, vedette des nuits parisiennes à Saint-Germain-des-Prés).
« Qu’on me laisse tranquille ! Je n’ai pas peur. »
Paul CLAUDEL (1868-1955). La Croix du 24 février 1955, La mort de Paul Claudel.
Claudel s’est converti au catholicisme, touché par la grâce aux vêpres de Noël 1886. « J’étais debout, près du deuxième pilier, à droite, du côté de la sacristie. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. En un instant mon cœur fut touché et je crus. »
Sa vie en fut changée, mais le personnage reste contradictoire entre tous, admiré pour son œuvre théâtrale passionnément lyrique et mystique (Le Soulier de satin, L’Annonce faite à Marie…) autant que détesté, accusé de tous les conservatismes et tous les aveuglements (y compris pendant la Seconde guerre), frère attentif ou indifférent au drame de sa sœur Camille Claudel internée comme folle. Élu à l’Académie française en 1946, sans concurrent, à presque quatre-vingts ans, « l’âge de la puberté académique » dit-il, Claudel n’avait effectué aucune des visites rituelles, ni même fait acte de candidature.
« Maintenant, foutez-moi la paix ! »
Paul LÉAUTAUD (1872-1956). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Personnage atypique, plus sincère que sympathique, original assurant parfaitement son emploi dans ou hors le milieu littéraire. Il quitte l’école à 15 ans, exerce des petits boulots pour vivre, s’éduque en lisant tard le soir les grands auteurs – mais il rejette la philosophie, le romantisme, n’aime pas les romans contemporains (ni Proust, ni Céline), se méfie des poètes. Il restera toujours fermé à la musique, la peinture, la science.
Connu confidentiellement du milieux littéraires, ses entretiens radiophoniques avec Robert Mallet le rendent célèbre en 1950 ! Il publie peu, détestant la « littérature alimentaire ». Solitaire et misogyne, recueillant les animaux abandonnés dans son pavillon de Fontenay-aux-Roses et vivant pauvrement, il se consacre à son Journal : « Je n’ai vécu que pour écrire. Je n’ai senti, vu, entendu les choses, les sentiments, les gens que pour écrire. J’ai préféré cela au bonheur matériel, aux réputations faciles. J’y ai même sacrifié mon plaisir du moment, mes plus secrets bonheurs et affections, même le bonheur de quelques êtres, pour écrire ce qui me faisait plaisir à écrire. Je garde de tout cela un profond bonheur. »
Le 21 janvier 1956, sentant ses forces diminuer, il noie sa guenon Guenette pour qu’elle ne soit malheureuse et confie à des amis les chats qui lui restent, quitte son pavillon pour s’installer dans une maison de santé. Il meurt un mois plus tard, sur un dernier mot qui lui ressemble.
« Ils n’ont vraiment pas l’air d’Américains ! ».
Boris VIAN (1920-1959) à un ami, 23 juin 1959, cinéma le Marbeuf aux Champs-Élysées, projection privée. Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Il meurt d’une (dernière) crise cardiaque au début de la projection de J’irai cracher sur vos tombes, tiré de son roman à succès et scandale (signé d’un pseudo, Vernon Sullivan). Les producteurs ont refusé son adaptation, il craint le pire et les premières images le mettent hors de lui : l’interprétation vaut trahison. Voyant son nom au générique, malgré sa volonté et contre son droit moral d’auteur, il se lève pour sortir de la salle et retombe, mort. Il avait 39 ans.
Écrivain, poète, chroniqueur, nouvelliste, scénariste, parolier, chanteur, critique musical, directeur artistique, traducteur (anglais, américain), conférencier, à l’occasion acteur, peintre et dessinateur, inventeur, mais aussi trompettiste de jazz connu dans les clubs de Saint-Germain… et ingénieur formé à l’École centrale.
Doué en tout, Boris Vian a vécu tant de vies, sachant que la sienne serait brève. Il est mort à 39 ans, comme Blaise Pascal, autre surdoué en tout (mais pas dans le même genre). Présumé pessimiste, Vian s’amusait de tout, adorait faire la fête chaque nuit à Saint-Germain-des-Prés avec sa bande de copains, contraint à travailler chaque jour pour gagner sa vie, bien conscient qu’il a « un pied dans la tombe et l’autre qui ne bat que d’une aile. »
Il fait une carrière posthume. Les jeunes adorent L’Écume des jours, roman devenu un classique de la littérature, étudié dans les collèges et lycées. Ses chansons attirent de bons interprètes, mais la voix de l’auteur continue de chanter Le Déserteur, Je bois, Je suis snob, On n’est pas là pour se faire engueuler, la Java des bombes atomiques.
« Pas de médecin ! Pas de piqûre ! Pas d’hôpital. »
Louis-Ferdinand CÉLINE (1894-1961). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Auteur sulfureux, considéré comme un génie qui révolutionne la littérature à l’égal de Proust, médecin des pauvres en banlieue, engagé à l’extrême droite, mais surtout égaré par sa haine des juifs, il meurt à 67 ans dans sa villa de Meudon, petit pavillon vieillot. Selon son souhait, ses rares amis tiennent sa mort secrète et Lucette Destouches (sa femme) obéit à sa promesse, n’avertir personne, mais elle n’avait même pas compris qu’il était mort…
« C’est une interminable corvée. »
André MALRAUX (1901-1976). André Malraux, l’hommage de Strasbourg, le Blog-Notes, 20 novembre 2006, Robert Grossmann.
Témoin et acteur de son siècle, il appartient à la dernière grande génération d’écrivains français faisant rimer aventure et littérature : Malraux et Montherlant, Camus et Saint-Exupéry, Sartre et Aragon, d’autres noms encore, chacun suivant un itinéraire personnel. Malraux a traversé le siècle, de l’aventurier (plus ou moins) mythomane au gaulliste politiquement engagé sur tous les fronts, depuis la Seconde guerre au ministère de la Culture créé pour lui.
Le professeur Bertagna le rassurait à propos de meilleurs examens du laboratoire : « C’était déjà dans Courteline », dit-il douloureusement ironique. Sa grande amie Sophie (Louise) de Vilmorin lui demanda juste avant qu’il ne sombre dans le coma : « Souffrez-vous ? » Il répondit : « C’est une interminable corvée… » Terrible leçon de mort de celui qui tenta sa vie durant de juguler et de défier le destin.
« Je vous aime beaucoup, mon petit castor. »
Jean-Paul SARTRE (1905-1980), mourant à l’hôpital Broussais de Paris. Sartre et Beauvoir, La farce des choses (2019), Emmanuel Hecht
(Castor est le surnom donné à son amie Simone en 1929 par un professeur de philosophie attaché culturel à Londres, en pensant à beaver, castor en anglais, qui se prononce presque comme Beauvoir).
Sartre et Beauvoir ont formé un couple célèbre, (très) libre dans leurs amours respectives, mais très unis dans leurs engagements politiques. Ils fondent avec d’autres intellectuels de gauche la revue des Temps Modernes pour faire connaitre l’existentialisme, le courant philosophique qu’ils défendent. Elle refusera le mariage par principe, une institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution lorsque la femme est sous la domination de son mari et ne peut en échapper. Il la soutient dans son féminisme et c’est lui qui a trouvé le titre du Deuxième sexe.
Il part le premier, malade depuis longtemps, presque aveugle, toujours actif, jusqu’à l’œdème pulmonaire. Elle lui survit, toujours très droite dans ses bottes imaginaires, de plus en plus raide et fidèle à elle-même, enturbannée sur toutes ses photos. Ils seront réunis dans la même tombe.
« Au journal ! »
Raymond ARON (1905-1983). Les Mots de la fin, 200 adieux historiques (2017), Catherine Guennec.
Le philosophe quittant le palais de Justice où il a témoigné dans un procès doit se rendre au plus vite dans les bureaux de l’Express. Il se précipite dans sa voiture et lance l’ordre au chauffeur - avant de s’écrouler sur la banquette arrière. À 78 ans, c’est toujours la même passion du métier. Sociologie, historien, politologue… et journaliste, il reste connu surtout pour son antagonisme intellectuel avec le maître à penser de l’époque, Jean-Paul Sartre.
Le 17 octobre 1983, le journaliste et politologue Raymond Aron mourait d’une crise cardiaque en quittant le palais de justice de Paris. Résistant pendant la dernière guerre, l’auteur de L’opium des intellectuels se fera promoteur du libéralisme et très critique face au mouvement pacifiste, bienveillant à l’égard des régimes communistes. Le politologue aura influencé des penseurs tels que Pierre Bourdieu ou encore André Glucksmann.
« Il doit bien y avoir un paradis quelque part. »
Marguerite YOURCENAR (1903-1987). Yourcenar, carte d’identité (2016), Henriette Levillain.
En tout cas, c’est la première immortelle élue à l’Académie française en 1980, avec la bénédiction du très féministe et souriant Jean d’Ormesson.
Célèbre en 1951 par ses Mémoires d’Hadrien (prix Femina), puis par L’Œuvre au Noir (1968), Marguerite Yourcenar est classée de son vivant parmi les grands écrivains français classiques : érudite, impersonnelle, maîtrisée jusqu’à l’excès dans le style et les passions, académique avant l’heure. Une autre femme se révèle, à travers ses œuvres intimes, Mémoires, Correspondances, essais. Entre ironie et attendrissements, orgueil et humilité, pessimisme grandissant et idéal de bonté, misogynie évidente et homosexualité affichée.
Elle quitte l’Europe en 1939, pour fuir la guerre et retrouver aux États-Unis la femme de sa vie, Grace Frick, professeur de littérature britannique à New York, rencontrée par hasard à Paris, hôtel Wagram, deux ans avant. Grace renonce à sa carrière universitaire, soutient financièrement et psychologiquement Marguerite, traduit son œuvre en anglais. Le couple s’installe en 1950 sur l’île des Monts Déserts, dans le Maine. Grace organise leur vie (entre l’écriture de Marguerite et ses longs voyages) et doit toujours rassurer sa compagne hypocondriaque, sujette à dépression. Elle meurt d’un cancer du sein en 1979. Marguerite Yourcenar vivra ensuite avec le jeune réalisateur américain Jerry Wilson, son dernier secrétaire et compagnon mort du sida en 1986. Solitaire et secrète, elle meurt le 17 décembre 1987 sur ce mot d’espoir : « Il doit bien y avoir un paradis quelque part. »
Lire la suite : les Mots de la fin des artistes et scientifiques.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.