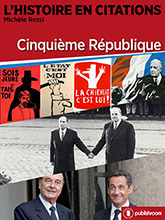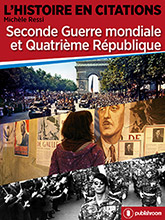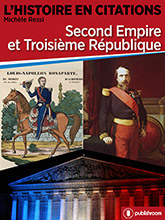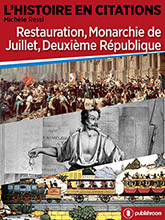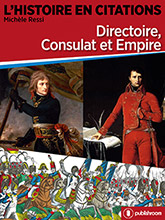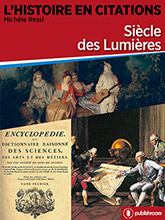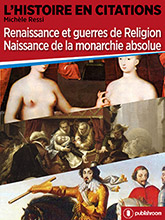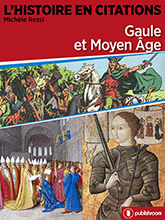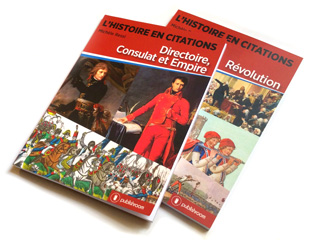« J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. »
Charles BAUDELAIRE (1821-1867). Le Spleen de Paris (recueil posthume de poèmes en prose, 1869)
Les mystères ont défrayé la chronique en leur temps, nourris par la rumeur - bien avant la presse, les réseaux sociaux et toutes les « autoroutes de la désinformation » !
Petits et grands mystères alternent, souvent associés à des Affaires majuscules - des Templiers à l’Affaire Dreyfus. Tant de fois commentées, souvent fascinantes, elles sont un vivant reflet de leur époque, mais aussi de « l’âme humaine » qui ne varie guère.
Certains mystères sont aujourd’hui résolus – l’épidémie de peste noire, le Collier de la Reine, l’Affaire du Rainbow warrior. D’autres demeurent – l’assassinat d’Henri IV, l’énigme du Masque de fer et l’Affaire des poisons au siècle de Louis XIV, l’affaire du petit Grégory de nos jours.
Quelques personnages restent à jamais (et volontairement) mystérieux - du roi Philippe le Bel à François Mitterrand, en passant par le marquis de Sade… et de Gaulle : « La grandeur a besoin de mystère. On admire mal ce qu’on connaît bien. » Quant à Molière, objet des pires fake-news de son temps, sa vie comporte toujours certains mystères.
De nos jours, les « affaires » se multiplient, le journalisme d’investigation devient un genre prospère et les procès font la une des médias. Faut-il y voir un progrès dans la justice, la « transparence » et la démocratie, ou une dérive sociétale dangereuse ?
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
SIÈCLE DE LOUIS XIV
La Fronde contre Mazarin et les mazarinades : toutes les rumeurs courent. Qu’importe, pourvu qu’ils paient…
« Qu’ils chantent, pourvu qu’ils paient. »759
MAZARIN (1602-1661). Dictionnaire de français Larousse, au mot « payer »
Un impôt de plus, des relations supposées avec la reine, une impopularité grandissante, tout sera occasion de mazarinade (pamphlet) contre le principal ministre d’État, mais Mazarin se moque de ces chansons et de ceux qui les chantent. Il bravera toutes les formes d’opposition, gardant et renforçant son pouvoir jusqu’à sa mort.
La Fronde reste quand même la pire épreuve : une guerre civile de cinq ans qui mène la France au bord de la ruine et de la révolution.
« Un vent de Fronde
S’est levé ce matin
Je crois qu’il gronde
Contre le Mazarin. »744Paul scarron (1610-1660), mazarinade. Poésies diverses : la mazarinade, Virgile travesti, roman comique
Tout-puissant ministre, Mazarin est l’homme d’État le plus durement chansonné de l’histoire de France, durant la Fronde et Paul Scarron, le principal auteur osant signer ses mazarinades. Celle-ci, selon d’autres sources, est également attribuée à Barillon l’aîné.
Le coup de force du Parlement de Paris, exploitant la crise financière et le mécontentement général, a mis le feu aux poudres. Car les causes du mouvement sont profondes, à la fois politiques, économiques, sociales.
Sous la régence d’Anne d’Autriche et sur fond de guerre étrangère avec l’Espagne, la France fragilisée, Paris en tête, se déchaîne dans un tourbillon révolutionnaire où les parlements, le peuple et les Grands se relaient. La cible numéro un est le cardinal au pouvoir, l’amant (supposé) de la Reine, l’Italien (naturalisé), le parvenu (enrichi), l’homme à abattre : Mazarin.
« Il est des occasions où le meilleur moyen de servir les princes, c’est de leur désobéir. »773
Pierre BROUSSEL (1575-1654). L’Éloquence politique et parlementaire en France avant 1789 (1882), Charles Aubertin
Conseiller au Parlement de Paris, le plus en vue des meneurs est arrêté le 26 août 1648, sur l’ordre d’Anne d’Autriche. Ce coup d’autorité, qui vient en fait de Mazarin, déclenche un soulèvement populaire.
Richelieu a dit, parlant de Paris : « N’éveillez pas cette grosse bête. » La chose est faite et malgré la libération de Broussel et des deux autres meneurs arrêtés, le 29 août 1648, la Fronde parlementaire commence.
« Point de paix, point de Mazarin ! Il faut aller à Saint-Germain quérir notre bon Roi ; il faut jeter dans la rivière tous les mazarins. »781
Cris du peuple de Paris assiégé, début mars 1649. Mémoires du Cardinal de Retz (posthume, 1717)
Des pourparlers de paix s’engagent entre la cour (à Saint-Germain) et le Parlement de Paris.
Mais il y a des opposants irréductibles, une part du peuple se soulève, neutralise les échevins et les magistrats fidèles au roi (les « mazarins »). Cependant que les Grands deviennent le « piètre état-major d’une révolution incertaine » (Georges Duby). On retrouve le duc de Beaufort (le roi des Halles refaisant le coup de la Cabale des Importants), l’inévitable de Retz (porté par son ambition politique et bientôt perdu par ses propres subtilités), le prince de Conti – « un zéro qui ne multipliait que parce qu’il était prince du sang », selon de Retz – et la belle duchesse de Longueville (frère et sœur du Grand Condé qui se bat dans le camp du roi). Tout ce beau monde se querelle ou s’aime, intrigue, hésite, fanfaronne, enchaîne les volte-face et s’étonne de tant d’audace.
Les nouvelles des révolutionnaires de Cromwell vont terrifier les plus rebelles : ils ont osé exécuter le roi Charles Ier d’Angleterre ! Le président du Parlement de Paris, Molé, signe alors la paix de Rueil, le 11 mars 1649 : au prix de concessions mutuelles, c’est la fin (provisoire) de la Fronde parlementaire.
« Après ton compte rendu
Cher Jules, tu seras pendu
Au bout d’une vieille potence,
Sans remords et sans repentance. »787Paul SCARRON (1610-1660), mazarinade. Poésies diverses : la mazarinade, Virgile travesti, roman comique
Le ministre est aussi accusé de « rapine publique, fausse politique et sot gouvernement ». Mais il tient bon.
La Fronde des princes, qui s’essouffle dans ses querelles de personnes, va s’unir, fin 1650, à un nouvel accès de Fronde parlementaire, pour réclamer le départ du ministre. Le 7 février 1651, le duc de Beaufort soulève les Halles, bloque la reine au Palais-Royal.
Mazarin juge prudent de s’exiler pour un temps en Allemagne, cependant que de loin, il conseille la reine. À Paris, en mars, une assemblée de représentants de la noblesse et du clergé demande la réunion des États généraux, mais Parlement, bourgeois et princes y sont hostiles et l’assemblée se disperse. Les frondeurs recommencent à se quereller.
« Faut sonner le tocsin, din-din
Pour pendre Mazarin. »793La Chasse donnée à Mazarin, chanson. Bulletin de la Société de l’histoire de France (1835), Renouard éd
« Prendre » est devenu « pendre » ! Le Parlement de Paris, qui l’a banni en janvier 1649, met sa tête à prix en décembre 1651 : 50 000 écus, payables par la vente de sa bibliothèque et ses collections (471 tableaux de maître référencés à sa mort). Mazarin, confondant parfois ses affaires et celles de l’État, a déjà accumulé une immense fortune.
Le cardinal a de nouveau pris la fuite avec la reine et rejoint le jeune roi à Poitiers. Le Parlement envoie des émissaires dans les provinces, tente de les soulever contre Mazarin, mais nul ne bouge. Turenne, à la tête de l’armée royale, bat Condé qui a recruté de son côté une armée espagnole.
Condé se réfugie dans Paris (avril 1652), ses partisans y font régner la terreur. La Grande Mademoiselle (fille du Grand Monsieur, Gaston d’Orléans) se lance dans la Fronde à cœur perdu.
« Ce sont des Mazarins, faites-en ce que vous voudrez ! »794
Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand CONDÉ (1621-1686) à ses soldats, 4 juillet 1652. Mémoires de Valentin Conrart (posthume, 1826)
C’est un contemporain qui témoigne, homme de lettres beaucoup plus discret que de Retz, se contentant d’être l’un des premiers Académiciens, et secrétaire perpétuel de 1635 à sa mort, en 1675.
Parlement et bourgeois de Paris sont réticents, mais les partisans de Condé manœuvrent les milieux populaires, exploitent leur haine contre Mazarin et entretiennent un climat de terreur, depuis quelques mois.
Le 2 juillet, Turenne bat de nouveau Condé, mais la Grande Mademoiselle le sauve en faisant tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales et sur Turenne ! Une anarchie sanglante s’ensuit : le 4 juillet, Condé laisse massacrer les « Mazarins » (magistrats et bourgeois de Paris), tandis que l’incendie dévaste l’Hôtel de Ville et le palais Mazarin. C’est la « journée des Pailles ». Mazarin fuit cette fois à Cologne. D’où il dirige la France, par lettres à la reine.
« Tel qui disait : « Faut qu’on l’assomme ! »
Dit à présent : « Qu’il est bon homme ! »
Tel qui disait : « Le Mascarin !
Le Mazarin ! Le Nazarin ! »
Avec un ton de révérence
Dit désormais : « Son Éminence ! » »795Pamphlet pour Mazarin (1652). Histoire de la Bibliothèque Mazarine depuis sa fondation jusqu’à nos jours (1860), Alfred Franklin
Juste retour des choses. La France est à bout de souffle et Paris se lasse de tant d’excès, après la journée des Pailles et le massacre qui s’ensuit. Les bourgeois deviennent hostiles à Condé qui fuit à son tour aux Pays-Bas espagnols – la Belgique actuelle.
Cependant que les marchands de Paris et les officiers de la garde bourgeoise rappellent le jeune roi qui rentre – définitivement cette fois, et triomphalement ! Le 21 octobre 1652, Louis XIV s’installe au Louvre.
Mazarin, rappelé par le roi et la reine mère, rentre à son tour. L’opinion s’est complètement retournée.
« Louis XIV le reçut comme un père et le peuple comme un maître. »796
VOLTAIRE (1694-1778) évoquant le retour de Mazarin, 3 février 1653. Le Siècle de Louis XIV (1751), Voltaire
C’est la fin de la Fronde. Le roi, majeur depuis deux ans, va laisser le cardinal gouverner la France jusqu’à sa mort, en 1661. Il va apprendre son royal métier auprès de son Premier ministre et tuteur.
Mais la Fronde lui servira de leçon.
« Ces agitations terribles avant et après ma majorité, une guerre étrangère où les troubles domestiques firent perdre à la France mille et mille avantages, un prince de mon sang et d’un très grand nom [Condé] à la tête de mes ennemis. »797
LOUIS XIV (1638-1715), Mémoires pour l’instruction du Dauphin (1662)
Jamais le roi n’oubliera l’humiliation et l’insécurité de sa jeunesse ! Le souvenir de la Fronde commande et explique bien des aspects de sa politique intérieure.
La France n’oublie pas non plus le bilan désastreux de cette guerre civile, aggravée par la guerre étrangère et l’appui des Espagnols aux rebelles : famines et pestes endémiques ont fait mourir dans la seule année 1652 un quart de la population, dans certains villages en Île-de-France, Champagne et Picardie ! Le commerce extérieur est désorganisé, la marine ruinée. Le pays doit penser : tout plutôt que cette anarchie. Il est prêt pour une monarchie absolue.
Dès son retour, Mazarin rétablit les intendants, incarnation du pouvoir royal et gage de l’ordre sur tout le territoire. Gaston d’Orléans est exilé à vie dans son château de Blois. Et Condé, condamné à mort (par contumace) par le Parlement, passe au service de l’Espagne.
L’affaire du Masque de fer : des Noms circulent, à commencer par Fouquet, entre autres rumeurs les plus folles. Mais le mystère demeure.
« Quo non ascendet ? »
« Jusqu’où ne montera-t-il pas ? »858Nicolas FOUQUET (1615-1680), devise figurant dans ses armes, sous un écureuil
Il monta si haut… que le roi ne put le tolérer.
Fils d’un conseiller au Parlement, vicomte de Vaux, enrichi par le commerce avec le Canada, Nicolas Fouquet achète la charge de procureur général au Parlement de Paris, devient ami de Mazarin, surintendant des Finances, s’enrichit encore, se paie le marquisat de Belle-Isle, y établit une force militaire personnelle et même des fortifications. Au château de Vaux-le-Vicomte qu’il fait construire, il sera le mécène des plus prestigieux artistes du temps : La Fontaine, Molière, Poussin, Le Vau, Le Brun.
Colbert, qui brigue sa place, apporte la preuve qu’une telle fortune fut acquise au prix de graves malversations. Invité à une fête somptueuse à Vaux, 5 septembre 1661, Louis XIV fait arrêter son surintendant.
« La chute de ce ministre [Fouquet] à qui on avait bien moins de reproches à faire qu’au cardinal Mazarin, fit voir qu’il n’appartient pas à tout le monde de faire les mêmes fautes. »859
VOLTAIRE (1694-1778), Le Siècle de Louis XIV (1751)
Richelieu avant Mazarin et Colbert après Fouquet ont aussi profité de leur place dans l’État pour s’enrichir. Mais Fouquet voulut éblouir le roi qui voulait seul éblouir le monde.
Son arrestation est le premier acte politique du règne : Louis XIV prenant ainsi le pouvoir surprend tout son entourage.
Au terme d’un procès de trois ans, plein d’irrégularités, Nicolas Fouquet est condamné pour abus, malversations et lèse-majesté, à la confiscation de ses biens et au bannissement - peine que Louis XIV transforme en prison perpétuelle. Il est enfermé à la forteresse de Pignerol. La date et les circonstances de sa mort restent un mystère – il est l’un des possibles « masques de fer ». Ce prisonnier d’exception sera traité avec tous les égards dus à un homme de haut rang, mais n’aura jamais le droit de parler ni d’ôter son masque devant quiconque.
« Un homme de haute taille, dont un masque noir cache le visage, un homme qui attend, et qui se tait. »14
Marcel PAGNOL (1895-1974), Le Secret du Masque de fer (1973)
Le 19 novembre 1703, au terme d’une longue captivité, est mort à la Bastille un prisonnier dont nul ne connaissait le nom ni le motif de l’incarcération.
Autre candidat au rôle, selon Voltaire l’historien du Siècle de Louis XIV, suivi par l’un de nos meilleurs auteurs contemporains, curieux de tout et notamment d’Histoire… Passionné par cette énigme historique, Pagnol publie à son compte Le Masque de fer en 1965, remanié en 1973 sous le titre Le Secret du masque de fer.
Pagnol se montre modeste : « Ce livre n’est pas un ouvrage littéraire : ce n’est qu’un essai de démonstration ou, si l’on préfère, une enquête de juge d’instruction. » Il tire ses propres conclusions : reprenant et actualisant l’hypothèse de Voltaire (et d’Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne), il voit dans le Masque de fer un frère jumeau de Louis XIV, né après ce dernier – et supposé être l’aîné, selon la gynécologie obstétricienne de l’époque. Donc roi légitime !
L’identité du Masque de fer fait toujours débat chez les historiens : sur plus d’une cinquantaine d’hypothèses avancées, le frère jumeau de Louis XIV arrive dans le tiercé de tête avec le surintendant Fouquet… et un juriste ambitieux qui a les honneurs du dictionnaire.
« Ercole Mattioli. Diplomate italien (Bologne 1640-Paris 1703).
Secrétaire et ambassadeur du duc de Mantoue, il fut incarcéré pour des raisons politiques par les Français à Pignerol (1679), puis à la Bastille. C’est peut-être le Masque de fer. »Larousse
Autres hypothèses sur l’identité du mystérieux détenu :
- François de Vendôme duc de Beaufort, cousin germain de Louis XIV qui participa à plusieurs conspirations contre Richelieu et Mazarin, fut l’un des chefs de la Fronde. Réconcilié avec la monarchie, il se révéla toujours agité, éventuellement dangereux.
- Henri II de Guise, descendant de la lignée de Lorraine-Guise, prétendant d’un groupe secret prônant le retour à la dynastie carolingienne, et à ce titre « jumeau alchimique » du Roi-Soleil. Les explications ésotériques sont liées à l’existence d’une supposée société secrète, le Prieuré de Sion.
- Molière se présente en invité surprise : il ne serait pas mort à la suite de la quatrième représentation du Malade imaginaire, mais arrêté à la demande des jésuites qui ne lui avaient pas pardonné son Tartuffe. Hypothèse séduisante, mais très peu crédible.
- D’Artagnan, célèbre mousquetaire blessé à Maastricht en 1673 et envoyé à Pignerol, masqué de fer pour ne pas être reconnu par les mousquetaires chargés de garder les prisons. Le personnage a bien existé, né en entre 1611 et 1615, mort le 25 juin 1673 durant le siège de Maastricht. S’il avait survécu à sa blessure, le prisonnier mort en 1703 aurait été nonagénaire, âge rarement atteint à l’époque et peu vraisemblable, en raison des conditions de détention.
- Le nain Nabo, amant de la reine Marie-Thérèse qui aurait eu une fille adultérine avec son esclave noir. La fille serait la Mauresse de Moret, bénédictine convaincue d’être de sang royal, tant elle reçut de visites de membres de la famille royale. Saint-Simon en parle dans ses Mémoires. Quant à Nabo, disparu de la cour royale, il serait devenu… le Masque de fer. Mais le prisonnier est toujours décrit comme un homme grand.
- Le fils de Louis XIII et d’une dame de la cour, selon la découverte d’une radiesthésiste du Pas-de-Calais armée d’un pendule, à la fin années 1940… On peut oublier cette hypothèse.
Seule certitude : du début du XVIIIe jusqu’à la fin du XXe siècle, le fantasme de l’homme au Masque de fer se retrouve dans plusieurs milliers de livres et d’articles de presse, dont quelque deux cents ouvrages ou articles de fond. Trois colloques internationaux lui ont été consacrés, avec une vingtaine de romans, sept pièces de théâtre et seize films de cape et d’épée.
Molière, cible de cabales et de rumeurs en tous genres, avec une légende qui reste attachée à sa mort.
« La vie c’est un peu comme une pièce de théâtre dont nous serions les acteurs … et les autres, le public ; mais à la fin on ne vient pas saluer … on meurt en scène comme Molière. »5
Philippe GELUCK (né en 1954), Le Tour du chat en 365 jours (2006)
Mais Molière n’est pas mort en scène ! C’est une certitude absolue.
Malade d’une tuberculose que les médecins du temps sont impuissants à guérir, affecté par la mort de son fils et de sa vieille amie Madeleine Béjart, épuisé de travail à la tête de sa troupe et supplanté par l’intrigant Lully auprès de Louis XIV, Molière, 51 ans, est pris d’une défaillance sur la scène de son théâtre du Palais-Royal où il joue pour la quatrième fois le rôle-titre du Malade imaginaire.
Il meurt quelques heures plus tard chez lui, rue de Richelieu (proche de son théâtre), crachant le sang. Armande, sa femme (Mlle Molière), fait intervenir personnellement Louis XIV pour obtenir de l’archevêque de Paris des funérailles (nocturnes) et une sépulture chrétienne, le 21 février 1673.
Ceci pour démentir la légende tenace : Molière mort en scène et son cadavre jeté à la fosse commune. Il n’est pas non plus mort dans la misère. Son train de vie et sa fortune personnelle en attestent, quoiqu’en rien comparables à ceux de son ex-ami et principal rival, Lully.
Star de son temps, naturellement jalousé des confrères, Molière fut l’objet de toutes les rumeurs. Le plus étonnant, c’est qu’il en reste toujours quelque chose…
« La critique littéraire à une tendance à louer le plagiat, quand il est commis par un homme de génie, par un Molière. C’est un peu comme si on disait qu’une canaillerie faite par un homme vertueux devient une bonne action. »
Edmond de GONCOURT (1822-1896) et Jules de GONCOURT (1830-1870), Journal tome 2, 6 octobre 1883
Dès son époque, on accusait Molière de plagier les grands auteurs italiens et espagnols - mais en l’absence de droit d’auteur, on s’inspirait librement de tel ou tel.
La Fontaine réécrit en mieux les fables du grec Ésope (mort en 564 av J.-C.) et le Don Juan de Tirso de Molina, l’un des auteurs du Siècle d’or espagnol, personnage récupéré par la commedia dell arte italienne, va devenir un mythe universel, repris sans fin. Accuser Molière de plagiat est donc une calomnie, un anachronisme ou un non-sens.
« Racine, Corneille, Molière, etc. ont été accablés de leurs temps par des volumes de satires ; qui est-ce qui en connaît aujourd’hui une seule ? »
Jean le Rond d’ALEMBERT (1717-1783 ) Éloges
Au siècle des cabales et du théâtre roi généreusement subventionné par les mécènes, Molière n’est assurément pas le seul visé !
Corneille est victime de la fameuse Querelle du Cid (1637) ourdie par Richelieu qui instrumentalise à ses fins l’Académie française : il se venge ainsi sur son ex-protégé, le jeune génie ayant refusé d’entrer dans son atelier d’écriture, le ministre se piquant d’écrire ses propres tragédies.
Racine, tragédien confirmé, sera victime d’une cabale contre Phèdre, début janvier 1677. Pradon fait jouer en même temps sa Phèdre et Hippolyte. La duchesse de Bouillon a loué pour les six premières représentations (décisives) les loges des deux théâtres, laissant vides celles de l’hôtel de Bourgogne pour faire croire à la chute de la Phèdre racinienne, cependant que toute la cabale remplissait la salle Guénégaud de ses applaudissements. Le public ne fut pas dupe très longtemps et la postérité jugea sans équivoque, mais Racine, maître incontesté de la scène tragique depuis dix ans, profondément blessé, se retire. Il a une autre raison : le métier d’historiographe du roi est mieux payé, moins fatigant.
Ce genre d’argument n’aurait pas détourné Molière de sa passion d’écrire et de jouer jusqu’à la limite de ses forces.
« … C’est une précieuse.
Reste de ces esprits jadis si renommés,
Que d’un coup de son art Molière a diffamés. »Nicolas BOILEAU (1636-1711). Satire X. — Les femmes
Entre autres victimes de Molière, les Précieuses ridicules dont il se moque, ainsi que des Femmes savantes. C’est surtout leurs excès qu’il attaque – comme il se moquera du bourgeois jouant au gentilhomme ou du Tartuffe incarnant le faux dévot.
Son ami Boileau défend naturellement le génie de Molière dont il fut par ailleurs l’ami. Mais il se trouve encore et toujours des critiques pour l’accuser… et non des moindres.
« La préciosité, cette belle fleur française qui s’épanouit si bien dans les parterres à compartiments des jardins de la vieille école, et que Molière a si méchamment foulée aux pieds dans je ne sais plus quelle immortelle mauvaise petite pièce. »
Théophile GAUTIER (1811-1872), Les Grotesques (1844)
Poète du Parnasse, conteur du fantastique et romancier admirateur du romantisme (et d’Hugo), figure marquante de la vie littéraire du XIXe siècle, il aborda aussi la critique d’art, défendant la théorie de « l’art pour l’art ». Notons qu’à son époque, Molière ne remplit pas les salles et Musset le déplore en poète affligé, dans Une soirée perdue : J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français, / Ou presque seul ; l’auteur n’avait pas grand succès. / Ce n’était que Molière, et nous savons de reste / Que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste, / Ignora le bel art de chatouiller l’esprit / Et de servir à point un dénouement bien cuit. »
Mais Sainte-Beuve, le plus célèbre critique contemporain, critiqua aussitôt l’œuvre critique de Théophile Gautier ! Tel est le jeu qui s’applique si bien aux œuvres théâtrales. Molière lui-même se plut à écrire et mettre en scène La Critique de l’École des Femmes, pièce naturellement attaquée… quoique pour d’autres raisons qui relèvent de la calomnie.
« Montfleury a fait une requête contre Molière, et l’a donnée au roi. Il l’accuse d’avoir épousé la fille et d’avoir autrefois couché avec la mère. Mais Montfleury n’est point écouté à la cour. »
Jean RACINE (1639-1699), Lettre du 23 novembre 1663 à son ami l’abbé François Le Vasseur. Œuvres de Jean Racine, Hachette (posthume, 1865).
Ainsi naît une rumeur d’inceste lancée. Accusation publiquement portée par Montfleury, vedette de l’Hôtel de Bourgogne, troupe rivale. Molière, créateur du naturel en scène, s’est moqué de son jeu emphatique (parodié dans l’Impromptu de Versailles).
En fait, la naissance de la future Mlle Molière reste un mystère d’état-civil et le dossier à charge est vide. Mais Molière, à 21 ans, fut l’amant passionné de sa mère, une belle rousse, Madeleine Béjart qui restera toujours sa plus grande amie. Vingt ans après, la rumeur est si persistante… que Molière doit s’expliquer devant le roi, certificat de baptême à l’appui. Louis XIV acceptera d’être son témoin de mariage. Leurs noces, le 20 février 1662, sont célébrées en petit comité tant le scandale est grand, jusque dans la famille de l’écrivain. Il épouse Armande, de vingt ans sa cadette et fille illégitime de son ex-compagne. De quoi faire jaser !
D’autres accusations portent sur sa vie privée. Cocu et dangereux libertin… Les coulisses théâtrales n’ont jamais été des couvents modèles. Il est clair que Molière a eu une relation avec Melle de Brie, une autre actrice de sa troupe,…
L’Affaire du Tartuffe est une autre histoire et Molière en sortira vainqueur, non sans mal.
« Le scandale du monde est ce qui fait l’offense,
Et ce n’est pas pécher que pécher en silence. »872MOLIÈRE (1622-1673), Tartuffe (1669)
5 février 1669, la pièce peut enfin se jouer en public, épilogue d’un épuisant combat de cinq années, reflet de la censure au Grand Siècle et du pouvoir des cabales !
La première version en trois actes de la pièce, dont une ébauche a été approuvée par le roi, est jouée le 12 mai 1664. Influencé par l’archevêque de Paris, Louis XIV interdit les représentations publiques, mais ne va pas jusqu’à suivre le curé Roullé qui demande un bûcher pour y brûler l’auteur !
Molière a des appuis en haut lieu – Madame et Monsieur, Condé, le légat du pape (cardinal Chigi). Mais la « cabale des dévots » est la plus forte et son Tartuffe ne se joue qu’en privé (chez Monsieur, frère du roi). Molière ne peut s’y résoudre, écrit une deuxième version édulcorée, habille son faux dévot en homme du siècle et profite de l’absence du roi (guerroyant dans l’armée des Flandres) pour présenter Panulphe ou l’Imposteur. Lamoignon, premier président du Parlement, interdit la pièce, l’archevêque de Paris excommunie les spectateurs, Molière tombe malade.
La troisième version triomphe enfin en 1669, avec la bénédiction du roi et 50 représentations (chiffre considérable pour l’époque). Molière devient le pourvoyeur des divertissements royaux à toutes les fêtes.
Mais 250 ans après sa mort, autre soupçon : voilà Molière accusé de supercherie littéraire.
« Ah : marque l’étonnement, exige une explication ou signifie l’incrédulité. Ex : C’est Corneille, vous savez, qui a écrit les pièces de Molière. Réponse : Ah ? »
Jean TARDIEU (1903-1995), Un mot pour un autre (1951)
Parmi toutes les fake news colportées sur l’auteur français le plus joué au monde… voici la plus étonnante. Il n’aurait pas écrit ses pièces !!!
À l’appui de cette thèse, on n’a retrouvé aucun manuscrit de Molière, ni même aucune trace de son écriture dans le fameux registre de la troupe, tenu par le comédien La Grange. Mais à l’époque, les auteurs ne gardaient pas leurs brouillons, après publication.
L’auteur caché, autrement dit « le nègre », serait tout simplement… le vieux Corneille, écarté de la scène par le succès du jeune Racine et ex-collaborateur de Molière dans Psyché (1671), tragédie-ballet de cinq heures où les noms de Quinault et Lully apparaissent également au générique.
Cette rumeur a une source précise, mais pas sérieuse. Elle fut lancée par un poète parnassien adepte du canular, Pierre Louÿs qui fit passer ses très érotiques Chansons de Bilitis (1894) pour la traduction d’une poétesse de la Grèce antique. Il publia ensuite un premier article qui lance la nouvelle affaire.
« Corneille est-il l’auteur d’Amphitryon ? »19
Pierre LOUŸS (1870-1925), L’Intermédiaire des chercheurs et curieux (1919)
Il donne ses arguments, après une méticuleuse étude de l’ensemble de l’œuvre théâtrale : Molière n’aurait eu ni le temps ni les connaissances suffisantes pour imaginer ses comédies et son œuvre présente de troublantes similitudes avec celle de Corneille. Et puis, rappelle-t-il, ses manuscrits n’ont jamais été retrouvés… Il n’en faut pas plus pour que, pendant un siècle, on adhère à cette idée de supercherie littéraire !
Rumeur relancée en 2003 par un linguiste, Dominique Labbé, trouvant une forte uniformité lexicale entre les deux répertoires (nombre de rimes réduit et constructions syntaxiques uniformes).
Rebondissement en 2019 : deux chercheurs du CNRS, Florian Cafiero et Jean-Baptiste Camps, rouvrent l’affaire en se faisant aider (déjà) par l’intelligence artificielle pour analyser les textes. Vocabulaire, rimes, grammaire… tout y passe. Après cette analyse statistique approfondie des habitudes d’écriture et des tics de langage au siècle classique, il est clair que tout le théâtre présente certaines similitudes… et Molière est bien l’auteur de ses pièces.
Disons aussi que tous les acteurs et tous les connaisseurs de Molière se sont insurgés contre cette thèse qui fit beaucoup parler, comme toute « bonne » rumeur. Une exception, Jean-Laurent Cochet, acteur de la Comédie-Française et metteur en scène souvent inspiré, mais ce grand original aimait faire bande à part.
Rappelons que Shakespeare, l’homme de théâtre le plus illustre au monde, connut une mésaventure comparable pour le 400e anniversaire de sa mort. Un groupe d’universitaires anglais démontra que sur 44 pièces, 17 sont coécrites par son grand rival, Christopher Marlowe. L’honneur est sauf et l’histoire d’Angleterre reste la plus passionnante, juste après notre histoire de France.
Reste un dernier mystère absolu. Le nom même de Molière, mondialement connu. Jean-Baptiste n’a jamais expliqué le choix de ce pseudonyme sur lequel on a quand même beaucoup écrit.
Horoscope de Louis de France : rôle historique et politique de l’astrologie.
« Fils de roi ; père de roi ; jamais roi ! »864
Horoscope de Louis de France. Le Siècle de Louis XIV (1751), Voltaire
Le Grand Dauphin (Monseigneur) naît le 1er novembre 1661. Fils aîné de Louis XIV, il sera père de Philippe V roi d’Espagne, mais meurt de la petite vérole à 50 ans, avant d’avoir pu accéder au trône.
Il n’est pas certain qu’il l’ait ardemment désiré, vu son caractère un peu mou et son éducation un peu rude. Il reporta toute la fierté de son sang royal sur son deuxième fils, le duc d’Anjou (les deux autres moururent jeunes), revendiquant l’héritage de la couronne d’Espagne sur laquelle sa mère Marie-Thérèse d’Autriche (infante espagnole) lui a donné des droits.
Les astrologues étaient régulièrement consultés en ces époques où superstition, sorcellerie et magie faisaient partie de la vie quotidienne – le Grand Siècle est en cela plus proche de la Renaissance que des Lumières. L’astrologue le plus célèbre en France est assurément Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, apothicaire et auteur français, connu pour son ouvrage intitulé Les Prophéties. Tout peut être contestable et contesté dans sa vie et ses écrits. Il eut quand même une influence à la cour de Catherine de Médicis.
L’astrologie est définie par le Larousse : « Discipline ayant pour objet l’étude des corrélations entre la configuration, la qualité propice ou néfaste du ciel géocentrique lors d’un événement terrestre, d’une part, et la nature, les développements de cet événement d’autre part ».
Restée très populaire (et commercialement rentable), il est de notoriété publique qu’un homme aussi intelligent et cultivé que François Mitterrand eut recours à Élizabeth Teissier (née en 1938), « ex-mannequin de charme et actrice dans le domaine de l’érotisme » qui crée en 1975-1976 le premier horoscope télévisé quotidien sur Antenne 2. En 1981, elle lance l’émission télévisée « Astro Show » en Allemagne. Elle fut l’objet de plusieurs controverses : l’obtention de sa thèse de doctorat en sociologie contestée par une partie de la communauté scientifique, notamment les sociologues. Certaines de ses prédictions astrologiques erronées tout comme ses affirmations pseudo-scientifiques en général, ont été critiquées.
L’Affaire des Poisons, première ombre portée au siècle du Roi Soleil, contée par Mme de Sévigné.
« La duchesse de Bouillon alla demander à la Voisin un peu de poison pour faire mourir un vieux mari qu’elle avait qui la faisait mourir d’ennui. »884
Marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696), Lettre, 31 janvier 1680 (posthume)
Le fait divers va devenir affaire d’État – c’est l’affaire des Poisons, première ombre portée au règne du Roi-Soleil. Et l’infatigable épistolière nous met dans la confidence, avec gourmandise.
Tout commence quatre ans plus tôt, avec la marquise de Brinvilliers : accusée d’avoir empoisonné père, frère et autres « gêneurs » de la famille pour hériter, elle reconnaît ses crimes, mais déclare qu’« il y avait beaucoup de personnes engagées dans ce misérable commerce de poison, et des personnes de condition », sans donner de nom. Elle est jugée, condamnée, décapitée, puis brûlée le 17 juillet 1676.
Suite aux aveux de la marquise, La Reynie, lieutenant général de la police, est chargé d’enquêter en 1677. On découvre dans le milieu des diseuses de bonne aventure, devins et autres sorciers, un véritable réseau de fabricants et marchands de drogues. Les plus efficaces, arsenic en tête, sont appelées plaisamment « poudres de succession ». Panique dans la population : on voit l’œuvre des empoisonneuses dans le moindre décès prématuré. On apprend parallèlement la pratique des avortements et des messes noires. Et cela concerne tous les milieux, à Paris comme en province.
Le scandale grandit, le nombre des inculpés aussi. En 1679, le roi institue une cour extraordinaire de justice pour juger de ces crimes : Chambre ardente, qui siège dans une pièce tendue de draps noirs, éclairée par des flambeaux. On la nomme « cour des poisons ». Louvois ne serait pas fâché d’éliminer ainsi certains de ses ennemis. Mais le scandale éclabousse la cour : la duchesse de Bouillon dont parle Mme de Sévigné – la plus jeune des nièces de Mazarin. Et aussi la comtesse de Soissons (autre « mazarinette »), la comtesse de Gramont, la vicomtesse de Polignac, le duc de Vendôme, le maréchal de Luxembourg (jadis alchimiste en amateur), Racine (soupçonné d’avoir empoisonné par jalousie sa maîtresse, la comédienne Du Parc)… et jusqu’à la favorite en titre du roi.
« Toutes les fois qu’elle [Mme de Montespan] craignait quelque diminution aux bonnes grâces du Roi, elle donnait avis à ma mère afin qu’elle y apportât quelque remède. »885
Marie-Marguerite MONVOISIN (1658- ??), belle-fille (et complice) de la Voisin. Le Drame des poisons (1900), Frantz Funck-Brentano
La Voisin (du nom de son mari, le sieur Monvoisin), née Catherine Deshayes, est bien connue dans le quartier Saint-Denis (lieu de tous les trafics), comme marchande de beaux effets pour nobles dames, mais aussi avorteuse.
Accusée d’avoir pratiqué la sorcellerie et fourni des poisons, elle ne donnera pas le nom de la maîtresse royale, mais sa belle-fille met en cause Mme de Montespan. Elle aurait donné au roi des « remèdes », en fait des aphrodisiaques peu ragoûtants (fœtus séchés, sperme de bouc, bave de crapaud, poussière de taupes desséchées, sang de chauve-souris, semence humaine et sang menstruel) qui ont ébranlé sa santé pourtant robuste. On parle aussi de messes noires où, dit-on, des enfants sont égorgés sur l’autel du diable. La Voisin, main coupée, subit la question, avant d’être brûlée en place de Grève, le 22 février 1680, et la « fille Monvoisin » sera enfermée à la citadelle Vauban de Belle-Isle.
« S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : il s’en tire et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous. »886
Jean de LA BRUYÈRE (1645-1696), Les Caractères (1688).
Premier styliste de notre littérature, moraliste et observateur des Mœurs du siècle (sous-titre des Caractères), il doit son succès à cette seule œuvre.
L’affaire des Poisons allait compromettre trop de monde à la cour. Et Louis XIV est horrifié : sa maîtresse lui aurait donc fait absorber des philtres d’amour, manigancé la mort de Mme de Fontanges (sa nouvelle favorite) et la stérilité de la reine !… Il suspend les interrogatoires. L’enquête publique est fermée, le roi fait brûler les dossiers, jetant lui-même au feu de la cheminée les pages compromettant son ex-favorite. La Chambre ardente aura siégé trois ans ! Au final, 36 condamnations à mort prononcées et appliquées.
Mme de Montespan, qui a perdu la faveur du roi, ne quittera la cour qu’en 1691. Et Louis XIV ne va plus avoir de commerce amoureux qu’avec Mme de Maintenon, en cela du moins au-dessus de tout soupçon.
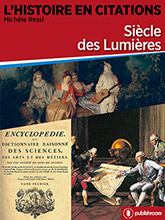 SIÈCLE DES LUMIÈRES
SIÈCLE DES LUMIÈRES
Louis XV le Bien Aimé : sa vie amoureuse devenue l’objet de toutes les rumeurs sera la première cause d’une impopularité extrême jusqu’à sa mort.
« On se sentait forcé de l’aimer dans l’instant. »1118
CASANOVA (1725-1798), de passage en France, 1750, Histoire de ma vie (posthume)
L’aventurier et mémorialiste italien (d’expression française) confirme cette impression de prestance et de grâce que Louis XV donne à quiconque l’approche : « J’ai vu le roi aller à la messe. La tête de Louis XV était belle à ravir et plantée sur son cou l’on ne pouvait pas mieux. Jamais peintre très habile ne put dessiner le coup de tête de ce monarque lorsqu’il se retournait pour regarder quelqu’un. »
« Puisqu’il a repris sa catin, il ne trouvera plus un Pater sur le pavé de Paris. »1120
Les poissardes parlant de Louis XV, novembre 1744. Dictionnaire contenant les anecdotes historiques de l’amour, depuis le commencement du monde jusqu’à ce jour (1811), Mouchet.
Bien-Aimé, certes, mais déjà contesté. Ces femmes du peuple ont tant prié pour la guérison du roi malade ! Mais il vient de reprendre sa maîtresse Mme de Châteauroux, troisième des sœurs de Nesle, présentées au roi par le duc de Richelieu, petit-neveu du cardinal (embastillé à 15 ans pour débauche et remarié pour la troisième fois à 84 ans). La nouvelle fait scandale. La cour se tait, mais la rue a son franc-parler.
« Les grands seigneurs s’avilissent,
Les financiers s’enrichissent,
Tous les Poissons s’agrandissent.
C’est le règne des vauriens. »1162Poissonnade, attribuée à Pont-de-Veyle (1697-1774). Journal historique : depuis 1748 jusqu’en 1772 inclusivement (1807), Charles Collé
Les poissonnades fleurissent, comme jadis les mazarinades. Le peuple supporte mal le luxe qui s’étale à la cour où règne encore la Pompadour, et s’affiche dans des milieux prospères et âpres au gain, du côté des aristocrates comme des bourgeois. La favorite fait aménager ses nombreuses résidences (hôtel d’Évreux, futur Élysée, La Celle, Bellevue, Champs). Elle place son frère Abel Poisson, nommé marquis de Marigny, à la direction générale des Bâtiments où il se montre d’ailleurs bon administrateur.
Mais le peuple s’en irrite : « On épuise la finance / En bâtiment, en dépenses, / L’État tombe en décadence / Le roi ne met ordre à rien / Une petite bourgeoise / Élevée à la grivoise / Mesurant tout à la toise / Fait de l’amour un taudis. »
« Oh ! la belle statue ! oh ! le beau piédestal !
Les Vertus sont à pied et le Vice à cheval. »1177Vers anonymes écrits sur le socle de la statue équestre de Louis XV. Le Vandalisme de la Révolution (1993), François Souchal
La statue de Bouchardon, inaugurée à Paris le 2 juin 1765 sur la place Louis-XV (aujourd’hui place de la Concorde) est entourée de quatre figures symbolisant les vertus.
Louis XV le Bien-Aimé a perdu la Pompadour et pas encore trouvé la du Barry : entre deux favorites officielles, les dames ne manquent pas, surtout de très jeunes demoiselles, discrètement abritées dans le Parc-aux-Cerfs à Versailles, fournies par des parents consentants, ignorant elles-mêmes l’identité de leur royal amant et mariées à des courtisans sitôt qu’engrossées. Dit-on.
La marquise de Pompadour, maquerelle vigilante, veillait à ce que le roi ne s’attache durablement à aucune. Disait-on aussi. Le règne est celui de toutes les rumeurs et la vie amoureuse de ce roi très sensuel et à présent haï est un sujet de choix.
« Ami des propos libertins,
Buveur fameux, et roi célèbre
Par la chasse et par les catins :
Voilà ton oraison funèbre. »1195Chanson à la mort de Louis XV (1774). Vie privée de Louis XV, ou principaux événements, particularités et anecdotes de son règne (1781), Mouffle d’Angerville
« On l’enterra promptement et sans la moindre escorte ; son corps passa vers minuit par le bois de Boulogne pour aller à Saint-Denis. À son passage, des cris de dérision ont été entendus : on répétait « taïaut ! taïaut ! » comme lorsqu’on voit un cerf et sur le ton ridicule dont il avait coutume de le prononcer » (Lettre de la comtesse de Boufflers).
« Le silence des peuples est la leçon des rois. »1196
Abbé de BEAUVAIS (1731-1790), évêque de Senez, Oraison funèbre de Louis XV, prononcée le 27 juillet 1774 en la basilique de Saint-Denis
Au terme d’un règne de soixante-quatre ans, Louis le Bien-Aimé est mort et enterré dans l’indifférence générale, selon la version officielle – la plus clémente.
Quarante jours plus tôt, au sermon du Jeudi saint, l’abbé avait osé ces mots qui ont fort ému le roi : « Sire, mon devoir de ministre du Dieu de vérité m’ordonne de vous dire que vos peuples sont malheureux, que vous en êtes la cause et qu’on vous le laisse ignorer. »
Mais le discours funèbre est jugé irrespectueux… et le prédicateur doit se retirer dans son évêché – l’un des plus modestes de France. Il sera élu député du clergé en 1789. De sorte qu’il pourra entendre le 15 juillet, repris par le grand orateur Mirabeau, lors de la visite de Louis XVI à la Constituante muette, ce mot très dur : « Le silence des peuples est la leçon des rois. »
Affaire du Chevalier de la Barre, affaire Calas : ces deux faits divers impliquent Voltaire, notre premier « intellectuel engagé » contre l’erreur judiciaire et l’intolérance religieuse.
« On dit que cet infortuné jeune homme est mort avec la fermeté de Socrate ; et Socrate a moins de mérite que lui : car ce n’est pas un grand effort, à soixante et dix ans, de boire tranquillement un gobelet de ciguë ; mais mourir dans les supplices horribles, à l’âge de vingt et un ans… »1180
VOLTAIRE (1694-1778), Lettre à M. le Comte d’Argental, 23 juillet 1766, Correspondance (posthume)
Il prend parti pour le chevalier de la Barre : accusé sans preuve de blasphèmes, chansons infâmes et profanations, et de ne pas s’être découvert lors d’une procession de la Fête-Dieu, il fut condamné à avoir la langue coupée, la tête tranchée, le corps réduit en cendres… avec un exemplaire du Dictionnaire philosophique trouvé chez lui, le 1er juillet 1766.
C’est dire si l’auteur, défenseur des droits de l’homme, se sent doublement concerné ! Comme dans l’Affaire Calas (1761-1765) qui fut à l’origine de son Traite sur la tolérance (1763), Voltaire va s’engager et demander la révision du jugement.
Le marquis de Sade condamné à mort et prisonnier la moitié de sa vie : quelle affaire et quel mystère dans cette destinée d’auteur aujourd’hui reconnu !
« Mon plus grand chagrin est qu’il n’existe réellement pas de Dieu et de me voir privé, par là, du plaisir de l’insulter plus positivement. »989
Marquis de SADE (1740-1814) L’Histoire de Juliette (1797
Au-delà des philosophes vaguement déistes ou résolument athées, Sade se pose comme le plus irréligieux des grands marginaux du siècle. Jamais la perversion n’a été poussée si loin et deux siècles plus tard, elle demeure exemplaire et scandaleuse.
Né de haute noblesse provençale, élève des jésuites, très jeune combattant de la guerre de Sept Ans, marié en 1763, les deux semaines au donjon de Vincennes pour « débauche outrée » n’étaient qu’un premier avertissement. En 1768, Sade est emprisonné sept mois, ayant enlevé et torturé une passante.
Il sera condamné à mort en 1772 pour violences sexuelles. Incarcéré en Savoie, évadé, emprisonné de nouveau à Vincennes, puis à la Bastille, transféré à Charenton quelques jours avant le 14 juillet 1789, libéré le 2 avril 1790 par le décret sur les lettres de cachet, avant de nouvelles incarcérations. Sa famille veille à ce qu’il ne sorte plus de l’hospice de Charenton où il mourra.
« Respectons éternellement le vice et ne frappons que la vertu. »1182
Marquis de SADE (1740-1814) L’Histoire de Juliette (1797)
« Depuis l’âge de quinze ans, ma tête ne s’est embrasée qu’à l’idée de périr victime des passions cruelles du libertinage. »
Le « divin marquis » joue à vivre les provocations qu’il conte et sera condamné à mort pour violences sexuelles. Dans la Philosophie dans le boudoir, il écrit comme pour se justifier : « Je ne m’adresse qu’à des gens capables de m’entendre, et ceux-là me liront sans danger. »
Son œuvre, interdite, circule sous le manteau tout au long du XIXe siècle. Elle est réhabilitée au XXe, avec les honneurs d’une édition dans la Pléiade.
Premier auteur érotique de la littérature moderne, il donne au dictionnaire le mot sadisme : « perversion sexuelle par laquelle une personne ne peut atteindre l’orgasme qu’en faisant souffrir (physiquement ou moralement) l’objet de ses désirs » (Le Robert).
L’Affaire du Collier de la Reine : ce complot fera un roman de Dumas, mais ce fait divers tourne à l’affaire d’État et précipite la Révolution.
« Nous avons plus grand besoin d’un vaisseau que d’un collier. »1238
MARIE-ANTOINETTE (1755-1793), aux joailliers de la couronne, Boehmer et Bassenge. Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette (1823), Madame Campan
C’est en ces termes que la reine, quoique toujours coquette et fort dépensière, a refusé une somptueuse parure de 540 diamants d’une valeur de 1 600 000 livres – c’est même le prix de deux vaisseaux de guerre. Étonnante réaction de l’« étrangère » accusée de ruiner la France !
Boehmer a acheté le collier, certain qu’elle changera d’avis, mais elle réitère son refus et il ne sait plus où ni comment vendre un tel bijou !
L’intrigante comtesse de La Motte et l’aventurier italien Cagliostro vont persuader le cardinal de Rohan de l’acheter, pour s’attirer les faveurs de Marie-Antoinette qui ne peut faire publiquement une telle dépense, et le remboursera ensuite secrètement. Ils se chargent de remettre eux-mêmes le bijou à la reine.
C’est le début d’une escroquerie dont Dumas tirera un roman et qui va devenir, dès l’année suivante, l’historique « affaire du Collier de la reine ».
« Notre Saint Père l’a rougi,
Le roi de France l’a noirci,
Le Parlement le blanchira,
Alleluya. »1241Alleluya sur l’affaire du Collier (1786), chanson. La Bastille dévoilée ou Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire (1789), Charpentier, Louis-Pierre Manuel
L’Affaire éclate quand, le cardinal de Rohan ne pouvant couvrir une échéance en juillet 1785, les bijoutiers adressent la facture à la reine qui n’a jamais touché aux diamants – revendus au détail par les deux escrocs.
Louis XVI, poussé par sa femme et (mal) conseillé par le baron de Breteuil, ennemi du cardinal, porte l’affaire devant le Parlement de Paris. Rohan, plus naïf que coupable, est acquitté le 31 mai 1786, mais exilé par le roi. La comtesse de la Motte, condamnée à être flagellée, marquée au fer, est enfermée à perpétuité à la Salpêtrière. Elle s’en évadera en 1787.
La reine, innocente dans cette affaire, est déconsidérée, avec sa vie privée étalée au grand jour et ses fastueuses dépenses dénoncées. La police doit empêcher Paris d’illuminer pour acclamer le cardinal et se réjouir de voir l’« Autrichienne » humiliée. Elle devient « Madame Déficit ».
« Plus scélérate qu’Agrippine
Dont les crimes sont inouïs,
Plus lubrique que Messaline,
Plus barbare que Médicis. »1242Pamphlet contre la reine. Vers 1785. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
Dauphine jadis adorée, la reine est devenue terriblement impopulaire en dix ans, pour sa légèreté de mœurs, mais aussi pour ses intrigues et son ascendant sur un roi faible jusqu’à la soumission. L’affaire du Collier va renforcer ce sentiment.
La Révolution héritera certes de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, mais aussi des « basses Lumières », masse de libelles et de pamphlets à scandale où le mauvais goût rivalise avec la violence verbale, inondant le marché clandestin du livre et sapant les fondements du régime. Après le Régent, les maîtresses de Louis XV et le clergé, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée : quelque 3 000 pamphlets la visant relèvent, selon la plupart des historiens, de l’assassinat politique.
« Grande et heureuse affaire ! Que de fange sur la crosse et sur le sceptre ! Quel triomphe pour les idées de la liberté. »1243
Emmanuel Marie FRÉTEAU de SAINT-JUST (1745-1794), conseiller au Parlement. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Mirabeau dira plus tard : « Le procès du Collier a été le prélude de la Révolution. » La royauté déjà malade sort encore affaiblie de cette affaire. Et Marie-Antoinette le paiera cher, lors de son procès.
 RÉVOLUTION
RÉVOLUTION
Le double jeu de Mirabeau, premier grand homme de la Révolution : « mauvais sujet » aimé du peuple… mais démasqué et vite dépanthéonisé.
« La nature semblait avoir moulé sa tête pour l’Empire ou pour le gibet, taillé ses bras pour étreindre une nation ou pour enlever une femme. »1292
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Mirabeau connut la gloire et évita le gibet – il meurt dans son lit, épuisé par une vie d’excès. Il souleva le peuple par ses talents d’orateur et multiplia les conquêtes féminines.
« Voyez ce Mirabeau qui a tant marqué dans la Révolution : au fond, c’était le roi de la halle. »1293
Joseph de MAISTRE (1753-1821), Considérations sur la France (1797)
Mirabeau, rejeté de son ordre (la noblesse), élu député par le tiers état aux États généraux, mêle plus que quiconque les attributs de la naissance et de la bohème. Selon François Furet : « Du rejeton le plus méprisé de l’ancienne noblesse, la Révolution a fait le personnage le plus brillant de l’Assemblée constituante. »
« Mirabeau (le comte de). – Ce grand homme a senti de bonne heure que la moindre vertu pouvait l’arrêter sur le chemin de la gloire, et jusqu’à ce jour, il ne s’en est permis aucune. »1294
RIVAROL (1753-1801), Petit Dictionnaire des grands hommes de la Révolution (1790)
Dans le même savoureux petit livre et avec le même esprit : « Mirabeau est capable de tout pour de l’argent, même d’une bonne action. » Avant la Révolution, Mirabeau vendait sa plume (et ses idées) comme publiciste à gages ; il vendra ensuite ses services - très cher - au roi et à la reine, et sera accusé de trahison par certains députés.
« Repassez quand je serai ministre ! »1360
MIRABEAU (1749-1791), à ses créanciers. Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919 (1920), Ernest Lavisse, Philippe Sagnac
Cet homme toujours couvert de femmes et de dettes, aussi intelligent qu’ambitieux, intrigue pour supplanter Necker et se voit déjà chef modérateur d’une Révolution qu’il faut savoir finir – grand dessein d’un certain nombre de révolutionnaires successifs.
La première note secrète de Mirabeau à Louis XVI est datée du 15 octobre 1789. Il ne sera véritablement « acheté » qu’en mai 1790.
« Il ne se fait payer que dans le sens de ses convictions. »1363
LA FAYETTE (1757-1834) parlant de Mirabeau qui offre ses services au roi et à la reine, en mars 1790. Encyclopédie Larousse, article « Mirabeau (Honoré Gabriel Riqueti, comte de) »
« Mirabeau est vendu », disent ses adversaires. La Fayette est plus fair-play : la vénalité de Mirabeau ne se discute même pas, mais il s’en tient toujours à ses idées.
Mirabeau tente de faire prendre à la Révolution un tournant à droite, et manœuvre en secret pour sauver la monarchie. Il va donc offrir ses services au roi et à la reine – ou plus exactement, les vendre très cher, l’homme étant toujours couvert de dettes. Ses intrigues contrarient le jeu et les ambitions personnelles de La Fayette, qui l’a eu un temps comme allié.
« Le roi n’a qu’un homme, c’est sa femme. »1367
MIRABEAU (1749-1791). Marie-Antoinette, Correspondance, 1770-1793 (2005), Évelyne Lever
Ou encore, selon d’autres sources : « Le roi n’a qu’un seul homme, c’est la reine. »
Vérité connue de tous, éprouvée par Mirabeau devenu le conseiller secret de la couronne : il essaie donc de convaincre la reine avant le roi, dont la faiblesse, les hésitations, les retournements découragent les plus fervents défenseurs.
« Madame, la monarchie est sauvée. »1368
MIRABEAU (1749-1791), à la reine, Château de Saint-Cloud, 3 juillet 1790. Mémoires sur Mirabeau et son époque, sa vie littéraire et privée, sa conduite politique à l’Assemblée nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son temps (posthume, 1824)
Introduit à la cour par son ami le prince d’Arenberg, il a enfin réussi à persuader Marie-Antoinette par son éloquence.
Une question se pose, sans réponse des historiens : Mirabeau croit-il vraiment que la monarchie peut être sauvée ? Cet homme si bien informé de tout s’illusionne-t-il encore sur les chances d’un régime condamné, mais qui peut du moins le sauver de ses créanciers ?
« Mon ami, j’emporte avec moi les derniers lambeaux de la monarchie. »1384
MIRABEAU (1749-1791), à Talleyrand, fin mars 1791. Son « mot de la fin politique ». Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives (1832), Pierre Étienne Louis Dumont
Talleyrand est venu voir le malade, juste avant sa mort (2 avril). Certains députés, connaissant son double jeu et son double langage entre le roi et l’Assemblée, l’accusent de trahison – le fait sera prouvé en novembre 1792, quand l’armoire de fer où le roi cache ses papiers compromettants révélera ses secrets.
Pour l’heure, Mirabeau, l’Orateur du peuple, la Torche de Provence, premier personnage marquant de la Révolution, est logiquement le premier des “grands hommes” à connaître les funérailles nationales et les honneurs du Panthéon, en date du 5 avril 1791. Le peuple a littéralement pris le deuil de son grand homme panthéonisé.
Notons que Rivarol avait déjà rectifié l’image avec cet humour qui le caractérise : « Mirabeau (le comte de). – Ce grand homme a senti de bonne heure que la moindre vertu pouvait l’arrêter sur le chemin de la gloire, et jusqu’à ce jour, il ne s’en est permis aucune. » Dans le même esprit, rappelons cet autre mot : « Mirabeau est capable de tout pour de l’argent, même d’une bonne action » (Petit Dictionnaire des grands hommes de la Révolution, publié en 1790).
« Votre Comité vous propose d’exclure Mirabeau du Panthéon français, afin d’inspirer une terreur salutaire aux ambitieux et aux hommes vils dont la conscience est à prix. »
Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune nationale de 1789 jusqu’à nos jours. Volume 13 (1820)
Le 5 frimaire de l’an II (25 novembre 1793), les conclusions du Comité d’instruction publique tenu devant la Convention sont sans appel. Exit Mirabeau.
Moralité de l’Histoire, fort bien vue par Tocqueville, historien du XIXe siècle : « Il n’est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n’y a pas de grand peuple. » De la démocratie en Amérique (1835).
La dépouille du tribun autrefois adulé fait l’objet d’un châtiment posthume exemplaire : le 21 septembre 1794, Mirabeau est remplacé par Marat, l’Ami du peuple. Le séjour du député montagnard sera plus court encore : moins de cinq mois. L’Histoire s’emballe à un rythme fou. Voltaire va bénéficier de cet engouement (avec Rousseau), sans pâtir par la suite du retournement de l’opinion publique.
Le procès de Marie Antoinette : accusée d’inceste et victime des « basses lumières » (fake-news).
« Immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, elle est si perverse et si familière avec tous les crimes qu’oubliant sa qualité de mère, la veuve Capet n’a pas craint de se livrer à des indécences dont l’idée et le nom seul font frémir d’horreur. »1541
FOUQUIER-TINVILLE (1746-1795), Acte d’accusation de Marie-Antoinette, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (1862), Émile Campardon
« Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, âgée de 37 ans, veuve du roi de France », ayant ainsi décliné son identité, a répondu le 12 octobre à un interrogatoire (secret) portant sur des questions politiques, et sur le rôle qu’elle a joué auprès du roi au cours de divers événements, avant et après 1789. Elle nie pratiquement toute responsabilité.
Au procès, cette fois devant la foule, elle répond à nouveau et sa dignité impressionne. L’émotion est au comble, quand Fouquier-Tinville aborde ce sujet intime des relations avec son fils. L’accusateur public ne fait d’ailleurs que reprendre les rumeurs qui ont moralement et politiquement assassiné la reine en quelque 3 000 pamphlets, à la fin de l’Ancien Régime. L’inceste (avec un enfant âgé alors de moins de quatre ans) fut l’une des plus monstrueuses.
« Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère : j’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. »1542
MARIE-ANTOINETTE (1755-1793), réplique à un juré s’étonnant de son silence au sujet de l’accusation d’inceste, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. La Femme française dans les temps modernes (1883), Clarisse Bader.
La reine déchue n’est plus qu’une femme et une mère humiliée, à qui l’on a enlevé son enfant devenu témoin à charge, évidemment manipulé.
L’accusée retourne le peuple en sa faveur. Le président menace de faire évacuer la salle. La suite du procès est un simulacre de justice et l’issue ne fait aucun doute.
Au pied de la guillotine, les dernières paroles de Marie-Antoinette sont pour le bourreau Sanson qu’elle a heurté, dans un geste de recul : « Excusez-moi, Monsieur, je ne l’ai pas fait exprès. » Un mot de la fin sans doute authentique, mais trop anodin pour devenir citation.
« La plus grande joie du Père Duchesne après avoir vu de ses propres yeux la tête du Veto femelle séparée de son col de grue et sa grande colère contre les deux avocats du diable qui ont osé plaider la cause de cette guenon. »1543
Jacques HÉBERT (1757-1794), Le Père Duchesne, n° 299, titre du journal au lendemain du 16 octobre 1793. Les Derniers Jours de Marie-Antoinette (1933), Frantz Funck-Brentano
C’est l’oraison funèbre consacrée par le pamphlétaire jacobin à la reine sacrifiée. Le titre est un peu long et la chronique qui suit, ce n’est pas du Bossuet, mais la littérature révolutionnaire déploie volontiers cette démagogie populaire : « J’aurais désiré, f…! que tous les brigands couronnés eussent vu à travers la chatière l’interrogatoire et le jugement de la tigresse d’Autriche. Quelle leçon pour eux, f…! Comme ils auraient frémi en contemplant deux ou trois cent mille sans-culottes environnant le Palais et attendant en silence le moment où l’arrêt fatal allait être prononcé ! Comme ils auraient été petits ces prétendus souverains devant la majesté du peuple ! Non, f…! jamais on ne vit un spectacle pareil. Tendres mères, dont les enfants sont morts pour la République ; vous, épouses chéries des braves bougres qui combattent en ce moment sur les frontières, vous avez un moment étouffé vos soupirs et suspendu vos larmes, quand vous avez vu paraître devant ses juges la garce infâme qui a causé tous vos chagrins ; et vous, vieillards, qui avez langui sous le despotisme, vous avez rajeuni de vingt ans, en assistant à cette terrible scène : « Nous avons assez vécu, vous disiez-vous, puisque nous avons vu le dernier jour de nos tyrans. » »
Louis XVII au Temple : un mot d’enfant-roi et un vrai mystère d’État.
« Maman, est-ce qu’hier n’est pas fini ? »1388
Le dauphin LOUIS, futur « LOUIS XVII » (1785-1795), à Marie-Antoinette, fin juin 1791. Bibliographie moderne ou Galerie historique, civile, militaire, politique, littéraire et judiciaire (1816), Étienne Psaume
Un joli mot de l’enfant qui mourra quatre ans plus tard, à la prison du Temple.
L’épreuve de la fuite à Varennes blanchit (dit-on) les cheveux de la reine : de blond cendré, ils devinrent « comme ceux d’une vieille femme de soixante-dix ans ». Marie-Antoinette a sans aucun doute une part de responsabilité dans ce projet d’évasion mal préparé. Elle dit un jour à Fersen : « Je porte malheur à tous ceux que j’aime. »
« Lors même qu’il [Louis XVII] aura cessé d’exister, on le retrouvera partout et cette chimère servira longtemps à nourrir les coupables espérances. »1615
CAMBACÉRÈS (1753-1824), Discours tenu au nom des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation, Convention, 22 janvier 1795
Phrase prémonitoire, prononcée à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Louis XVI. À la tribune, l’orateur conclut contre la mise en liberté de son fils.
Le dauphin Louis XVII mourra officiellement au Temple le 8 juin de cette année – mais est-ce bien lui ou un autre enfant qui aurait pris sa place ?
Ce sera l’énigme du Temple, l’un des mystères de l’histoire de France, conforté par cette phrase étrange de Cambacérès, éminent juriste qui pèse toujours ses mots. Ne dit-on pas que l’enfant a déjà disparu en janvier ? Totalement isolé, il était très malade. L’énigme demeure, malgré toute la littérature qui s’ensuivra.
La « trahison d’Erfurt » en 1808 : Talleyrand, traître à Napoléon, mais fidèle à la France.
« Sire […] c’est à vous de sauver l’Europe et vous n’y parviendrez qu’en tenant tête à Napoléon. Le peuple français est civilisé, son souverain ne l’est pas. Le souverain de Russie est civilisé, son peuple ne l’est pas : c’est donc au souverain de Russie d’être l’allié du peuple français. »1833
TALLEYRAND (1754-1838), au tsar Alexandre Ier de Russie, Erfurt, 27 septembre 1808. Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)
Le « diable d’homme » n’est plus ministre des Relations extérieures depuis plus d’un an : partisan d’un équilibre européen, il s’est opposé à l’empereur qui s’entête dans sa politique de conquête chimérique, se soucie peu de paix et décide toujours seul.
Napoléon, qui connaît son talent diplomatique et ne peut décidément pas se passer de ses services, l’a chargé de préparer le terrain avec son nouvel allié russe, Alexandre Ier.
Dans un entretien secret, mais très commenté ensuite par les historiens, Talleyrand conseille au tsar de prendre ses distances avec l’empereur, et de ménager la Prusse et l’Autriche : « Le Rhin, les Alpes, les Pyrénées sont les conquêtes de la France. Le reste est la conquête de Napoléon. La France n’y tient pas. »
Alexandre a compris : le peuple français peut, un jour prochain, ne plus soutenir Napoléon. Et cet homme faible va durcir sa position. Dans ses Mémoires, Talleyrand affirme : « À Erfurt, j’ai sauvé l’Europe. » L’histoire parle quand même de la trahison d’Erfurt.
« Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous ne croyez pas à Dieu ; vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs, vous avez trompé, trahi tout le monde […] Tenez, Monsieur, vous n’êtes que de la merde dans un bas de soie. »1834
NAPOLÉON Ier (1769-1821), à Talleyrand, Conseil des ministres restreint convoqué au château des Tuileries, 28 janvier 1809. Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)
D’Espagne où il tente d’affermir le trône de son frère Joseph, Napoléon a appris que Talleyrand complote avec Fouché pour préparer sa succession : sans nouvelles de lui, on l’imagine victime de la guérilla qui fait rage.
Il rentre aussitôt, épargne momentanément Fouché, son ministre de la Police, mais injurie le prince de Bénévent, Talleyrand, impassible - et sort en claquant la porte.
« Quel dommage, Messieurs, qu’un si grand homme soit si mal élevé ! »1835
TALLEYRAND (1754-1838). Talleyrand, ou le Sphinx incompris (1970), Jean Orieux
La citation est parfaitement en situation, le 28 janvier 1809, après l’injure lancée devant témoins par l’empereur furieux. Talleyrand se venge de l’affront public, avec une certaine classe diplomatique. Il semble qu’il ait redit ce mot à divers ambassadeurs, toujours à propos de Napoléon.
« Je me suis mis à la disposition des événements et, pourvu que je restasse Français, tout me convenait. »1836
TALLEYRAND (1754-1838), Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)
Napoléon l’avait fait grand chambellan en 1804, prince de Bénévent en 1806, vice-grand électeur en 1807 - « le seul vice qui lui manquât », dit Fouché en apprenant cet honneur.
Le plus habile diplomate de notre histoire est aussi le plus corrompu. Il servira et trahira successivement tous les régimes, mais il respecte les intérêts supérieurs de la France. Il voudrait surtout lui éviter cette course à l’abîme, prévisible dès 1809. Fouché, tout aussi intelligent et retors, pense et agit de même.
Outre ses Mémoires, une bonne quinzaine de biographies, une abondante documentation et quelques fictions (comme Le Souper (1989) de Jean-Claude Brisville qui le met en scène avec Fouché, son compère et complice) … que faut-il en penser ? Un texte nous a semblé particulièrement intéressant, forme et fond.
« Toute sa vie Talleyrand a recherché le plaisir, la situation sociale et l’argent qui permet d’y accéder, voilà̀ le fond de son caractère. Une grande famille, beaucoup d’esprit, un gout raffiné, une belle intelligence, un sens de la prévision presque divinatoire, une absence totale de scrupules, voilà̀ les outils dont il disposait. Une époque troublée propice à toutes les ambitions et à tous les reniements, de la chance pour passer au travers des obstacles, voilà̀ les circonstances qui l’ont servi. »
Jacques JOURQUIN (1935-2021), rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien (mai juin 2000)
Parfait résumé de l’histoire. Il est devenu ministre des Relations extérieures en juillet 1797, sous le Directoire dont la corruption lui convient parfaitement. « Nous allons faire une immense fortune » a-t-il déclaré devant témoins à l’annonce de sa nomination. Il a vite compris qu’un certain général, vainqueur après sa (première) campagne Italie, peut devenir la puissance de demain, et il écrit aussitôt à Bonaparte : « J’ai besoin de me rassurer par le sentiment de ce que votre gloire doit apporter de moyens et de facilités dans les négociations [futur traité de Campoformio]. Le nom seul de Bonaparte est un auxiliaire qui doit tout aplanir. » Le général apprécie cette courtisanerie de haute volée. Le 26 octobre, Talleyrand récidive : « Voilà̀ donc la paix faite, et une paix à la Bonaparte. » On ne saurait être plus courtisan… et sincère.
Conviction personnelle et unique à l’époque, l’équilibre européen est un but supérieur à celui des intérêts français à court terme. Talleyrand tentera pendant dix ans de refréner l’esprit de conquête de Napoléon qu’il a, plus que quiconque pourtant, aidé à prendre le pouvoir lors du coup d’État 18 brumaire. Il fera tout pour dissuader l’empereur de « résoudre le problème anglais » en attaquant l’Angleterre par la Manche, puis en recourant au Blocus. Rappelons que sous la Monarchie de Juillet, encore influent et actif (jusqu’en Angleterre), il poussera Louis-Philippe à l’Entente cordiale (avec la reine Victoria), vision prémonitoire qui fera de la Grande-Bretagne, l’ennemie de toujours et de la Guerre de Cent Ans, notre première et précieuse alliée dans les deux guerres mondiales du XXe siècle !
Mais sous l’Empire, démis de ses fonctions ministérielles, Talleyrand se sent délié de ses engagements à servir un empereur peu clairvoyant et va s’employer par tous moyens – y compris par la trahison – à son objectif de paix durable européenne. Tout en ayant soin de monnayer ce bel idéal de traitre : « Quand M. de Talleyrand ne conspire pas, il trafique. » C’est Chateaubriand qui l’a dit.
« C’est quelque chose d’inexplicable que j’ai en moi et qui porte malheur aux gouvernements qui me négligent. »
TALLEYRAND (1754-1838), cité par Charles-Maxime Villemarest, M. de Talleyrand (1835)
En réponse à Louis XVIII qui lui avait demandé comment il a pu voir la fin de tant de régimes. Preuve d’un incommensurable orgueil et d’un réalisme politique confondant. Tel était son secret et tout le monde avait fini par le croire.
Le personnage de Cambacérès : double mystère en réalité connu, mais discret, homosexuel et franc-maçon.
« À sa mort, il [ Cambacérès] totalise plus de quarante années d’appartenance aux ordres maçonniques en général. »10
Daniel LIGOU (1921-2013), Dictionnaire de la franc-maçonnerie, « Cambacérès, Jean-Jacques Regis » (2017)
L’histoire de la franc-maçonnerie est exclue du champ de l’histoire universitaire classique jusqu’au milieu du XXe siècle. Le phénomène à la fois complexe et secret s’est structuré au fil des siècles autour d’un grand nombre de rites et de traditions, d’où la création d’une multitude d’obédiences qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles.
La franc-maçonnerie a toujours fait l’objet de nombreuses critiques et dénonciations, aux motifs très variables selon les époques et les pays. En France, son influence st particulièrement importante dans le milieu politique sous la Troisième République.
Difficile d’ignorer ce fait, mais impossible d’en mesurer les conséquences, d’où la discrétion de notre Histoire en citations à ce sujet. Même cas pour l’homosexualité, phénomène qui remonte à l’Antiquité où la chose était fort bien admise et pas seulement chez les Grecs. Au fil de l’Histoire, il est difficile de préciser ce qui devient de plus en plus secret. Mais le cas de Cambacérès est quand même très particulier.
« Quand on a rendez-vous avec l’Empereur, on dit à ces dames de prendre leurs cannes et leurs chapeaux et de foutre le camp. »
NAPOLÉON (1769-1821) à Cambacérès, un jour où l’Archichancelier de l’Empire arrivait en retard au rendez-vous, prétextant avoir été retenu par des dames
L’homosexualité de Cambacérès est un secret… de Polichinelle. Elle ne fait aucun doute à son époque et l’empereur est naturellement au courant, mais il peut s’en irriter si la chose le gêne en quoique ce soit. Le personnage joue malgré tout sur le paraître, au risque d’un certain ridicule…
« En public appelez-moi Altesse Sérénissime, mais entre nous, il suffit que vous m’appeliez Monseigneur. »
CAMBACÉRÈS (1753-1824), au marquis d’Aigrefeuille, l’un de ses plus proches collaborateurs
Reste l’homme d’État conscient de son importance, à l’égal d’un Talleyrand dont il fut parfois le rival ou le complice.
Selon son biographe Pierre-François Pinaud : « Il compte plutôt parmi ces grands commis, tout à la fois habile politique et savant juriste, dont la seule religion est de servir l’État quel que soit le régime et quel qu’en soit le prix à payer. » C’était aussi l’avis de l’historien Hippolyte Taine : « Il ne voulait jamais briller, mais être utile ».
Il reste avant tout comme le principal auteur du fameux Code civil « de » Napoléon.
« Après avoir longtemps marché sur des ruines, il faut élever le grand édifice de la législation civile. »1526
CAMBACÉRÈS (1753-1824), rapport fait à la Convention nationale sur le premier projet de Code civil, 21 août 1793. Archives parlementaires de 1787 à 1860 (1906), Assemblée nationale
Juriste sous l’Ancien Régime, nourri de la philosophie des Lumières, Jean-Jacques Régis de Cambacérès parle au nom du Comité de législation – une vingtaine de comités et sous-comités se répartissent le travail par secteurs (finances, instruction publique, marine, guerre, etc.) et préparent les textes pour l’Assemblée. C’est l’équivalent de nos commissions sous la Cinquième République.
Cambacérès présente son rapport le 9 août, puis décrit cet « édifice simple dans sa structure, majestueux dans ses proportions, grand par sa simplicité même, et d’autant plus solide que n’étant point bâti sur le sable mouvant des systèmes, il s’élèvera sur la terre ferme des lois de la nature, et sur le sol vierge de la République ».
Mis en chantier trois ans plus tôt par la Constituante, le projet sera trois fois rejeté : trop long et pas assez révolutionnaire, puis trop court, victime des courants politiques contraires… C’est quand même une étape importante dans l’histoire du droit.
« Le vaisseau de la République, tant de fois battu par la tempête, touche déjà le rivage. »1610
CAMBACÉRÈS (1753-1824), 9 octobre 1794. Adresse de la Convention nationale au peuple français, décrétée dans la séance du 18 Vendémiaire, An III de la République française, une et indivisible (1794), Pierre J. Ruffin
Cambacérès exprime ici le sentiment du pays qui veut la fin de la Révolution dans le calme. La réaction thermidorienne casse les instruments de la Terreur : Commune de Paris supprimée (remplacée par des Commissions avec président élu chaque mois), club des Jacobins fermé.
Alors que les prisons débordent et les dénonciations s’accumulent, la Convention va recourir à l’amnistie. Cambacérès a fort bien pu lui inspirer cette sagesse.
« Pour la gloire comme pour le bonheur de la République, il [le Sénat] proclame à l’instant même Napoléon empereur des Français. »1791
CAMBACÉRÈS (1753-1824), président du Sénat et du Conseil d’État, Déclaration du 18 mai 1804. Vie de Cambacérès, ex-archichancelier (1824), Antoine Aubriet, Tourneux
Une semaine avant, le Sénat conservateur (tel est son nom, hérité du Consulat, le précédent régime) a voté – à l’unanimité moins trois voix et deux abstentions – le projet de proclamation de l’Empire. Et Cambacérès joue parfaitement son rôle de double président. Napoléon est aussi soucieux de la forme que du fond et le personnage est l’homme de la situation.
« J’accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation. Je soumets à la sanction du peuple la loi d’hérédité. J’espère que la France ne se repentira jamais des honneurs dont elle environnera ma famille. »1792
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Adresse de l’empereur à Cambacérès et au pays, 18 mai 1804. Paroles et faits remarquables de Napoléon : empereur des Français et roi d’Italie (1805), Napoléon Ier
Moment solennel - il y en aura beaucoup d’autres, dans cet Empire qui multiplie les symboles. Les mots sont très forts, lourds de conséquences, pour la France, et pour Napoléon qui a revêtu son uniforme de colonel de la garde.
À la demande de Cambacérès, on n’attend pas la « sanction du peuple », et la mise en application de la Constitution de l’an X est immédiate. Le résultat du plébiscite pour l’Empire était évident : plus de 3,5 millions de oui, 2 579 non (août 1804).
« Il avait l’air de se promener au milieu de sa gloire. »1839
CAMBACÉRÈS (1753-1824), archichancelier de l’Empire et duc de Parme, parlant de Napoléon en 1809. Histoire du Consulat et de l’Empire (1847), Adolphe Thiers
La cinquième coalition, qui réunit l’Angleterre et l’Autriche en 1809, s’est vite soldée par la victoire de Napoléon sur l’Autriche. Défaite par la Grande Armée à Wagram (5 et 6 juillet), elle signe la paix de Vienne (14 octobre), perd 300 000 km2 et 3 500 000 habitants.
L’archichancelier est la charge honorifique créée par Napoléon Ier et conférée à l’ancien consul Cambacérès : elle lui va si bien ! Détenteur des sceaux qui viennent authentifier les titres de la noblesse d’Empire nouvellement créé, il vit son heure gloire en même temps que l’empereur : « Il est le Souverain de l’Europe » reconnait Metternich le nouveau chancelier d’Autriche. Cette domination culminera en 1811 : le Grand Empire comporte 130 départements qui réuniront 45 millions de « Français », plus 40 millions d’habitants des États vassaux (Italie, Espagne, Naples, duché de Varsovie, Confédération du Rhin, Confédération helvétique).
Cambacérès quittera le pouvoir en 1815 après la chute de l’Empereur, exilé un temps à Bruxelles. De retour à Paris en 1818 sous la Restauration, il vit à l’écart du pouvoir, moqué et même calomnié par une campagne de caricatures contre son homosexualité, qualifié de « girouette » pour son extrême prudence et sa capacité à se maintenir au pouvoir à travers les régimes. Il n’est pas le seul dans ce cas. Mais il l’est de manière caricaturale et fatalement démodée.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.