« 14, rien. »
LOUIS XVI (1754-1793)
Les auteurs de ces erreurs historiques sont plus ou moins connus et parfois célèbres – Louis XVI, Napoléon, de Gaulle…
Les erreurs, écrites ou parlées, portent sur un fait minime ou capital – 14 juillet 1789, déclaration de guerre de 1870, Affaire Dreyfus…
Elles peuvent être intentionnelles, pour manipuler l’opinion ou l’adversaire, relever d’une gaffe, une maladresse, une erreur de calcul ou de jugement, une aberration mentale… ou plus généralement d’un fait de société – sexisme séculaire, peur du progrès technique.
Certains cas sont dignes d’un bêtisier national dont il vaut mieux sourire que s’indigner, quoique les deux soient possibles !
Mais tous les exemples « font sens » – erreur lexicale d’après l’Académie française, anglicisme pourtant courant et commode. Chaque citation, avec son commentaire, renvoie à un personnage, un fait, une époque, et l’éclaire d’un jour nouveau ou du moins original.
D’où la raison d’être de cet édito en deux semaines et deux fois 20 citations, intégralement tirées de notre Histoire en citations – hormis le mot de la fin à ranger avec les « macronades » , néologisme d’actualité.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
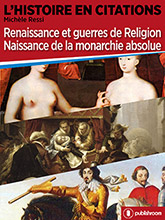 1. Des origines au Second Empire.
1. Des origines au Second Empire.
RENAISSANCE
« Ce gros garçon gâtera tout. » 435
LOUIS XII (1462-1515). Louis XII et François Ier ou Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne (1825), Pierre Louis Rœderer
Il parle de son cousin et successeur, le futur François Ier à qui il a fiancé sa fille Claude. Son exubérante et folle jeunesse doit effrayer Louis XII dit le « Père du peuple » . La mort de son épouse la reine Anne (9 janvier 1514) permet la célébration de ce mariage qui la contrariait. À peine veuf, il épouse lui-même la très jeune Marie d’Angleterre (sœur du roi Henri VIII), mais ne profitera pas longtemps de ses charmes. Il meurt le 1er janvier 1515.
Le « gros garçon » commence son règne par une victoire qui fait date dans l’Histoire : 1515, Marignan, presque aussi connue que 1789 et la prise de la Bastille. Avec la fougue de ses 21 ans, le nouveau roi se lance dans la cinquième guerre d’Italie, allié à Venise pour la reconquête du Milanais (pris, puis perdu par Louis XII). Son armée passe les Alpes, forte des meilleurs capitaines, avec 300 canons et 30 000 hommes : chiffres considérables à l’époque.
Le « César triomphant » conte aussitôt par le menu à sa mère Louise de Savoie la première partie de la bataille : « Et vous promets, Madame, que si bien accompagnés et si galants qu’ils soient, deux cents hommes d’armes que nous étions en défîmes bien quatre mille Suisses et les repoussâmes rudement, si gentils galants qu’ils soient, leur faisant jeter leurs piques et crier France. » Lettre à sa mère Louise de Savoie, au soir du 13 septembre 1515.
Les Suisses sont les alliés du duc de Milan : redoutables combattants, ils barraient l’accès de l’Italie en tenant les divers cols, milices paysannes redoutées pour leurs charges en masses compactes, au son lugubre des trompes de berger. À Marignan, ils ont dispersé dans l’après-midi la cavalerie française et vont s’emparer de l’artillerie quand François Ier, courageux et bien conseillé, prend le risque de charger. Le combat dure jusqu’au soir, l’épuisement est tel que les combattants qui ne sont pas morts tombent de sommeil sur place. Le lendemain, appelés en urgence, nos alliés vénitiens prennent les Suisses à revers, les obligeant à fuir pour se réfugier à Milan.
Victoire totale, mais la plus meurtrière depuis l’Antiquité. « Bataille de géants » , selon témoins et chroniqueurs, c’est également un carnage (toujours selon les critères de l’époque) : 14 000 Suisses tués, 2 500 Français et Vénitiens.
Au soir du 14 septembre, acte symbolique, le roi demande à Bayard, « le chevalier sans peur et sans reproche » passé dans la légende, de le faire chevalier sur le champ de bataille. Et François Ier restera dans l’Histoire comme le « Roi chevalier » de la Renaissance française, fasciné par l’art italien qu’il a découvert en conquérant et mécène de tous les poètes et artistes du « beau XVIe siècle » – aux antipodes du « gros garçon » qui gâtera tout !
SIÈCLE DE LOUIS XIV
« Dieu se sert de tous les moyens. » 899
Mme de MAINTENON (1635-1719). Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV (1849), duc Paul de Noailles
Au nom de la foi, la très catholique épouse (morganatique) de Louis XIV se résigne à la brutalité des dragonnades contre les protestants, avec les enfants systématiquement enlevés à leurs parents. Ironie de l’histoire, Mme de Maintenon – née Françoise d’Aubigné – est la petite-fille du très protestant Agrippa d’Aubigné : il s’est battu toute sa vie pour sa religion, déplorant que l’édit de Nantes, signé par son ami Henri IV, ne fît pas la part assez belle aux réformés !
Au siècle suivant, Voltaire, le grand avocat de la tolérance religieuse, mais aussi l’historien du Siècle de Louis XIV, porte ce jugement définitif : « La plaie de la révocation de l’édit de Nantes saigne encore en France. » (Lettre au comte de Schouvalof, 30 septembre 1767).
L’édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685 (enregistré le 22) révoque l’édit de Nantes (pris par Henri IV en 1598) : pasteurs bannis, écoles protestantes fermées, temples détruits, enfants des « nouveaux convertis » baptisés. Et interdiction de quitter la France sous peine de galères. La France ne s’en remettra pas de sitôt
SIÈCLE DES LUMIÈRES
« J’ose presque assurer que l’état de réflexion est un état contre nature et que l’homme qui médite est un animal dépravé. » 1036
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755)
C’est une provocation lancée à ce siècle épris de raison et à tous ses confrères qui font métier de penser ! Les réactions vont renforcer Rousseau dans son délire de la persécution… et son repli dans une solitude parfois qualifiée de préromantique.
Cette petite phrase va surtout faire réagir Voltaire, avec l’ironie qui lui va si bien : « J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain […] On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage. » Lettre à Jean-Jacques Rousseau, 30 août 1755.
Cet échange de « mots » dit clairement l’incompatibilité d’esprit entre les deux grands philosophes du siècle. Cinq ans plus tard, Rousseau écrit à son ami M. Moulton : « Je le haïrais davantage, si je le méprisais moins. » Les deux hommes s’opposent en tout. Rappelons le mot de Goethe : « Avec Voltaire, c’est un monde qui finit. Avec Rousseau, c’est un monde qui commence. » La Révolution va les réunir au Panthéon des grands hommes – et ce n’est que justice pour l’un comme pour l’autre !
« C’est détestable ! Cela ne sera jamais joué ! […] Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de la pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » 1234
LOUIS XVI (1754-1793), qui vient de lire Le Mariage de Figaro avant sa création sur scène. Encyclopædia Universalis, article « Le Mariage de Figaro »
Depuis quatre ans, Paris parle de cette pièce dont l’auteur, Beaumarchais, est déjà bien connu pour des raisons pas seulement littéraires – procès gagnés à divers titres, trafic d’armes et aide aux « Insurgents » d’Amérique contre l’Angleterre, première puissance coloniale de l’époque.
Soumise à six censeurs, interdite de représentation à Versailles au dernier moment en 1783, puis jouée en théâtre privé chez M. de Vaudreuil, le 23 septembre. Paris se presse pour la première publique à la Comédie-Française, le 27 avril 1784.
Figaro l’insolent met tout son esprit dans une tirade devenue célèbre : « Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l’opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de deux ou trois censeurs. »
Rappelons que la censure royale a remplacé la censure religieuse de la Sorbonne au XVIIe siècle : 79 censeurs ont charge d’autoriser ou d’interdire livres ou pièces, selon leur moralité. La censure inquiétera plus ou moins tous les philosophes qui iront se faire éditer en Suisse, Hollande, Angleterre. Abolie par la Révolution, rétablie en 1797, de nouveau abolie, rétablie, etc., ce sera une longue histoire dans l’Histoire jusqu’au début du XXe siècle.
Le théâtre, spectacle public, est exposé plus encore que le livre aux foudres ou aux tracasseries d’Anastasie aux grands ciseaux. Il est normal que Beaumarchais en traite, pour s’en moquer. En tout cas et n’en déplaise au roi, l’auteur a écrit là son chef-d’œuvre.
« Il y a quelque chose de plus fou que ma pièce, c’est son succès ! » dit l’auteur enchanté, après le triomphe de la création, à la Comédie-Française. Sous-titrée « La Folle Journée » , la pièce sera jouée plus de cent fois de suite – un record, sous l’Ancien Régime.
Mais Beaumarchais en fait trop, se retrouve à la prison de Saint-Lazare (mars 1785) et sa popularité ne sera plus jamais ce qu’elle fut au soir du Mariage qui prit valeur de symbole.
Autre symbole et autre bévue royale sous la Révolution, époque la plus riche en « mots » qui valent citations…
 RÉVOLUTION
RÉVOLUTION
« 14, rien. » 1331
LOUIS XVI (1754-1793), note ces deux mots dans son carnet avant de se coucher, château de Versailles, le soir du 14 juillet 1789. Histoire des Français, volume XVII (1847), Simonde de Sismondi
L’histoire lui a reproché cette indifférence à l’événement numéro un – précisons à sa décharge que le fameux carnet consigne surtout ses tableaux de chasse. En réalité, le jeune roi a été dépassé par les évènements, comme la plupart des contemporains. Louis XVI était particulièrement mal armé pour bien faire son « métier de roi » et trop indécis pour soutenir ses meilleurs conseillers.
Prévenu de l’agitation à Paris par une députation de l’Assemblée le 11 juillet, le roi a malencontreusement renvoyé Necker, ministre des Finances jugé trop libéral, mais c’est l’homme le plus populaire du royaume – il le rappellera le 16. Trop tard…
Le mal est fait : manifestations le 12 juillet, municipalité insurrectionnelle à l’Hôtel de Ville, milice et foule armées le 13 (avec 28 000 fusils et 20 canons pris aux Invalides). À la Bastille, le peuple est allé chercher la poudre et les munitions.
La forteresse est avant tout le symbole historique de l’absolutisme royal : la révolution parlementaire est devenue soudain populaire et parisienne, en ce 14 juillet 1789. Fait capital pour la suite…
Chateaubriand écrit dans ses Mémoires d’outre-tombe (posthume) : « La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique et je reculai. »
La tête « au bout d’une pique » est un classique de l’horreur révolutionnaire. La « première tête » peut être celle du gouverneur de la Bastille, le marquis Bernard René Jourdan de Launay (1740-1789), massacré par le peuple le 14 juillet, lors de la prise du fort. Chateaubriand, 21 ans, réformé de l’armée, hésitant sur sa vocation, s’est essayé à la vie politique au début de l’année en participant aux États de Bretagne (assemblée provinciale). Présent à Paris au début de la Révolution, il est très choqué par cette violence « cannibale » .
Représentatif de sa classe, il écrit aussi : « Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste. »
Autre réaction de notre second grand auteur romantique : « En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe. Elle met le peuple en appétit. » Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829).
Bilan du 14 juillet 1789 : une centaine de morts et un peu plus de blessés, essentiellement chez les assaillants (au nombre de 800 à 3 000, selon les sources). Mais Hugo a raison : le peuple est parti dans une escalade de la violence, et les meneurs parlent toujours plus fort que les modérateurs.
Pour en revenir au roi qui n’avait littéralement « rien » à noter sur son carnet de chasse à la date du 14, il est réveillé au soir du 14 juillet à Versailles : le grand maître de la garde-robe s’est permis de venir dans la nuit, pour l’informer que la Bastille est prise et le gouverneur assassiné. « Mais c’est une révolte ?— Non, Sire, c’est une révolution ! » Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt avait compris mieux que son maître l’importance symbolique du fait. Ce bref dialogue résume bien la situation…
Mais contrairement à ce que l’on croit trop souvent, ce jour n’est pas à l’origine de notre fête nationale. Il faut attendre l’année suivante, la Fête de la Fédération.
« J’ai l’âge du sans-culotte Jésus ; c’est-à-dire trente-trois ans, âge fatal aux révolutionnaires ! » 1583
Camille DESMOULINS (1760-1794), au Tribunal révolutionnaire lui demandant son nom, son âge, 2 avril 1794. Œuvres de Camille Desmoulins (posthume, 1874), Camille Desmoulins, Jules Claretie
Petite erreur historique. En réalité, il vient d’avoir 34 ans.
Mais le rapprochement avec cet « anarchiste qui a réussi » (selon le mot d’André Malraux dans L’Espoir, 1937) fait référence. Le capucin Chabot l’a également proclamé au début de la Terreur de septembre 1793, assurant publiquement que le « citoyen Jésus-Christ a été le premier sans-culotte du monde » .
Montagnard à la Convention, Desmoulins a combattu les Girondins – leur mise à mort l’a pourtant bouleversé. La Révolution prenait un nouveau tour, dénoncé aussi par son confrère député Pierre Victurnien Vergniaud qui en sera également victime : « Il a été permis de craindre que la Révolution, comme Saturne, dévorât successivement tous ses enfants. »
Desmoulins fonde alors un journal, Le Vieux Cordelier, pour défendre la politique de Danton contre celle du Comité de salut public (où Robespierre fait la loi avec Couthon et Saint-Just). À peine a-t-il le temps de s’émouvoir de la nouvelle épuration – celle des Enragés – qu’il est arrêté le 30 mars, guillotiné le 5 avril. Lucile, sa femme adorée (fille naturelle de l’abbé Terray, ministre de Louis XV), montera à l’échafaud le 13 avril.
« La République n’a pas besoin de savants. » 1587
Jean-Baptiste COFFINHAL–DUBAIL (1754-1794), vice-président du Tribunal révolutionnaire, à Lavoisier, 8 mai 1794. Mot parfois attribué à René François DUMAS (1753-1794), président du Tribunal, et même à FOUQUIER–TINVILLE (1746-1795), le plus célèbre accusateur public. Lavoisier, 1743-1794 (1899), Édouard Grimaux
Le condamné demandait qu’on diffère l’exécution de quelques jours, le temps de terminer une expérience. Un de ses collègues, le médecin J.N. Hallé, était venu présenter au tribunal un rapport énumérant les services rendus à la patrie par l’illustre chimiste : « Il faut que la justice suive son cours » , tranche l’homme du Tribunal.
Antoine-Laurent de Lavoisier est donc condamné et guillotiné le jour même, avec 27 collègues de la Ferme générale. Car tel est son crime : avoir été fermier général (collecteur d’impôts) sous l’Ancien Régime.
Mort à 51 ans, ce grand savant, élu à 25 ans à l’Académie des sciences, laisse en héritage les bases de la chimie moderne et une loi qui porte son nom, sur la conservation de la masse et des éléments chimiques. En résumé : « Rien ne se perd, rien ne se crée. »
« Il ne leur a fallu qu’un moment pour faire tomber cette tête, et cent années peut-être ne suffiront pas pour en produire une semblable. » Louis de Lagrange (1736-1813 à J.-B. Delambre, déplorant la mort de Lavoisier au lendemain de son exécution, le 9 mai 1794. Parole d’un confrère de Lavoisier, né Italien, grand mathématicien et physicien, qui rend hommage au plus éminent représentant de la science française en cette fin du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Delambre est lui-même mathématicien et astronome, membre de l’Académie des sciences.
La science paie un lourd tribut à la Révolution avec Lavoisier, guillotiné après Bailly, et Condorcet (suicidé pour échapper à l’échafaud). Mais la science est également honorée. À l’initiative du mathématicien Gaspard Monge, l’École polytechnique est créée le 11 mars 1794. Sa devise : « Pour la patrie, les sciences et la gloire. »
PREMIER EMPIRE
« C’est la dernière fois que j’entre en discussion avec cette prêtraille romaine. » 1829
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre à Eugène de Beauharnais, 22 juillet 1807. « L’Église romaine et les Négociations du Concordat (1800-1814) » , Revue des deux mondes, tome LXXII (1867)
Le mot est rude. La « prêtraille » , c’est le pape Pie VII (1742-1823. Et l’empereur fait erreur, sous-estimant gravement cet adversaire digne de lui, qui le traitera bientôt de « Commediante ! Tragediante ! »
Pie VII refuse d’annuler le mariage (américain) de Jérôme Bonaparte, le cadet de ses quatre frères, mineur à l’époque. Il refuse aussi de se joindre au blocus déclaré contre l’Angleterre, au nom de sa neutralité de pasteur universel.
Napoléon menace et charge Eugène, son beau-fils (qu’il a fait vice-roi d’Italie), de passer le message : « Si l’on veut continuer à troubler les affaires de mes États, je ne reconnaîtrai le pape que comme évêque de Rome […] Je ne craindrai pas de réunir les Églises gallicane (française), italienne, allemande, polonaise, dans un concile pour faire mes affaires sans pape. » … Ce qui se fera, en 1811.
Après le Concordat de 1801, compromis religieux qui satisfait les deux partis, et le Sacre de 1804 qui comble l’orgueil de l’empereur, les relations des deux hommes vont tourner au drame. Napoléon annexe les États de l’Église, le pape va l’excommunier, l’empereur le fait enlever et le maintient prisonnier durant cinq ans. C’est L’Otage (1911) dans le drame historique en trois actes de Paul Claudel.
L’Histoire a fait se rencontrer ces deux grands personnages et le pape survivra en tant que tel à l’empereur déchu, prisonnier des Anglais à Sainte-Hélène.
RESTAURATION
« J’avais demandé vingt ans ; la destinée ne m’en a donné que treize. » 1950
NAPOLÉON Ier (1769-1821), au lendemain de Waterloo. Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’empereur Napoléon III (1858)
Notes sur les « Lettres écrites de Paris pendant le dernier règne de l’empereur Napoléon » , entre le 8 avril et le 20 juillet.
La phrase est exacte, mais pas le compte. En 1802, Napoléon Bonaparte, Premier Consul, est déjà maître de la France et de son destin, depuis le coup d’État de Brumaire (1799), et même depuis la campagne d’Italie qui lui apporta la gloire avec la popularité, dès 1797. Les historiens parlent généralement d’une aventure de vingt-deux ans.
Paradoxalement, cet épisode des Cent-Jours, catastrophique pour la France, va nourrir le mythe : Napoléon est redevenu un héros, il a forcé le destin jusqu’à la fin, et la légende va suivre, défiant le temps et la vérité des faits historiques.
« Sire, cent jours se sont écoulés… » 1955
Comte de CHABROL (1773-1843), préfet de la Seine, accueillant Louis XVIII, 8 juillet 1815. L’Épopée impériale, d’Ajaccio à Sainte-Hélène (1865), Jules Mazé
Le comte Gilbert-Joseph-Gaspard Chabrol de Volvic attend à la barrière Saint-Denis le roi qui rentre dans sa « bonne ville de Paris » , et lui fait cette adresse : « Sire, cent jours se sont écoulés depuis le moment fatal où Votre Majesté, forcée de s’arracher à ses affections les plus chères, quitta sa capitale au milieu des larmes et de la consternation publique… » Etc., etc.
Premier paradoxe : l’expression apparaît le jour même où s’achève la période des Cent-Jours. C’est le premier chrononyme créé « en direct » – portion de temps à laquelle la communauté sociale attribue une cohérence, ce qui s’accompagne du besoin de la nommer. Et l’on parle toujours des Cent-Jours, comme de la Renaissance, la Belle Époque, les Années folles.
Second paradoxe : il y a erreur de calcul. Le roi a fui le 20 mars, et cent neuf jours se sont donc écoulés depuis le moment fatal où…
Les mots d’histoire ne font pas toujours bon ménage avec les chiffres. Mais si le mot est bon, qu’importe l’erreur de calcul.
« Non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais encore il était d’excellente famille du côté de sa mère. » 2000
Mgr Hyacinthe-Louis de QUÉLEN (1778-1839), 125e archevêque de Paris (de 1821 à sa mort). Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière
Authentique perle de bêtisier, signée de l’archevêque de Paris ! Ce mot qui lui est attribué trahit bien l’homme de son temps…
Chacun a naturellement à cœur de mettre Jésus dans son camp : sous la Révolution, Chabot, capucin défroqué, en fit le premier sans-culotte de l’histoire ! Pour le révolutionnaire Camille Desmoulins condamné à l’échafaud, le plus illustre supplicié fut aussi une référence. L’archevêque de Paris se situe aux antipodes de l’échiquier politique.
Très en cour auprès de Louis XVIII, puis de Charles X, élu à l’Académie française contre Casimir Delavigne en 1824, il attribua cet honneur à la religion, et non à ses titres académiques, dans son discours de réception – saluons cette preuve de lucidité. Membre de la Chambre des Pairs, incarnation de l’Ancien Régime, en plein sermon, il lâcha cette célèbre formule, propre à scandaliser libéraux et républicains.
Moins bien vu sous la Monarchie de Juillet qui le considère comme (trop) légitimiste, il demeure archevêque, Dieu merci !
MONARCHIE DE JUILLET
« Il nous semble que notre Paris, ce Paris dont on aime le mouvement, l’animation et le bruit, perdrait beaucoup de son charme, si les 50 000 voitures qui, tous les jours circulent à sa surface, n’en sillonnaient plus les rues, et se trouvaient en grande partie remplacées par des convois s’engouffrant dans les entrailles de la terre. » 2090
Louis FIGUIER (1819-1894), L’Année scientifique et industrielle (1837)
Dans cette publication sous-titrée Exposé annuel des travaux scientifiques, des inventions et des principales applications de la science à l’industrie et aux arts, qui ont attiré l’attention publique en France et à l’étranger, le très sérieux vulgarisateur scientifique reconnaît que le réseau de chemins de fer souterrain proposés par M. Le Hir comporte d’admirables détails, ajoutant cependant qu’il menace la solidité des constructions parisiennes : « Ce travail de taupe ne s’accomplirait point sans de graves inquiétudes pour les 40 000 maisons et le million d’habitants dont se compose Paris. »
Il faut attendre la fin du siècle et les embouteillages monstres pour que le métropolitain soit reconnu d’utilité publique (loi de 1898) et que les travaux commencent.
Figuier avait pourtant raison sur un point : des effondrements de terrain perturberont et endeuilleront les chantiers. Mais rien n’arrête le progrès et au XXe siècle, ce nouveau mode de transport urbain se révèlera indispensable, dans toutes les métropoles du monde.
Les premiers chemins de fer en surface vont s’imposer plus vite, quoique posant à leur tour beaucoup d’autres problèmes et offrant aux hommes politiques (même intelligents) l’occasion de grosses erreurs.
« Il faudra donner des chemins de fer aux Parisiens comme un jouet, mais jamais on ne transportera ni un voyageur ni un bagage. » 2091
Adolphe THIERS (1797-1877), aux frères Pereire demandant une aide financière, 1836. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Les frères Péreire (Émile (1800-1875) et Isaac (1806-1880), banquiers juifs, entrepreneurs et hommes d’affaires français, vont avoir un rôle capital dans le « décollage industriel » de la France du Second Empire. Ils créèrent et développèrent de nombreuses entreprises dans la banque, les assurances, l’immobilier commercial et résidentiel, les transports maritimes… et les chemins de fer.
Un an après la prédiction pessimiste et erronée du ministre de l’Intérieur Adolphe Thiers, ils lancent la ligne Paris-Saint-Germain, inaugurée le 24 août 1837, avec la première locomotive française (des usines Schneider). Le réseau ne sera vraiment organisé qu’en 1842 et 1 930 km seront construits en 1848.
Après la frayeur des premières années, c’est l’engouement du public et la modernisation indispensable à l’économie française, très en retard sur l’Angleterre.
Mais l’on imagine mal la complexité de l’entreprise, son coût humain et financier, surtout à l’échelle du pays. Les trains déraillant dans les virages, il faut tracer des lignes droites, dans une France agricole aux propriétés morcelées. Il faut creuser des tunnels sous les montagnes, lancer des ponts sur les rivières. Les compagnies de diligences font tout pour retarder ou saboter les travaux. Cependant que les chantiers créent un prolétariat qui ne revient plus aux champs et se retrouve au chômage.
Malgré tout, quand un progrès doit s’accomplir, il le fait quel que soit le coût humain, financier, social, environnemental. C’est l’une des leçons de l’histoire.
Autre leçon : la pérennité de certaines erreurs « naturelles » …
« Naturellement, et par une de ces lois providentielles où le droit et le fait se confondent, le droit de suffrage n’appartient pas aux femmes. La Providence a voué les femmes à l’existence domestique. » 2124
François Guizot (1787-1874), La Démocratie pacifique, 10 janvier 1847. Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière
Ce mot fera le bonheur des histoires du féminisme et des dictionnaires de la misogynie.
Le replacer dans son contexte n’y change rien – à l’inverse du fameux « Enrichissez-vous ! … par le Travail et par l’Épargne » qu’a bien dit Guizot, Président du Conseil, plusieurs fois ministre (et historien).
Il faut seulement le resituer dans son époque et rappeler à quel point le XIXe siècle est dur au sexe faible, avec son Code civil, sa mode du corset qui coupe le souffle aux femmes du monde (d’où les évanouissements pas toujours feints !), et le travail aux champs comme à l’usine, qui épuise les femmes du peuple (et les enfants).
La Deuxième République ne sera pas plus favorable aux femmes et le socialiste Proudhon ne se montrera pas plus indulgent que Guizot, ministre de la droite chrétienne, conservatrice et réactionnaire, sous la Monarchie de Juillet.
Le XIXe siècle est assurément le plus misogyne de l’Histoire ! Les erreurs de jugement sont signées des plus grands noms, y compris sous la République à venir et le nouvel Empire…
DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
« Nous ne comprenons pas plus une femme législatrice qu’un homme nourrice. » 2197
Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865), Le Peuple, mai 1849. Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière
Il écrit aussi, en janvier 1849, dans L’Opinion des femmes : « La femme ne peut être que ménagère ou courtisane. »
Bien que socialiste, Proudhon s’inscrit dans la logique de son temps et de cette Deuxième République : « Nous ne savons si, en fait d’aberrations étranges, le siècle où nous sommes est appelé à voir se réaliser à quelque degré celle-ci : l’émancipation des femmes. Nous croyons que non. » (La Liberté, 15 avril 1848).
L’erreur est celle de son temps. Mais cet homme de gauche la martèle avec une insistance particulière. Son principal adversaire Karl Marx ne s’est pas vraiment engagé en faveur des femmes – ni contre.
SECOND EMPIRE
« C’est l’absence des femmes qui permet aux hommes d’aborder journellement les questions sérieuses. » 2196
Louis-Napoléon BONAPARTE (1808-1873), Améliorations à introduire dans nos mœurs et nos habitudes parlementaires (1856).
C’est incontestablement une erreur – qui peut faire sourire, ou pas…
Mais parler ici de misogynie serait pécher par anachronisme. À l’époque, même une « féministe » comme George Sand (qui dénierait ce qualificatif) repousse l’idée de la femme entrant en politique. Elle refusera absolument ce rôle qu’on voulait lui donner, bien que très engagée à gauche après la révolution de février 1848.
La « bonne Dame de Nohant » le sera moins dans la suite des évènements. Elle conseilla Ledru-Rollin dans la coulisse, mais les journées de Juin 1848 ont brisé son beau rêve de république « dure et pure » . Profondément désabusée, elle se réfugie alors à Nohant. Dans son journal quotidien, elle n’aura pas de mots assez durs pour la Commune de 1871 : « C’est une émeute de fous et d’imbéciles mêlés de bandits. » La participation des femmes en général et de la Vierge rouge en particulier – Louise Michel sur les barricades – ne modifiera en rien sa position. Et les féministes militantes continueront de prêcher dans le désert et souvent le ridicule de tous les excès.
En Angleterre, les militantes qui se battent sous les appellations de « suffragistes » et de « suffragettes » , sont moquées, bousculées, frappées, emprisonnées, et même tuées… avant d’obtenir le droit de vote pour les femmes en 1918. En France, il faut attendre le préambule de la Constitution de 1946 pour que soit reconnu le principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines – y compris le vote et l’éligibilité.
« Il y a aussi plusieurs sortes de Liberté. Il y a la Liberté pour le Génie, et il y a une liberté très restreinte pour les polissons. » 2272
Charles BAUDELAIRE (1821-1867), Notes et Documents pour mon avocat (1857)
Grave erreur. C’est oublier l’égalité des droits, un principe à valeur constitutionnelle depuis la Révolution. Mais Baudelaire est Poète, cherchant à faire du Mal un objet de contemplation esthétique : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. » .
25 juin 1857, Les Fleurs du mal sont publiées. Elles font scandale : immorales, triviales, géniales. Baudelaire paraît devant le tribunal correctionnel. Il écrit aussi pour sa défense : « Il était impossible de faire autrement un livre destiné à représenter l’agitation de l’esprit dans le mal. » Son avocat n’aura pas gain de cause.
Baudelaire est condamné à trois mois de prison pour outrage aux mœurs. Il se soumet : dans la seconde édition de 1861, les six poèmes incriminés auront disparu. De 1861 à 1868, l’ouvrage est réédité dans trois versions successives, enrichies de nouveaux poèmes ; les pièces interdites paraissent en Belgique. La réhabilitation n’interviendra que près d’un siècle plus tard, en mai 1949.
La même année 1857, l’immoralité de Madame Bovary mène Flaubert en justice. Mais son avocat obtient l’acquittement. Il plaide qu’une telle lecture est morale : elle doit entraîner l’horreur du vice et l’expiation de l’épouse coupable est si terrible qu’elle pousse à la vertu…
À la même époque, le génie d’Offenbach s’exprime au théâtre – l’humour et la musique aident à faire passer son apologie de l’adultère et ses bacchanales orgiaques. Dans l’Angleterre beaucoup plus puritaine, l’art n’a pas cette relative liberté.
« L’extrême rapidité des voyages en chemin de fer est une chose anti médicale. Aller, comme on fait, en vingt heures, de Paris à la Méditerranée, en traversant d’heure en heure des climats si différents, c’est la chose la plus imprudente pour une personne nerveuse. Elle arrive ivre à Marseille, pleine d’agitation, de vertige. » 2282
Jules MICHELET (1798-1874), La Mer (1861)
C’est un grand classique de l’erreur historique : pratiquement tous les progrès techniques ont commencé par susciter la peur ou le déni d’utilité. Et le XIXe siècle, particulièrement riche en inventions, pourrait alimenter un étonnant bêtisier technologique.
Le chemin de fer n’échappe pas à la règle. Rappelons le mot de Thiers, en 1836 : « Il faudra donner des chemins de fer aux Parisiens comme un jouet, mais jamais on ne transportera ni un voyageur ni un bagage. »
Depuis le début du Second Empire, le réseau ferroviaire s’étend et rattrape enfin le retard pris sur l’Angleterre. L’État fixe le tracé des voies et finance les infrastructures (terrassement, ouvrages d’art), concédant l’exploitation des lignes à de grandes compagnies privées, Compagnies de l’Ouest, du Nord, de l’Est, et le fameux PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) né en 1857, axe vital de 862 km. Facteur essentiel de l’aménagement du territoire, le réseau passe de 3 000 km en 1852 à 17 000 km en 1870. Il s’inscrit désormais dans le paysage français, et toute l’économie du pays en bénéficie.
Mais que d’inquiétudes, pour la santé des passagers ! E Michelet, l’historien romantique, n’est pas seul à s’en émouvoir.
Selon François Arago, polytechnicien, astronome et physicien, mort en 1853 et témoignant donc des tout premiers chemins de fer, « le transport des soldats en wagon les efféminerait » et les voyageurs sont mis en garde contre le tunnel de Saint-Cloud, qui peut causer « des fluxions de poitrine, des pleurésies et des catarrhes. » Encore quelques perles dignes du bêtisier national.
« Nous pouvons maintenant envisager l’avenir sans crainte. » 2305
NAPOLÉON III (1808-1873), Corps législatif, 8 mai 1870. Les Révoltes de Paris : 1358-1968 (1998), Claude Dufresne
Erreur politique majeure : quatre mois après, la défaite militaire de Sedan entrainera l’effondrement du Second Empire. Et pourtant…
L’empereur a joué et gagné, en refaisant appel directement au peuple, comme il y a vingt ans : « J’ai retrouvé mon chiffre » , dit-il. « Mon enfant, tu es sacré par ce plébiscite. L’Empire libéral, ce n’est pas moi, c’est toi ! » assure-t-il à son fils adoré, le Prince impérial (1856-1879).
L’empereur rayonne et en oublie sa souffrance (maladie rénale dite « de la pierre » dont il mourra ), après le plébiscite triomphal du 8 mai : 7 350 000 oui (et 1 538 000 non) pour approuver le sénatus-consulte du 20 avril 1870. L’Empire devient une monarchie parlementaire : ministres responsables devant les Chambres qui ont aussi l’initiative des lois.
L’opposition républicaine se divise et Gambetta résume l’opinion générale : « L’Empire est plus fort que jamais ! » Lui aussi fait erreur. C’est oublier la Prusse de Bismarck, surnommé le Chancelier de fer. « Par le fer et par le sang » est une expression qui lui est chère, tout comme « la force prime le droit » – traduction de sa Realpolitik.
« Nous l’acceptons le cœur léger. » 2311
Émile OLLIVIER (1825-1913), Corps législatif, le jour de la déclaration de guerre à la Prusse, 19 juillet 1870. Les Causes politiques du désastre (1915), Léon de Montesquiou
Coûteuse erreur de jugement politique sur la situation.
Porté par l’opinion publique, le président du Conseil et garde des Sceaux accepte la responsabilité de la guerre, alors que des intervenants (républicains et pacifistes) évoquaient le sang bientôt versé. Il insiste sur ces mots qui lui seront reprochés jusqu’à sa mort : Émile Ollivier reste à jamais pour l’histoire « l’homme au cœur léger » .
Et la France chante à l’unisson… « Prussiens ! vous fuirez, battant la retraite / Devant nos drapeaux / Et nos Chassepots, / Oui, notre aigle altier qui n’a qu’une tête / S’ra victorieux, / Et pourtant le vôtre en a deux ! (Refrain) Zim la la, zim la la, les beaux militaires, / Zim la la, zim la la, que ces Prussiens-là ! » Ces beaux Prussiens (1870).

