« 14, rien. » 1331
LOUIS XVI (1754-1793)
Les auteurs de ces erreurs historiques sont plus ou moins connus et parfois célèbres – Louis XVI, Napoléon, de Gaulle…
Les erreurs, écrites ou parlées, portent sur un fait minime ou capital – 14 juillet 1789, déclaration de guerre de 1870, Affaire Dreyfus…
Elles peuvent être intentionnelles, pour manipuler l’opinion ou l’adversaire, relever d’une gaffe, une maladresse, une erreur de calcul ou de jugement, une aberration mentale… ou plus généralement d’un fait de société – sexisme séculaire, peur du progrès technique.
Certains cas sont dignes d’un bêtisier national dont il vaut mieux sourire que s’indigner, quoique les deux soient possibles !
Mais tous les exemples « font sens » – erreur lexicale d’après l’Académie française, anglicisme pourtant courant et commode. Chaque citation, avec son commentaire, renvoie à un personnage, un fait, une époque, et l’éclaire d’un jour nouveau ou du moins original.
D’où la raison d’être de cet édito en deux semaines et deux fois 20 citations, intégralement tirées de notre Histoire en citations – hormis le mot de la fin à ranger avec les « macronades » , néologisme d’actualité.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
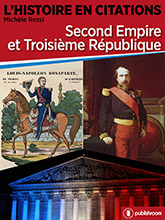 2. De la Troisième République à nos jours.
2. De la Troisième République à nos jours.
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
« L’Assemblée refuse la parole à M. Victor Hugo, parce qu’il ne parle pas français ! » 2357
Vicomte de LORGERIL (1811-1888), Assemblée nationale, Bordeaux, 8 mars 1871. Actes et Paroles. Depuis l’exil (1876), Victor Hugo
Erreur en forme de provocation et d’injure, lancée au grand homme de la France au faîte de sa gloire et sa popularité, revenu d’un exil de vingt ans pour se battre au côté des Français en guerre contre l’Allemagne !
Ce député monarchiste, poète à ses heures, coupe la parole à l’élu de Paris. Hugo le républicain est déjà monté à la tribune pour condamner la paix infâme conclue le 1er mars avec la Prusse et pour déplorer que Paris soit décapitalisé au profit de Bordeaux, le 6.
En cette séance houleuse du 8, Hugo se fait insulter pour avoir défendu l’Italien Garibaldi, élu député d’Alger : il conteste l’invalidation de ce vieux révolutionnaire italien « venu mettre son épée au service de la France » dans la guerre contre les Prussiens. Mais Hugo va démissionner et regagner Paris, pour enterrer son fils Charles, mort d’apoplexie…
« L’Année terrible » est un recueil de poèmes de Hugo publié en 1872. Il retrace l’année 1870-1871, la défaite de la France, le soulèvement de la classe ouvrière à Paris… La haine est elle-même terrible entre l’Assemblée monarchiste, pacifiste, repliée à Bordeaux et bientôt à Versailles, et Paris où les forces révolutionnaires, remobilisées, refusent de reconnaître le pouvoir de cette « assemblée de ruraux » défaitistes. D’où la Commune de Paris proclamée le 28 mars 1871, insurrection finalement réprimée dans le sang, le 28 mai.
« Si vous décidez la construction de la tour de M. Eiffel, je me coucherai sur le sol. Il ferait beau voir que les piques des terrassiers frôlent cette poitrine que n’atteignirent jamais les lances des Uhlans [Prussiens]. » 2484
Tancrède BONIFACE (XIXe siècle). Guide de Paris mystérieux (1975), François Caradec, Jean-Robert Masson
Son nom est passé à la postérité pour ce mot d’ailleurs non suivi d’effet !
Capitaine de cuirassier à la retraite, riverain du Champ de Mars, il mène la campagne de protestation contre la Tour Eiffel et intente un procès contre « le lampadaire tragique » , « l’odieuse colonne de tôle boulonnée. »
Le premier coup de pioche des travaux a été donné le 26 janvier 1887. La tour sera le « clou » de l’Exposition universelle, en 1889. Mais le monument va déjà beaucoup faire parler de lui à Paris, au fur et à mesure de son édification.
« Nous sommes arrivés au maximum de ce que peuvent les humains. Il serait criminel de chercher à aller plus haut » affirme Eugène Chevreuil, doyen de l’Institut : il a 101 ans – né sous Louis XVI, chimiste entré à l’Académie des sciences sous le règne de Charles X.
Il s’inquiète devant la tour qui va atteindre 26 mètres – le premier étage – et donne d’ailleurs quelques soucis à l’ingénieur Gustave Eiffel, avant de continuer son irrésistible ascension.
« La tour Eiffel, témoignage d’imbécillité, de mauvais goût et de niaise arrogance, s’élève exprès pour proclamer cela jusqu’au ciel. C’est le monument-symbole de la France industrialisée ; il a pour mission d’être insolent et bête comme la vie moderne et d’écraser de sa hauteur stupide tout ce qui a été le Paris de nos pères, le Paris de nos souvenirs, les vieilles maisons et les églises, Notre-Dame et l’Arc de Triomphe, la prière et la gloire. » 2497
Édouard DRUMONT (1844-1917), La Fin d’un monde (1889)
Mon vieux Paris (1878), premier livre qui le fait connaître, déborde de nostalgie pour cette capitale où il est né et qui a tant changé, depuis le Second Empire et les travaux contestés et chansonnés du baron Haussmann, préfet de Paris.
La Tour Eiffel ne pouvait que déchaîner sa colère et son mépris, dans ce nouveau livre qualifié d’« étude psychologique et sociale » . La Fin d’un monde dresse un portrait acerbe de la société bourgeoise et du mythe socialiste naissant. Bourgeois et socialistes représentent ici les figures du Progrès qui s’opposent aux Français catholiques : artisans, laboureurs, gardes-chasse, filandières, paysans, partageant leur vie entre le travail et la prière. L’auteur dresse le portrait d’une civilisation qui s’effondre lentement, insidieusement, s’effectuant par le remplacement de l’homme religieux par l’homme matérialiste.
« Que sortira-t-il du chaos au milieu duquel un monde, que l’on connaît trop bien pour admettre qu’il puisse vivre, se heurte à un monde qu’on ne connaît pas encore, qu’on ne voit jusqu’ici qu’à l’état nébuleux ? Quelles sont au fond les chances d’avenir, les doctrines exactes et la valeur pratique des systèmes par lesquels les socialistes prétendent remédier à l’anarchie actuelle ? Telle est l’étude que nous nous proposons en commençant cet ouvrage. »
Écrivain et journaliste, Drumont reste surtout connu comme polémiste d’extrême droite, naturellement anti-dreyfusard
« Sa tour ressemble à un tuyau d’usine en construction, à une carcasse qui attend d’être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel. » 2498
Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907), évoquant Eiffel et sa Tour, Écrits sur l’art – Certains (1894)
Erreur de jugement ? Dès la présentation de son projet en 1886, Gustave Eiffel lui-même savait que seule l’utilité scientifique de la Tour pouvait la préserver de ses adversaires et prolonger sa durée de vie. Elle devait en effet être détruite au bout de 20 ans !
L’architecte, également ingénieur et industriel, précise alors la vocation de la Tour : observations météorologiques et astronomiques, expériences de physique, poste d’observation stratégique, poste de communication par télégraphe optique, phare pour l’éclairage électrique et études du vent. Il précise : « Ce sera pour tous un observatoire et un laboratoire tel qu’il n’en aura jamais été mis d’analogue à la disposition de la science. C’est la raison pour laquelle, dès le premier jour, tous nos savants m’ont encouragé par leurs plus hautes sympathies » .
De fait, la Tour Eiffel sera sitôt utilisée comme un laboratoire de mesures et d’expériences scientifiques. De nombreux appareils scientifiques y sont installés (baromètres, anémomètres, paratonnerres…). Eiffel lui-même se réserve un bureau au troisième étage pour y faire des observations d’astronomie et de physiologie.
Le monument est officiellement inauguré le 6 mai 1889, pour la nouvelle Exposition universelle et le centenaire de la Révolution. Trois cents personnalités ont écrit pour protester contre la construction de la tour Eiffel, encore plus attaquée en son temps que le Centre Beaubourg de Renzo Piano et Richard Rogers, ou l’Opéra Bastille de Carlos Ott, un siècle plus tard.
Des savants prédisent sa chute, mais c’est le triomphe des ingénieurs sur les architectes, le défi réussi de l’acier utilisé à l’extrême de ses possibilités – comme la pierre dans les cathédrales du Moyen Âge, le verre et le béton dans l’Arche de la Défense.
Si la Tour était une attraction à ses débuts, elle devient dans les années 1920 un symbole de modernité et d’avant-garde. Son image est aujourd’hui le symbole de Paris aux yeux du monde. C’est dire si tous les jugements qui l’ont accablée à sa naissance peuvent être rangées dans la catégorie des erreurs historiques.
« Il n’y a pas d’affaire Dreyfus. » 2516
Jules MÉLINE (1838-1925), président du Conseil, au vice-président du Sénat venu lui demander la révision du procès, séance du 4 décembre 1897. Affaire Dreyfus (1898), Edmond de Haime
Erreur politique ou judiciaire ? En tout cas, mot malheureux, quand éclate au grand jour l’affaire Dreyfus qui deviendra l’« Affaire » de la Troisième République – et la plus grave crise pour le régime.
22 décembre 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, officier français d’origine alsacienne et de confession juive, est dégradé et condamné par le conseil de guerre à la déportation à vie en Guyane, accusé d’avoir transmis des documents secrets à l’empire allemand – après la découverte dans une corbeille d’un bordereau d’envoi aux services allemands de notes relatives aux activités militaires de la France…
Procès truqué, pièces falsifiées : l’officier ne cessera pas de se déclarer innocent. En parallèle, sa famille, des journalistes et des politiques le soutiennent, mettant au jour les anomalies du procès et réclamant sa réouverture. Le colonel Picquart a en effet découvert en 1896 l’identité de l’auteur de la fuite d’informations au profit de l’Allemagne : le commandant Esterhazy. Mais l’armée refuse de se contredire avec l’ouverture d’un nouveau procès.
Et Méline, président du Conseil des ministres, refuse la demande en révision du procès. Les dreyfusards (très minoritaires) vont mobiliser l’opinion publique par une campagne de presse : « J’accuse. » Titre de l’article de Zola en page un de L’Aurore, 13 janvier 1898. L’Aurore est le journal de Clemenceau et le titre est de lui. Mais l’article en forme de lettre ouverte au président de la République Félix Faure est l’œuvre de Zola, le plus populaire des romanciers contemporains : il accuse deux ministres de la Guerre, les principaux officiers de l’état-major et les experts en écriture d’avoir « mené dans la presse une campagne abominable pour égarer l’opinion » , et le Conseil de guerre qui a condamné Dreyfus, d’« avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète » . Le ministre de la Guerre, général Billot, intente alors au célèbre écrivain un procès en diffamation.
« La révision du procès de Dreyfus serait la fin de la France. » 2520
Henri ROCHEFORT (1831-1913), 1er mai 1898. Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière
Erreur de jugement (sans jeu de mot). Fin métaphorique d’une certaine France, celle d’un nationalisme intransigeant auquel il s’est tardivement rallié ?
Le pays est majoritairement antidreyfusard quand l’Affaire éclate. Il va changer d’opinion, lentement et sûrement, hormis une extrême-droite inconditionnellement hostile à Dreyfus pour ne pas compromettre l’armée française, seul espoir de revanche contre l’Allemagne qui détient l’Alsace et une partie de la Lorraine annexées (traite de Francfort du 10 mai 1871). Le contexte géopolitique n’excuse rien, mais il explique ces positions extrêmes.
Cité souvent et à juste titre pour son humour cinglant, Rochefort s’impose désormais en polémiste antidreyfusard. Son journal l’Intransigeant dénonce le syndicat des dreyfusards et soutient le camp des antidreyfusards, alors majoritaires et plus ou moins militants. Il faut distinguer des cas très différents.
Parmi les intellectuels, Charles Maurras se distingue. Il met en avant l’honneur de l’armée, mais il rejoint en 1900 l’Action française (mouvement créé en juillet 1899), pour défendre le pays contre les juifs, les francs-maçons, les protestants et les « métèques » . Théoricien du « nationalisme intégral » , Maurras écrit en décembre 1898 à Barrès : « Le parti de Dreyfus mériterait qu’on le fusillât tout entier comme insurgé. » L’Action française sera très présente dans l’entre-deux-guerres, avec son journal éponyme dont les lecteurs apprécient la qualité, mais pas forcément les idées politiques.
La Ligue de la Patrie française, plus modérée, réunit nombre d’écrivains et académiciens, joints à des artistes et des mondains : Maurice Barrès, François Coppée, Jules Lemaître et Paul Bourget, les peintres Degas et Renoir, les dessinateurs Forain et Caran d’Ache, le compositeur Vincent d’Indy.
La Ligue des patriotes, créée par Paul Déroulède en 1882 (pour la revanche, contre l’Allemagne), rassemble la majorité des nationalistes antidreyfusards. Déroulède croit Dreyfus innocent et rejette les slogans antisémites, mais l’honneur de la patrie et de l’armée passe avant tout. La justice militaire qui doit faire autorité ne peut donc être remise en cause. La Ligue atteindra 300 000 membres, avant de disparaître en 1905.
Dans l’armée, beaucoup d’officiers sont antidreyfusards, ne serait-ce que par esprit de corps. Et trois hommes politiques célèbres se déclarent contre la révision du procès : Cavaignac, ministre de la Guerre qui s’opposera à la seconde révision réclamée par Jaurès ; Félix Faure, président de la République durant la période où la révision est refusée ; enfin, Jules Méline, le président du Conseil qui s’y oppose également. Mais en juin 1899, la Cour de cassation annulera la condamnation de Dreyfus.
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
« La mobilisation n’est pas la guerre. » 2580
Raymond POINCARÉ (1860-1934), Appel au pays, 1er août 1914. Dictionnaire de français Larousse, au mot « mobilisation »
Prise au pied de la lettre, la mobilisation est une « opération qui a pour but de mettre une armée, une troupe sur le pied de guerre. » Dans la réalité des faits, la mobilisation précède la guerre.
Le président de la République fait afficher cet appel sur les murs des communes de France, en même temps que l’ordre de mobilisation générale. « Poincaré-la-Guerre » avait poussé le gouvernement russe à faire preuve de fermeté sur les Balkans, face à l’Autriche. Surestimant la puissance du « rouleau compresseur » de notre allié russe, il pense reconquérir l’Alsace-Lorraine en quelques semaines.
Cette croyance en une guerre courte prévaut en France, mais aussi en Allemagne. Dès juillet 1914, 170 000 hommes stationnés en Afrique du Nord ont été rappelés. À la mi-août, ils seront plus de 4 millions sous les drapeaux. Pratiquement pas de déserteurs, contrairement aux craintes du gouvernement. Ce qu’on appelle les « mutineries » (refus d’obéir aux ordres) date surtout de 1917 et touche aussi les armées ennemies.
« Je tordrai les Boches avant deux mois. » 2586
Généralissime JOFFRE (1852-1931), août 1914. G.Q.G., secteur 1 : trois ans au Grand quartier général (1920), Jean de Pierrefeu
Ces mots, souvent cités, font aussi partie de la propagande.
Généralissime (chef suprême des armées en guerre et commandant à tous les généraux), tel est son titre. Et la croyance en une guerre courte prévaut en France comme en Allemagne – qui a déclaré la guerre, le 3 août.
Tout commence par une guerre de mouvement. Joffre a élaboré le plan français (plan XVII) : se fiant aux forces morales et aux baïonnettes, il prévoit la défense de l’Est. Mais la bataille des frontières va se dérouler selon le plan allemand (plan Schlieffen) : gros effectifs et artillerie lourde pour la tactique, et pour la stratégie, invasion de la Belgique. Selon le chancelier allemand Bethmann-Hollweg, le traité international garantissant la neutralité de ce pays n’est qu’un « chiffon de papier » . D’où l’attaque de la France par le nord et le contournement des défenses françaises
Guillaume II, l’empereur d’Allemagne, parle de « la méprisable petite armée du général French » dans son ordre du jour à Aix-la-Chapelle, 19 août 1914. Grâce à son effort militaire, la France a pu aligner presque autant de divisions que l’Allemagne (plus peuplée). Mais nos soldats sont moins entraînés, moins disciplinés, mal équipés (uniformes trop voyants, manque d’artillerie lourde).
Après la bataille des Ardennes et de Charleroi – bataille des frontières perdue –, Joffre renonce au plan XVII et à l’« offensive à tout prix » . Il fait limoger plus de cent généraux – nommés à des postes dans des villes de l’arrière, comme Limoges – et ordonne le repli stratégique des troupes au nord de Paris, pour éviter l’enveloppement.
La guerre va durer quatre ans, les « Boches » seront vaincus, avec l’aide de nos alliés Américains et le recours à Clemenceau qui méritera son nom de Père la Victoire. Mais le bilan humain est tragique : plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre avec la mention « Mort pour la France »
ENTRE–DEUX–GUERRES
« Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir. » 2643
Frédéric JOLIOT–CURIE (1900-1958). La Politique en citations : de Babylone à Michel Serres (2006), Sylvère Christophe
Joliot-Curie, scientifique réputé, prix Nobel de chimie (avec sa femme, en 1935) sera membre actif du Parti communiste à partir de 1942. Faut-il parler d’erreur ?
Cette inconditionnalité peut être qualifiée d’inexcusable de la part d’un grand savant. Les femmes de la famille furent plus responsables : Marie Curie (femme de Pierre et femme de tête) et leurs deux filles, Ève la cadette et Irène, l’aînée devenue Joliot-Curie par son mariage.
Notons aussi que la position radicale de Joliot-Curie le différencie des grands écrivains de l’époque, Anatole France et Romain Rolland, intellectuels engagés (l’expression s’impose à cette époque), socialistes de cœur et de comportement, mais se méfiant du dogmatisme, de toutes les mystiques et des « préjugés nouveaux de la Révolution prolétarienne » .
« Oui ou non, l’institution d’une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée n’est-elle pas de salut public ? » 2645
Charles MAURRAS (1868-1952), Enquête sur la monarchie, Discours préliminaire (1924)
Datée de 1924, la question et l’erreur implicite peuvent étonner, de la part d’un politicien réputé intelligent !
Cette attitude rappelle le comte de Chambord aux premières heures de la Troisième République : « J’ai reçu le drapeau blanc comme un dépôt sacré, du vieux roi mon aïeul. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu’il ombrage ma tombe ! » Manifeste du 5 juillet 1871, à Chambord. Henri de Bourbon, comte de Chambord, se faisait appeler Henri V et se voyait déjà roi de France, les partis antirépublicains, légitimistes et bonapartistes, s’étant mis d’accord sur son nom. Dans ce discours, il reniait le drapeau tricolore. Certains de ses partisans, scandalisés, en devinrent républicains ! Cette attitude s’expliquait, il avait vécu quarante ans en exil, coupé du monde, entouré d’une petite cour d’émigrés aristocrates, assurément plus royalistes que le roi, comme tant de courtisans.
Rien à voir avec Maurras – même si sa surdité le coupait du monde ! L’écrivain se situe toujours à l’extrême droite, sur l’échiquier politique. La République avait trouvé grâce à ses yeux au lendemain de la victoire. Ensuite, le combat reprend contre le régime et la démocratie, synonyme de « mort politique » .
Dans une France devenue profondément républicaine, les royalistes ne sont plus qu’une secte – qui séduit des intellectuels aussi prestigieux que Gide, Proust, le jeune Malraux… Et Mauriac confie à Roger Stéphane (cité dans Tout est bien) : « On ne pouvait pas ne pas lire L’Action Française, c’était le journal le mieux écrit et le plus intelligent. » Sa mise à l’Index par le Vatican (1926) réduira son audience dans les milieux catholiques.
Autre aveuglement, autre erreur à l’autre bout de l’échiquier politique, les extrêmes se ressemblant parfois dans leur attitude.
« Mourir pour Dantzig ? » 2704
Marcel DÉAT (1894-1955), titre de l’éditorial de l’Œuvre, 4 mai 1939. Mourir pour Dantzig (1969), Jacques Benoit
Ce texte et son titre deviennent le manifeste du pacifisme intégral, très minoritaire en France, au prix d’une évolution rapide et parfaitement mesurée par les sondages.
Fin septembre 1938, 57 % des Français étaient encore favorables aux accords de Munich (signés entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie). Mais la montée de l’hitlérisme est mieux saisie et la bourgeoisie a moins peur de la révolution, après l’échec syndical de la CGT (mot d’ordre de grève générale non suivi, en novembre).
Très opportunément, les premiers sondages apparaissent en France – nés aux USA fin 1936, à l’initiative d’un journaliste et statisticien, George Horace Gallup, fondateur de l’institut portant son nom. D’août 1938 à juillet 1939, près de trente sondages se succèdent, source d’information devenue indispensable sur l’opinion face aux problèmes extérieurs ! En février 1939, « le souci le plus urgent du gouvernement doit être de renforcer la puissance militaire » : avis de 79 % des Français. Même tendance en Grande-Bretagne.
En mars, Hitler rompt les accords de Munich et occupe pour la première fois un territoire non peuplé d’Allemands, la Bohême-Moravie. La fiction du droit des peuples invoquée pour les Sudètes tombe. Voilà bientôt l’ensemble de la Tchécoslovaquie annexé. Et Mussolini de son côté occupe l’Albanie.
En avril, les Français, dûment sondés, ne seront plus que 17 % à nier le risque d’une guerre. Ils doivent faire partie des lecteurs de l’Œuvre et de Maurice Déat. Dans ce quotidien de la gauche intellectuelle, l’auteur, député socialiste, tendance réformiste, se prononce pour une politique de conciliation avec Hitler : il affirme qu’aucun de ses objectifs hégémoniques, et surtout pas la Pologne et Dantzig (ville libre, liée à ce pays par une union douanière), ne vaut qu’on s’y oppose au prix d’un nouveau conflit. Ce texte et son titre deviennent le manifeste du pacifisme intégral.
En juillet 1939, un nouveau sondage infirme cette opinion : 76 % des Français pensent que « si l’Allemagne tente de s’emparer de la ville libre de Dantzig, nous devons l’en empêcher, au besoin par la force » .
« Croquemitaine se dégonflera. » 2705
Paul CLAUDEL (1868-1955), Le Figaro, 19 août 1939. Mémoires du monde : cinq siècles d’histoires inédites et secrètes au Quai d’Orsay (2001), Sophie de Sivry, Emmanuel de Waresquiel, Ministère des affaires étrangères. Archives.
Claudel fait naturellement allusion à Hitler.
L’erreur de ce grand dramaturge catholique est d’autant plus grave qu’il fut également diplomate, de 1893 à 1936. Et Hitler s’apprête à envahit la Pologne, le 1er septembre.
« Le succès que l’Union soviétique vient de remporter, nous le saluons avec joie, car il sert la cause de la paix. » 2706
Maurice THOREZ (1900-1964), Déclaration au groupe parlementaire communiste, 25 août 1939. Histoire de la collaboration (1964), Saint-Paulien
Le pacte germano-soviétique de non-agression est signé le 23 août. Autant l’Axe Rome-Berlin d’octobre 1936, entre deux dictateurs également fascistes, est logique, autant cet accord entre l’Allemagne hitlérienne et l’Union soviétique est stupéfiant – et choquant.
Il libère momentanément Hitler de tout souci sur le front oriental et les deux puissances s’entendront pour se partager leur voisine, la Pologne.
Au sein du Parti, tout communistes qu’ils sont, certains camarades ne peuvent s’empêcher d’avoir des états d’âme. Un mouvement d’anticommunisme va encore alourdir et compliquer le climat politique intérieur.
QUATRIÈME RÉPUBLIQUE
« La vérité est une, seule l’erreur est multiple. Ce n’est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. » 2834
Simone de BEAUVOIR (1908-1986). Les Temps modernes, nos 109 à 115 (1955), Jean-Paul Sartre
Cherchez l’erreur !
On croirait entendre Bossuet au Siècle de Louis XIV : « Le propre de l’hérétique, c’est-à-dire de celui qui a une opinion particulière, est de s’attacher à ses propres pensées. » Histoire des variations des Églises protestantes (1688). À plus de 60 ans, il continuait de se battre contre les protestants, tout en travaillant à l’union des Églises.
Mais ces mots de Beauvoir datent de 1955. C’est la belle époque du terrorisme intellectuel. Le sectarisme de la gauche communiste sévit contre la droite, mais se déchaîne aussi en guerre des gauches. Il faudra attendre les années 1980 – démobilisation, désillusion, dépolitisation – pour voir le déclin de tous les « ismes » .
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
« L’année 1968, je la salue avec sérénité. » 3038
Charles de GAULLE (1890-1970), Allocution radiotélévisée, 31 décembre 1967. Année politique (1968)
Les vœux de l’Élysée sont de tradition, en fin d’année. Et le Général sacrifie à la règle, ayant réglé bien des problèmes, à commencer par « la guerre d’Algérie » devenue guerre civile.
Mais l’année 1968 va véritablement ébranler le régime, la société et le général lui-même. C’était imprévisible, du moins si vite et si fort. Le président fut à la fois surpris et dépassé par les évènements. Il ne fut pas le seul !
À signaler quand même un article du Monde qui passera ensuite comme prémonitoire : « Quand la France s’ennuie. » Pierre Viansson-Ponté (titre de son article, 15 mars 1968), inspiré du mot de Lamartine, sous la Monarchie de Juillet : « La France est une nation qui s’ennuie. » 10 janvier 1839, député à la Chambre, annonçant à terme la Révolution de 1848 à laquelle il prendra part en chef improvisé du gouvernement provisoire.
Maus au printemps 1968, la France est calme. Les conflits sociaux sont isolés. Seul, le monde étudiant s’agite un peu partout dans le monde, en ce printemps 1968, de Tokyo à Mexico et de Berlin à Berkeley – aux USA, la contestation est surtout dirigée contre la guerre du Vietnam, dès avril 1967.
À Paris, tout commence par Nanterre, donc en banlieue. Cette université créée en 1964 se voulait modèle, mais le campus ouvert aux émigrés des alentours tourne au bidonville. Après diverses manifestations, le 22 mars, des étudiants révolutionnaires occupent la tour du bâtiment de l’administration. Et les évènements vont s’enchainer à un rythme fou. C’est miracle s’il n’y a pas eu de morts. Légende urbaine ? Au pire, on recensera sept victimes (y compris dans les forces de l’ordre).
Reste de Gaulle qui gagne les élections de juin 1968 après la dissolution, mais perd son référendum en avril 1969 et démissionne aussitôt comme annoncé. Dernière victime d’une révolution (ou révolte) qu’il n’a jamais comprise : « Cas sans précédent de suicide en plein bonheur » dira François Mauriac.
« On ne pense jamais aux hommes lorsqu’on parle d’avortement. » 3157
Jean BRIANE (1930-2021), député réformateur de l’Aveyron. L’Express, 25 novembre 1974
Le mot aurait mérité le prix de l’humour politique, le meilleur étant parfois involontaire. C’est l’une des interventions en commission des Affaires sociales, quand on y discute pendant trois jours la loi Veil sur l’IVG.
Madame la ministre de la Santé aura tout entendu dans le genre erreur historique. Chaque mot étant bien mis en situation. Pour Pierre Baudis, député maire giscardien de Toulouse, il ne « fallait pas voter en raison du jugement de l’opinion publique, mais du Jugement dernier. » Pierre Buron, député UDR de la Mayenne, trouve « anormale et même horrible l’idée d’adapter la loi aux mœurs » . Claude Labbé, président du groupe UDR, reste prudent : « Notre position n’est pas changée, c’est-à-dire que nous n’avons pas de position… »
Et Claude Weber, député communiste, plutôt que de continuer à parler de ce problème irritant, ira vider les poubelles devant le Palais-Bourbon. Loi enfin adoptée en commission, avec 63 amendements. Les ténors hostiles à l’avortement se réservent pour le débat à l’Assemblée nationale.
« Vous avez juridiquement tort, parce que vous êtes politiquement minoritaire. » 3219
André LAIGNEL (né en 1942), à Jean Foyer, Assemblée nationale, 13 octobre 1981. Crises et alternances, 1974-2000 (2002), Jean Jacques Becker, Pascal Ory
L’erreur est juridiquement du côté de celui qui accuse politiquement… Et ça tombe mal. Sur Jean Foyer ! Ce grand juriste vient simplement d’affirmer : « La seule nécessité qui exige la nationalisation est que celle-ci soit inscrite dans le Programme commun. »
La « petite phrase » de Laignel, restée célèbre, a fâcheusement poursuivi son auteur.
Comme toujours, il faut la replacer dans son contexte. Le débat fait rage entre la majorité et l’opposition. Cette dernière soutient que les nationalisations sont inconstitutionnelles et Foyer défend l’exception d’irrecevabilité. D’où la réplique de Laignel : « Les nationalisations sont-elles conformes à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme ? M. Foyer répond par la négative. C’est sa responsabilité. Mais, à ce moment précis, son raisonnement bascule du juridique au politique. De ce fait, il a juridiquement tort, car il est politiquement minoritaire. »
C’est un peu différent, et la science juridique est aussi subtile que complexe.
Reste le bon sens qui s’exprime par la voix d’un autre homme politique, également avocat : « Ça va se terminer mal, par un coup de poing sur la gueule. C’est comme ça qu’on traite ce genre d’affaire dans les cours de récréation. » Jacques Toubon à l’Assemblée nationale, octobre 1981.
Les nationalisations sont toujours en cause. Toubon, fidèle chiraquien, député de droite et licencié en droit, ne peut que regretter la manière dont le débat dégénère en foire d’empoigne, alors que Laignel se réjouit de voir la lutte des classes entrée au Palais-Bourbon. La comparaison avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis en 2024 s’impose…
Dans la seule séance du 23 octobre, on enregistre huit suspensions, près de vingt rappels au règlement, plusieurs demandes de sanctions, un nombre incalculable d’attaques personnelles. La loi définitive sur les nationalisations sera finalement promulguée le 11 février 1982.
« Sublime, forcément sublime. » 3254
Marguerite DURAS (1914-1996), tribune dans Libération, 17 juillet 1985
Un cas d’erreur sans doute unique en son genre… Replaçons le mot malheureux dans son contexte.
Serge July, patron de Libé, a envoyé Marguerite Duras sur le lieu du drame qui bouleverse la France, depuis le 16 octobre 1984. À Lépanges-sur-Vologne, on a retrouvé dans la Vologne le corps du petit Grégory assassiné. Duras demande à rencontrer la mère, qui refuse. Christine Villemin subit un harcèlement médiatique qui se nourrit du mystère et des rebondissements de l’affaire.
Duras, auteur obsessionnellement fascinée par les faits divers, adopte une méthode « d’imprégnation du réel » . Sans preuves, au mépris de la présomption d’innocence, elle se fait médium pour accéder à la vérité : « Dès que je vois la maison, je crie que le crime a existé. Je le crois. Au-delà de toute raison […] On l’a tué dans la douceur ou dans un amour devenu fou. » Et le « sublime, forcément sublime » devient « coupable, forcément coupable. »
Fort embarrassé, July rédige un avertissement sur « la transgression de l’écriture » , rappelant la liberté inhérente à l’écriture de l’artiste. Mais vu la notoriété de l’artiste et la médiatisation de l’affaire, une polémique s’ensuit.
Selon Laure Adler, sa biographe, « Marguerite Duras se défendra toujours de ce « sublime, forcément sublime » ; elle dira l’avoir barré avant de remettre son texte au journal et reprochera à Serge July de l’avoir rétabli sans l’avoir consultée. Mais, pour le reste, elle confirmera ce qu’elle a alors, sous le coup de l’émotion, écrit, relu sous forme manuscrite, puis corrigé sur les épreuves d’imprimerie. »
En 2006, Denis Robert qui suivait en 1985 l’affaire Grégory pour Libération, donne une version contraire : le texte est en réalité une « version allégée » d’une première tribune, refusée par la rédaction du journal, et dans laquelle Duras « développait l’idée qu’une mère qui donne la vie a le droit de la retirer » . Il est parfois difficile d’écrire l’histoire, même la plus contemporaine.
« Tout le monde a menti dans ce procès, mais moi j’ai menti de bonne foi. » 3314
Bernard TAPIE (1943-2021), lors du procès OM-Valenciennes, mars 1995. Le Spectacle du monde, nos 394 à 397 (1995)
Diversion dans la campagne présidentielle, épilogue du feuilleton médiatico-juridico-sportif qui passionne le public, avec deux stars à l’affiche : le foot et « Nanard » , empêtré dans une sale affaire au Tribunal de Valenciennes. Difficile de ne pas faire la comparaison avec la notion tordue de « faits alternatifs » lancée en janvier 2017 par la conseillère de Donald Trump, à propos du nombre de participants à l’investiture du président – notoirement exagéré. Les faits alternatifs auront ensuite un bel avenir avec les réseaux sociaux et toutes les sources d’information (et de désinformation).
Le mot de Tapie, déjà très fort en com, vaut aveu et définit ce personnage atypique, cynique, talentueux dans son genre, popu et bling-bling à la fois, ogre hyperactif, qui touche à tous les métiers, est présent dans tous les milieux : chanson, télévision, sport, économie et politique. De 1988 à 1992, le voilà député des Bouches-du-Rhône, député européen, ministre de la Ville, conseiller régional. Parallèlement, il a dirigé avec brio l’Olympique de Marseille jusqu’en 1993, date où commencent les ennuis judiciaires.
Accusé d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale, le présent procès l’implique dans une tentative de corruption, lors du match OM–VA (Olympique de Marseille contre Valenciennes). Voulant protéger ses joueurs qui vont affronter le Milan AC dans la Coupe des clubs champions, le patron de l’OM a payé des joueurs de Valenciennes pour qu’ils « lèvent le pied » . L’OM a gagné sur les deux tableaux en 1993 (Coupe d’Europe et Coupe de France), mais des joueurs ont parlé. Tapie a démenti, avant de céder : « J’ai menti, mais… »
Condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, pour corruption active et subornation de témoin, il fait appel. Condamnation définitive en 1996. Et résurrection médiatique et financière, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Lui-même champion en communication et en affaires (encore à suivre).
« C’est une bonne idée d’avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui. » 3385
Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020), Le Monde, 6 mai 2005
Prix spécial du jury, décerné par le Press Club, humour et politique, en 2005.
C’est l’une des erreurs les plus remarquables chez cet homme assurément doué pour la politique, à la veille d’un référendum ou le NON va l’emporter.
VGE parle du projet de Constitution européenne : « C’est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit : je le dis d’autant plus aisément que c’est moi qui l’ai rédigé. » Mot également remarqué par le jury.
L’Europe est donc de retour sur la scène politique. Le 19 juin 2004, les chefs d’État et de gouvernement des 25 pays membres ont adopté le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » , signé à Rome le 29 octobre. Reste à obtenir la ratification par tous les membres de l’Union : par voie parlementaire ou par référendum. Le référendum, sacre populaire, donne plus de poids au texte, si tout se passe bien. Et 10 pays font ce pari, dont la France : décision du président de la République, après consultation des partis.
La campagne du référendum passionne moins qu’en 1992. Les enjeux du traité de Rome, avec cette Constitution, ne sont pas comparables à ceux du traité de Maastricht avec ses trois « piliers » fondateurs. Les leaders politiques pensent moins à l’avenir de l’Europe qu’aux prochaines élections, pour lesquelles il faut déjà se positionner. Et Philippe Séguin, retiré de la vie politique en 2002, siège à la Cour des comptes. Il n’y a donc pas de grand leader du non. Et pourtant…
« NON. » Réponse au référendum français sur le Traité constitutionnel européen, 29 mai 2005. Le non l’emporte avec près de 55 % des suffrages exprimés (plus de 30 % d’abstention). C’est un séisme politique dont les ondes sismiques se feront durablement sentir.
Si les Français rejettent l’Europe, il faut analyser cette « fracture européenne » et les partis – divisés sur la question, mais majoritairement européens – vont tenter de mieux « vendre » l’Europe, trop facilement prise en bouc émissaire, symbolisant le bureaucratisme, l’interventionnisme, le libéralisme, la mondialisation. Mais le référendum exprime aussi un « malaise français » : pessimisme viscéral, inquiétude sociale et crise perpétuellement ressentie, l’Europe n’étant qu’un prétexte à exprimer son mécontentement, et sa perte de foi en la politique.
« Si je suis élue, les agents publics seront protégés et en particulier les femmes, elles seront raccompagnées chez elles. » 3418
Ségolène Royal (née en 1953), débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle, TF1 – France 2, 2 mai 2007
La femme politique a multiplié ce genre de gaffe médiatique, avec un aplomb souriant. Un exemple (parmi tant d’autres) qui décrédibilise la parole politique. Imaginons le coût de cette promesse sympathique, mais totalement irréaliste !
La candidate du PS, logiquement finaliste au second tour, après un parcours atypique où elle a ses fans et, de plus en plus nombreux, ses détracteurs, ne fait plus illusion, et les sondages le reflètent depuis deux mois.
« Qu’on commette des erreurs en politique c’est possible ; qu’on les commette toutes, c’est fou ! » parole de Guillaume Bachelay, secrétaire national à l’Industrie du PS, en 2010. Proche de Fabius, donc un peu trop dur pour être honnête, il veut éviter le « mauvais choix » pour le prochain candidat socialiste à la présidentielle 2012.
Selon un sondage OpinionWay au lendemain du débat, Sarkozy domine mieux les dossiers économiques, les finances publiques, l’immigration, la lutte contre l’insécurité. Ségolène Royal reprend l’avantage sur les dossiers de société, environnement, éducation, inégalités sociales : répartition des compétences classique, entre la droite et la gauche. Mais aussi les hommes et les femmes… Cherchez l’erreur !
« Désormais, quand il y a une grève, plus personne ne s’en aperçoit. » 3434
Nicolas SARKOZY (né en 1955), au siège de l’UMP, 6 juillet 2008
Erreur évidente, mais assumée par le président en poste depuis un an !
Il va présider le Conseil européen et représenter l’Union pendant six mois, l’Europe est donc au programme du parti majoritaire. Mais pour mobiliser un parti de droite et chauffer une salle militante, s’en prendre aux syndicats et aux socialistes est plus payant. Il conclut alors sur ce qu’il va pouvoir dire à nos partenaires européens, que « la France change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu’on ne le croit » , la preuve en est que, « désormais… »
Tonnerre d’applaudissements dans la salle, la formule devient aussitôt une « phrase culte » , elle « fait le buzz » sur les réseaux sociaux qui organisent des votes : provocation ou vérité ? Les deux ! Les avis sont partagés, comme toujours face à cet hyperprésident omniprésent, mais la presse (majoritairement à gauche) invite le chef de l’État à se ressaisir et les syndicats sont vent debout…
Qu’en est-il dans les faits ? Le service minimum instauré en 2008 dans les services publics (enseignement, transports) évite le blocage ou la gêne des usagers trop souvent « pris en otage » . Le quinquennat, placé sous le signe de la crise économique, se verra épargner les grandes grèves des régimes précédents, mais à la moindre manifestation sociale, la petite phrase reviendra comme un boomerang au président. C’est de bonne guerre.
« Si à cinquante ans, on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. » 3436
Jacques SÉGUÉLA (né en 1934), émission « Les 4 vérités » , France 2, 13 février 2009
Vraie gaffe de com, impardonnable à un homme de pub. Et c’était pour « défendre » Sarkozy, qualifié de bling-bling ! « Comment peut-on reprocher à un président d’avoir une Rolex ? Tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie ! »
Erreur sitôt regrettée par le grand communicant… Séguéla tentera de se rattraper quelques jours plus tard. Il a plus de 50 ans, et il n’a même pas de montre ! Pour finir, il avoue : « J’ai dit une immense connerie. »
Quant à Sarkozy, la Rolex n’est pas seule en cause, ni les Ray Ban, ni la soirée au Fouquet’s le soir de son élection, ni le yacht de Boloré… C’est l’accumulation de tous ces signes extérieurs qui accréditent la version du président des riches.
Le bouclier fiscal, disposition qui plafonne l’imposition globale du contribuable, profite surtout aux très privilégiés. La proximité du pouvoir avec les principales fortunes du pays semble érigée en système de gouvernement. Une oligarchie domine l’ensemble des secteurs, de l’industrie aux médias, en passant par les arts et les lettres. Tout cela est assumé sans complexe.
Bayrou le centriste en fait beaucoup dans le genre opposé : « Moi et mes amis, on n’est pas la jet-society, on est la tractor-society. » Sans parler de la « gauche caviar » , plus hypocrite que la droite bling-bling. Ce genre de provocation paraît plus gênante, sinon scandaleuse, du fait de la crise qui perdure. Et la haine des riches va devenir l’un des prochains thèmes de campagne.
« Un troussage de domestique. » 3453
Jean-François KAHN (né en 1938), commentant l’affaire DSK, France Culture, 16 mai 2011
« Je suis pratiquement certain qu’il n’y a pas eu tentative violente de viol, je ne crois pas, ça, je connais le personnage, je ne le pense pas. Qu’il y ait eu une imprudence, on peut pas le… (petit rire), j’sais pas comment dire, un troussage de domestique. »
Dans cette histoire, on perd un bon journaliste : JFK reconnaît que cette formule était « une connerie » … Il va renoncer à ce métier qu’il a brillamment exercé, notamment à la tête de Marianne.
On perd aussi DSK, un homme politique déconsidéré par le scandale devenu mondial, avec les médias qui s’en emparent avidement – bien avant MeToo, c’est l’affaire du siècle pendant quelques mois : le public en redemande : vision de l’homme réputé le plus puissant du monde, menotté comme un vulgaire malfaiteur, ou traité comme un dangereux criminel… Dix ans après l’effondrement des Twin Towers, la réalité dépasse encore les fictions hollywoodiennes.
Et le Parti socialiste français est fort embarrassé : à un an des présidentielles, il perd son candidat préféré, celui qui avait le plus de chance de passer en mai 2012.
« Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. »
Emmanuel MACRON (né en 1977), président de la République
Petite phrase prononcée le 29 juin 2017, lors d’un discours dans le cadre de l’inauguration du campus de start-up Station F à Paris. Citation régulièrement reprise par la presse et regrettée par Macron.
Il y en aura beaucoup d’autres et plus rien ne se perd aujourd’hui : tout est exploité par la presse, les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Particulièrement exposé, visé et atteint, sa cote popularité est en chute libre et ses petites phrases sont baptisées « macronades » .
Il faut « emmerder les non-vaccinés jusqu’au bout. » … « Une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » La France est « une nation de 66 millions de Procureurs » et au cours d’un déplacement au Danemark le 29 août 2018, il compare les Danois, un « peuple luthérien » , aux Français, « des Gaulois réfractaires au changement » . On perd « un pognon de dingue dans les minima sociaux. »
Cette accumulation de « contrevérités » présidentielles entache le portrait d’un homme politique pourtant très soucieux de son image et désireux de tout contrôler.

