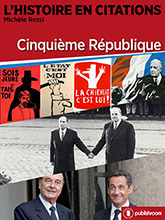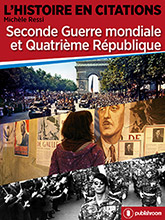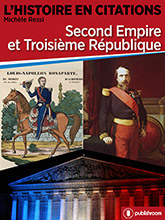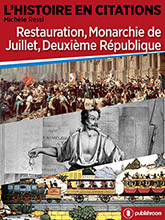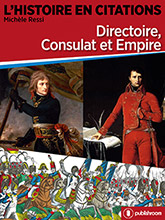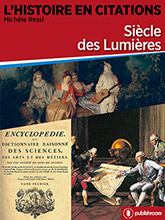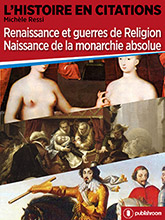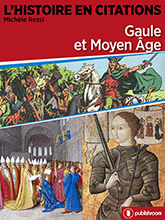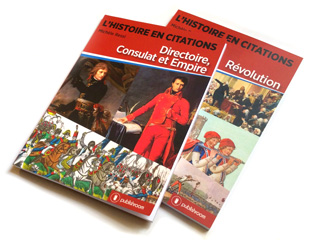« L’art culinaire sert d’escorte à la diplomatie européenne. »1
Antonin CAREME (1784-1833) Aphorisme, L’Art de la cuisine française au XIXe siècle, Traité élémentaire et pratique (1833)
Il apprit à s’exprimer malgré son manque d’éducation, tenant à informer le public - surtout les jeunes. Il laisse nombre de témoignages. Ces mots sont écrits l’année de sa mort : parfait résumé de sa vie et de sa vocation. Passionné par son métier plus que par l’argent et la gloire, sensible au contact humain, mais épuisé à la tâche, il meurt à 49 ans.
Né Marie-Antoine Carême (son vrai nom - le prénom étant un hommage à la reine Marie-Antoinette), il s’investira corps et âme dans ce « dixième art » - en marge des neuf arts majeurs aujourd’hui reconnus : architecture, sculpture, peinture, musique, poésie, théâtre, cinéma, photographie et bande-dessinée. Très jeune, il se fait remarquer par les plus grands noms de l’époque : Talleyrand et Napoléon Bonaparte sous le Directoire… pour finir par le baron de Rothschild, première fortune de France sous la Monarchie de Juillet. Entre temps, il a séduit nombre de souverains étrangers par la pratique de son art (et le charme de sa personne), star incontestée quoique modeste du Congrès de Vienne en 1814. Grâce à quoi il servit au sens propre et figuré la diplomatie française et européenne.
Premier « chef » de l’Histoire et inventeur de la fameuse toque, il fait progresser l’art culinaire. D’un point de vue formel, il maîtrisait le repas à la française aussi bien qu’à l’anglaise et à la russe, chacun ayant ses mérites. Il créa nombre de recettes, du petit boudoir à la « pièce montée » qu’il maîtrisait en virtuose inégalé. En même temps, il prit soin de la santé des hôtes qu’il régalait, avec un sens de la diététique très novateur !
Moins connu que les grands Vatel, Escoffier, Bocuse - et les très populaires Mère Poulard ou Mère Brazier -, Antonin Carême est un personnage exceptionnel à maints points de vue. Ajoutons que c’est le seul de tous les « chefs » à entrer dans l’Histoire de France par la grande porte (politique et diplomatique) !
« Le Palladio de la cuisine… artisan laborieux [issu d’] une des familles les plus pauvres de France qui compta vingt-cinq enfants. »
Antonin CAREME (1784-1833), Souvenirs écrits par lui-même (inédits). Les Classiques de la table, petite bibliothèque des écrits les plus distingués publiés à Paris sur la gastronomie et la vie élégante (1845)
C’est un récit qu’il veut « rapide et simple », pudique aussi, malgré le rapprochement avec Andrea Palladio, illustre architecte de la Renaissance italienne, auteur d’un traité (Les Quatre Livres de l’architecture) qui inspira son art culinaire à Carême – à commencer par ses vertigineuses pièces montées (trois mètres de haut).
Une dizaine de ses frères et sœurs sont morts en bas âge et le gamin parisien fut « littéralement jeté à la rue » sous la Révolution par son père, ouvrier de chantier vivotant avec sa famille (15 enfants survivants) dans une baraque près de la rue de Sèvres. Il souhaite épargner la misère au plus prometteur et fait confiance au destin.
Abandonné la nuit sur une barrière de Paris, il erre plusieurs jours, il a peur, il a froid, il a faim. Il s’endort un soir sur le pas-de-porte d’un gargotier. Ce brave homme le prend en pitié, l’héberge, le nourrit, écoute son histoire et décide de l’engager – faute de lois sociales, les enfants travaillaient à l’usine et dans les mines. Dans ses écrits, Carême ne livre aucun souvenir d’enfance, mais certains biographes ont apporté des détails romanesques dignes du Sans famille d’Hector Malot. Reste l’aveu du manque et de la souffrance insurmontable d’avoir été privé de famille et d’éducation.
Attiré par la pâtisserie exposée en vitrine, il entre à 13 ans comme apprenti « Chez Bailly », rue Vivienne.
« Les Beaux-Arts sont au nombre de cinq, à savoir : la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l’architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. »
Antonin CARÊME (1784-1833), Le Pâtissier pittoresque (1815)
Faute d’être l’architecte dont il rêvait, Carême cultive sa passion pour l’architecture en fréquentant assidûment le cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale – peinant à lire, il est fasciné par les planches et autres images. Ce lieu béni est proche de « Chez Bailly », le pâtissier où il travaille en apprenti la nuit.
Il expose ses premières œuvres littéralement inspirées : série de réalisations pittoresques, ruine de Babylone, pavillon chinois ou Hermitage suédois. Dès ses premières créations, il recherche l’élégance, l’harmonie des proportions et des tons : pas plus de trois couleurs « tendres dans leurs nuances ».
Il fera bientôt des prodiges défiant l’imagination et les lois de la pesanteur : « pièces montées » colossales, de nature à flatter les bourgeois, sculptures baroques et phalliques faites de croquantes meringues à base d’amandes et de miel, gros nougats et pâtes d’amande multicolore. Sans oublier une invention moins spectaculaire et au grand avenir.
« Antonin, ta tourte vole au vent ! »
Antonin CARÊME (1784-1833), Le Pâtissier pittoresque (1815)
C’est à l’origine une « charcuterie pâtissière » composée d’une croûte cylindrique faite de pâte feuilletée et d’une garniture liée d’une sauce - sans doute pas inventée par Carême (attribuée à La Varenne en 1651), mais renouvelée par ses soins.
L’un de ses clients raffolait de tartes et de tourtes (tartes en croûtes), mais les trouvait trop lourdes à digérer. Antonin, fan de diététique avant la lettre, se lance à la recherche d’une pâte légère et enfourne deux cercles de pâte réunis par un ruban de pâte feuilletée dont il maîtrisait parfaitement la cuisson. Celle-ci monta toute droite, boursoufla et s’éleva dans les airs. D’où le cri de son fournier, émerveillé : « Antonin, ta tourte vole au vent ! ».
Autre acrobatie gourmande plusieurs fois revue et corrigée dans l’histoire, le « mille-feuille », inventé et décrit par La Varenne dans son Cuisinier François (1651). Le nom fait référence au nombre élevé de feuillets de pâte. Carême crée une « dernière » version de cette viennoiserie devenue un classique de la pâtisserie française. Traditionnellement fourré d’une crème pâtissière à la vanille et aromatisé au rhum, le mille-feuille est décliné en diverses versions parfumées.
Après son apprentissage réussi et déjà remarqué « Chez Bailly », Carême ouvre à 18 ans sa première boutique rue de la Paix, en 1802 : « La Pâtisserie ». La bonne société du Directoire apprécie son talent précoce et son élégance romantique - visible sur ses portraits et très exceptionnelle dans cet univers viril de la gastronomie. Arrive alors la chance de sa vie, Talleyrand…
De retour d’Amérique où il a prudemment passé les pires heures de la Révolution (avec la Terreur), le « Diable boiteux » (grand diplomate au pied bot) s’est mis en tête de séduire Bonaparte, le futur chef de la France dont il décerne les qualités exceptionnelles d’intelligence, de volonté, mais aussi le caractère déjà impérial. Il a remarqué dans la vitrine de son pâtissier-traiteur « Chez Bailly » une des pièces montées de Carême. Selon d’autres sources, ce nouveau chef lui est recommandé par Bonaparte Premier Consul qui fait parfois appel à son service. Quoi qu’il en soit, le destin va les rapprocher dans une complicité culinaire historique de douze années.
« Il faut le faire dîner avant de le faire parler. »
TALLEYRAND (1754-1838), cité par Éric Schell, Talleyrand en verve (2016) - et par divers historiens, Castelot, Orieux, Madelin. Bulletin d’information de l’association « Les Amis de Talleyrand » n°10, janvier 2018.
« Tenir table » est le meilleur moyen de se distinguer dans le monde… et en politique - Talleyrand pense d’abord à Napoléon Bonaparte qu’il veut séduire et convaincre. Joignant l’utile à l’agréable, la gastronomie fait partie du plaisir de vivre qui remonte à l’Ancien Régime, même si Bonaparte n’est pas vraiment amateur.
Talleyrand appréciait depuis l’Ancien Régime le traditionnel « service à la française » : tous les plats d’un service (entre trois et cinq pour aller jusqu’à douze lors des repas officiels ou d’apparat) sont apportés en même temps sur la table où ils sont disposés symétriquement. Né au Moyen Âge, toujours en usage lors des repas de réception des XVIIIe et XIXe siècles, il vaut pour les grandes tables fastueuses avec ses rituels - le plus spectaculaire étant le découpage des viandes, apanage du maître d’hôtel. Tous les mets dressés en cuisine sont disposés sur la table dans des plats d’argent ou de porcelaine posés sur des réchauds. Le premier service comprend potages et diverses entrées. La table est débarrassée pour recevoir le deuxième service, rôti et entremets. Viennent enfin les desserts au troisième service. Jusqu’à ce que les convives soient installés, les plats sont tenus sous cloche, répandant sitôt découverts une odeur suave de bonne cuisine dans la salle à manger.
Carême confirmera : « Rien n’est plus imposant que l’aspect d’une grande table servie à la française. » (Le Maître-d ‘hôtel français : traité des menus à servir à Paris, à St.-Pétersbourg, à Londres et à Vienne). Mais il déplore la difficulté de conserver les plats chauds jusqu’à leur consommation… Les repas à la russe ou à l’anglaise ont d’autres avantages et défauts. C’est affaire de goût et les ayant tous essayés, il ne cessera de les comparer sans se décider clairement – une exception dans son parcours culinaire plutôt rigoureux.
Tenir table est aussi une obligation sociale pour Talleyrand : opération de relations publiques pour se faire connaitre et reconnaitre sur la scène internationale - et gommer son image de révolutionnaire. Il a un concurrent redoutable en la personne de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, magistrat sous l’Ancien Régime, éminent juriste (co-rédacteur du Code Civil de Napoléon), franc-maçon avide d’argent et de pouvoir, homosexuel notoire et jouisseur invétéré.
« Quand on veut manger bien, on dîne chez Cambacérès. Quand on veut mal manger, on dîne chez Lebrun. Quand on veut manger vite, on dîne chez moi. »
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Premier consul parlant de ses deux confrères. Cité par Marion Godfroy , Napoléon, « Biographie gourmande » (2018)
« Manger vite » : en bon militaire, de Gaulle expédiait lui aussi ses dîners en 45 minutes chrono – les grands soirs.
Napoléon reste dans l’histoire comme un homme pressé en tout. Travailleur infatigable, dictant trois lettres à la fois, épuisant ses collaborateurs, surprenant ses généraux et tous ses hommes de troupe, il dormait quatre heures par nuit les bons jours et récupérait en pratiquant des micro-siestes. Médiocre amant, il ne prend pas le temps d’enlever ses bottes… Mieux encore, le 2 avril 1810, ayant épousé Marie-Louise en secondes noces et invité 3 000 personnes : « Le dîner impérial du mariage fut aussi bref que la plupart des dîners familiaux, soit moins de vingt minutes, ce qui suppose que les convives n’ont guère le temps de goûter à tout. Le repas prend fin en effet quand l’empereur se lève de table », précise l’historien contemporain Jacques-Olivier Boudon.
Il sait quand même la valeur sociale et culturelle du repas ! Dans la logique de l’Ancien Régime, il construit sa « Maison » et engagera de nombreux cuisiniers – « maîtres d’hôtel » les mieux payés parmi les domestiques des maisons aristocratiques. Carême aura l’honneur de servir le Consul et l’Empereur, ainsi que certains membres de sa grande famille.
Il veillera surtout à ce que Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères puisse régaler (et manipuler) ses hôtes, éblouir ses invités, représenter la France au sommet de l’art culinaire. Pour cela, il va mettre le prix !
« Je veux que vous achetiez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps diplomatique et les étrangers marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous et que d’y être prié soit une récompense pour les ambassadeurs des souverains dont je serai content. »
NAPOLEON (1769-1821), à Talleyrand. « Bulletin d’information de l’association Les Amis de Talleyrand » N°10 - janvier 2018
Talleyrand n’avait pas les moyens d’acheter le château de Valençay, un grand domaine en dehors de Paris sur lequel avait porté son choix en 1803. Napoléon finança l’acquisition en prêtant l’argent à son ministre. On ignore si son ministre remboursa…
Quand il emménage à Valençay en 1804, Talleyrand prend Carême à son service et propose un défi au cuisinier : créer une année entière de menus, sans répétition et en utilisant uniquement des produits de saison.
Carême passe le test et complète sa formation dans les cuisines de Talleyrand. Il propose (et impose plus tard) des sauces légères et subtiles, publiant une classification en quatre groupes de base : sauce allemande, sauce béchamel, sauce espagnole et velouté. On est loin du pauvre régime anglais ou américain.
Carême est lui aussi à la fête, chez son nouveau maître, aussi grand seigneur que bon connaisseur.
« Ah ! quelle différence entre la vilaine maison de Cambacérès et la grande, digne demeure du Prince de Bénévent… On n’y emploie que les productions les plus saines et les plus fines. Là, tout est habileté, ordre, splendeur. Le talent est heureux et haut placé. Le cuisinier gouverne l’estomac. Qui sait, il influe peut-être sur la grande pensée du ministre… »
Antonin CARÊME (1784-1833), cité par Jean Vitaux, Les Petits plats de l’histoire (2012)
Reconnaissance clairement exprimée (jusqu’à son dernier maître, le baron de Rothschild), respect du partenaire et fierté de faire couple avec lui, pour le bien de la France ! Telles sont les qualités bien connues de Carême.
Elles feront merveille et quasiment miracle après l’Empire, au Congrès de Vienne de 1814, sous la Restauration.
Talleyrand a pour mission quasi-impossible de ramener la France vaincue au rang des grandes nations, ces puissances alliées qui ont finalement triomphé de Napoléon et de son fol esprit de conquête. Louis XVIII, de retour en France, envoie son ministre des Affaires étrangères pour négocier avec une longue liste de recommandations. D’où la réponse…
« Sire, j’ai plus besoin de casseroles que d’instructions écrites ! »
TALLEYRAND (1754-1838), à Louis XVIII qui l’envoie négocier au Congrès de Vienne. « Talleyrand et Antonin Carême : la gastronomie au service de la diplomatie », Charles de Saint-Sauveur, Le Parisien, 23 septembre 2018
Toutes les biographies de Talleyrand confirment l’importance de cette diplomatie culinaire qui lui est chère : « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. » Et le Diable boiteux a sa perle rare, Carême. Il confirmera dans ses Mémoires : « Le meilleur auxiliaire d’un diplomate, c’est bien son cuisinier. »
Entre les deux hommes de goût que tout sépare (l’âge, les origines, l’apparence physique), l’entente est absolue et l’intimité aimable. Pour la petite histoire gastronomique, voyant son maître habitué à tremper un biscuit dans son verre de Madère, Antonin Carême aurait eu l’idée de créer un petit gâteau à la texture plus consistante pour éviter qu’il ne se délite entièrement dans le verre d’alcool : c’est le boudoir.
Plus sérieusement, Talleyrand se trouve conforté dans son intime conviction : « On ne fait pas de bonne diplomatie sans de bons déjeuners. » Et Carême lui fait écho en accord parfait. Il faut même parler d’amitié et de complicité entre les deux hommes – pour le bien de la France tragiquement vaincue par la coalition de tous ses ennemis en 1814 et qui doit retrouver sa place en Europe.
« Le grand diplomate doit avoir un cuisinier renommé pour tenir bonne maison. »
Antonin CARÊME (1784-1833), L’Art de la cuisine française au XIXe siècle. Traité élémentaire et pratique (1833)
« Roi des chefs et chef des rois », il servira beaucoup de grands noms (princiers) en cuisinier « renommé » (au sens de talentueux), mais le « grand diplomate » par excellence fut naturellement Talleyrand au sommet de son art et de sa forme à 60 ans, après la chute de Napoléon - avant son « come-back » des Cent-Jours qui va sidérer l’Europe, forçant Talleyrand furieux comme jamais à tout recommencer… en moins bien, au second traité de Paris, signé le 20 novembre 1815.
En attendant, le couple fait merveille en 1814 aux yeux du monde et pendant plus de sept mois en Autriche. Les marmites françaises vont étourdir les grands d’Europe, au même titre que les valses viennoises.
Lors des fastueux dîners que donne le prince diplomate, les convives voient défiler au fil des services 48 entrées, une pléiade de rôtis, de homards, d’entremets, et d’extraordinaires pâtisseries en forme de village ou de château, « pièces montées » spectaculaires d’invention et de raffinement, centres de table culminant alors à plus de sept mètres (l’équivalent de trois étages).
Impossible de goûter à tout, les invités de Vienne étant parfois réduits au rang de spectateurs sidérés. Le plaisir des yeux est aussi un plaisir de la table, quand Carême et Talleyrand sont aux commandes.
« Non ! Diplomates européens, ce n’est pas vous seulement qui avez calmé le monde agité par toutes ces tempêtes. C’est l’habile cuisinier, c’est le grand artiste qui, après trente ans de guerre, de révolutions et d’émeutes, a appris de nouveau au monde fatigué comment on déjeune pour bien dîner. »
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), se souvenant en ces termes de certain dîner au Congrès de Vienne. Le Journal pour tous, avril 1864
Rappelons que notre premier grand romantique déteste et méprise Talleyrand, prêtre défroqué, image du vice –souvent associé au crime incarné par Fouché, ministre de la Police. Mais il rend un juste hommage à Carême qui n’aura jamais mieux mérité son titre de « roi des chefs et chefs des rois » que lors de ce congrès historique.
Talleyrand joua lui aussi gagnant à Vienne : montrer les talents de la civilisation française et, en fin de compte, réussir à influencer les puissants de ce monde en les attirant autour d’une table. Mission accomplie : il en rend compte à Louis XVIII le 4 janvier 1815 avec satisfaction : « Maintenant, Sire, la coalition est dissoute, et elle l’est pour toujours […] la France n’est plus isolée en Europe. » Après les Cent-Jours de Napoléon et le désastre de Waterloo, au terme du second traité de Paris, signé le 20 novembre 1815, la note à payer par la France sera malheureusement alourdie - rançon de 700 millions de francs, restitution des œuvres d’art prises par Napoléon en Italie, perte de territoires sauvés (Sarre, Chambéry, Annecy, etc.) et entretien d’une armée d’occupation de 150 000 hommes dans le nord et l’est du pays durant trois ans.
« La cuisine est la seule cause qu’il n’ait jamais trahie. »
Cité par Le Parisien magazine. « Histoire : Antonin Carême fait une révolution de palais », 6 sept 2016
Le mot courait à bas bruit sur Talleyrand qui avait autant d’ennemis que d’admirateurs et s’en moquait également : « On dit toujours de moi ou trop de mal ou trop de bien ; je jouis des honneurs de l’exagération. » Une variante à cette citation culinaire : « Le seul maître que Talleyrand n’ait jamais trahi est le fromage de Brie. »
Après le premier Congrès de Vienne, Carême devenu célèbre va faire la conquête de l’Europe avec la table à la française - avant de revenir à Paris pour finir glorieux et pauvre sous la Monarchie de Juillet.
« Carême, vous me ferez mourir de trop manger, j’ai envie de tout ce que vous me présentez et c’est trop de tentations en vérité.
— Monseigneur, répondit Carême, ma grande affaire est de provoquer votre appétit par la variété de mon service, et il ne m’appartient pas de le régler. »Antonin CAREME (1784-1833), « Roi des cuisiniers, cuisinier des Rois », Herodote.net
Les souverains et les grands personnages s’arrachent désormais ce chef cuisinier qui pratique toujours sa profession comme un sacerdoce.
Il est d’abord appelé par le prince-régent d’Angleterre, surnommé le « premier gentleman d’Angleterre » pour son charme et sa culture. Mécène fastueux, musicien amateur et ami de Rossini qui lui donne des leçons de chant, il est naturellement porté sur la bonne chère – les portraits témoignent de son aimable rondeur. Difficile de résister aux tentations de Carême qui s’applique pourtant à lui présenter une gastronomie saine et raisonnée, lui expliquant chaque matin les propriétés de chaque mets. Il va rester deux ans à Londres.
« La Charlotte » fut créée en hommage à l’épouse du roi George III, la reine Charlotte, mère de quinze enfants et grand-mère de la reine Victoria. Une love-story émouvante… et une pâtisserie sans chichi, adorée des enfants, réalisée à partir de pain de mie beurré ou de brioche dans un moule aux bords évasés. Remplie de compote de fruits (pomme, poire ou prune), cuite pendant un certain temps, on peut la déguster chaude. C’est un dessert gourmand à s’offrir au « tea-time ». La version aujourd’hui connue est celle de Carême. Il modifie la recette, remplaçant la brioche par des biscuits à la cuillère et ajoutant de la crème bavaroise. Autre changement : elle n’est plus cuite pendant des heures et se déguste froide. Baptisée « Charlotte à la parisienne », elle sera renommée « Charlotte russe » quand notre grand pâtissier passera au service du tsar Alexandre.
Les brouillards anglais l’attristent et il part, appelé sous d’autres cieux. On le retrouve à Vienne en 1821, pour régaler l’empereur d’Autriche François Ier ainsi que Lord Steward, ambassadeur d’Angleterre à la cour autrichienne. Durant ce séjour, Carême met au point cet élément devenu caractéristique du costume de cuisinier : la fameuse toque blanche. Voulant que ses marmitons aient la mine plus fière — plus « crâne » comme on dit alors — il fait glisser un rond de carton dans leurs bonnets de coton à mèche afin d’obtenir une coiffe plus rigide. La toque est née.
Quand le prince régent devenu roi Georges IV réclama de nouveau Carême, il refusa. Londres semblait décidément trop sombre à son goût, il était privé de ses amis, de cette conversation française si attrayante. Et le roi d’Angleterre déçoit bientôt, sa vie dissolue discrédite la monarchie, ses dépenses pèsent sur le peuple, ses ministres eux-mêmes le jugent égoïste et versatile. Reste quand même un joli souvenir d’Angleterre…
« Sur la nappe fine sont disposés les fleurs et les fruits en décors savants, élégants et variés : guirlandes, mosaïque, parterre de pétales. Aucun rôti ne figure sur la table. »
Pierre de TRÉVIÈRES (1873-1951) dans le Figaro (1911)
En 1820, Carême donnera cette plaisante description du « service à l’anglaise » (reprise en 1836 par notre premier critique gastronomique, Grimod de la Reynière). C’est un compromis entre services à la française et à la russe. Le personnel de salle sert à la pince des mets présentés artistiquement sur plateau en cuisine. Le service se fait par la gauche des convives, en commençant par les femmes, les mets étant servis de la main droite à l’aide d’une cuillère et d’une fourchette de service nommée pince (plate, ronde ou pelle).
Service pratique, particulièrement rapide, bien adapté au format banquet, il peut être assumé pour de nombreux convives par un seul serveur (habile). Il s’oppose aux deux autres services, à la française et à la russe.
« Le service à la russe se fait avec rapidité et chaudement. »
Antonin CAREME (1784-1833), Le Maître-d’hôtel français : traité des menus à servir à Paris, à St.-Pétersbourg, à Londres et à Vienne (posthume, 1842)
Carême le trouve mieux adapté « aux repas de militaires et dans la cadre des familles » que le classique et spectaculaire« service à la française » pratiqué sous l’Ancien Régime par les grandes maisons : gigantesques buffets où tous les mets arrivaient en même temps… et se mangeaient donc souvent froids. L’hôte se chargeait de découper les viandes.
Mais en 1810, l’ambassadeur de Russie à Paris est grièvement blessé dans un incendie et passe l’été à se reposer au château de Clichy. Ne pouvant assurer la découpe, il fait servir les plats les uns après les autres, déjà préparés en cuisine… et chauds ! Plus pratique et plus économique, la mode du « service à la russe » s’est progressivement imposée.
Notre chef français ne reste pas longtemps au service du tsar Alexandre : juste assez pour renouveler sa « Charlotte à la parisienne » naturellement rebaptisée « Charlotte russe ». Il retourne finalement en France pour retrouver le « service à la française » et (après Talleyrand) un nouveau maître digne de lui.
« À Paris chez M. le baron de Rothschild. Dans cette maison opulente, j’avais la satisfaction de faire autant de dépenses que mes grands dîners le commandaient, afin de bien faire ; seul moyen de stimuler le génie des cuisiniers jaloux de leur réputation : car à quoi bon du talent sans la possibilité d’avoir l’argent nécessaire pour se procurer des provisions de première qualité ? Aussi cette noble maison est devenue réputée dans toute l’Europe par la somptuosité de sa table. »
Antonin CARÊME (1784-1833), L’Art de la cuisine française a XIXe s, Traité élémentaire et pratique (1833).
Sous la Restauration, en 1823, James de Rothschild le prend à son service.
Né en Allemagne, arrivé à Paris en mars 1811 pour créer la filiale française de la « maison Rothschild », James spécula sur la chute de l’Empire et installe en 1815 l’établissement financier « MM. de Rothschild Frères ». Il retrouve les faveurs du gouvernement français en procurant à Louis XVIII les cinq millions de francs « nécessaires à la dignité de son retour ». Il aide le gouvernement de la Restauration puis de la Monarchie de Juillet, gérant la fortune personnelle de Louis-Philippe. Ce sont les deux hommes les plus riches de France.
Les dîners des Rothschild sont les plus célèbres de Paris, artistes (Rossini, Chopin, Delacroix…) et politiciens se côtoient. Carême, plus que jamais « roi des cuisiniers et cuisinier des rois » invente le « saumon à la Rothschild », le « filet de bœuf à la Rothschild », le « soufflé glacé à la Rothschild ». Naturellement invités au menu, on retrouve tous les classiques de son répertoire : pièces montées, Charlotte à la parisienne, mille-feuille, vol au vent, Compiégnois (souvenir des noces de Napoléon et Marie-Louise au château de Compiègne en 1810).
Gioacchino Rossini (1792-1868) est l’un des familiers des Rothschild. Génial compositeur du Barbier de Séville et d’une dizaine de chefs d’œuvre, « Il Signor Crescendo » qui écrivait un opéra en 15 jours, (orchestration comprise, mais au prix de quelques auto-plagiats) a pris sa retraite à 37 ans et mène la belle vie à Paris. Sa gourmandise est légendaire : il se lie d’amitié avec Carême qui ne manque pas de lui envoyer un pâté quand le maître se rend à Bologne – en souvenir de son enfance et son adolescence. En retour, le compositeur lui écrit un aria. Ensemble, ils composent des recettes à base de truffe que Rossini adore, notamment la chère « salade Rossini » et le toujours fameux « tournedos Rossini » - jouissive composition alliant truffes, foie gras et Madère à un filet de bœuf poêlé.
« Les jeunes gens qui seront studieux, trouveront dans mes dessins de grands moyens d’instructions, et pourront, en peu de temps, faire des progrès rapides. »
Antonin CAREME (1784-1833), cité par son confrère Brillat-Savarin, Physiologie du goût (1825)
Le chef qui continue de travailler, plus demandé que jamais, ne cesse d’écrire pour transmettre son art et sa passion.
Dans ses livres, il fait preuve de pédagogie, illustrant son propos de nombreux dessins qu’il réalise lui-même. Comme le dit si bien un contemporain, le marquis de Cussy (1766-1837) : « Il apprend à ceux qui ne savent pas, il perfectionne ceux qui savent déjà. » Son condisciple Jules Gouffé systématisera le procédé sous Napoléon III, créant le livre de cuisine moderne en incluant les quantités précises des ingrédients ainsi que les temps et températures de cuisson, devenu best-seller au XXe siècle.
« Rien de gras : ce vice a disparu de la cuisine française. »
Antonin CARÊME (1784-1833), L’Art de la cuisine française au XIXe s, Traité élémentaire et pratique (1833)
Influencé par les idées de Catherine de Médicis, il s’efforça de revenir aux vraies valeurs de la gastronomie. À l’inverse de la cuisine française souvent lourde et épicée, il instaure un nouveau paradigme pour les sauces si appréciées de Talleyrand, désormais classées en sauce allemande, béchamel, espagnole et velouté, proposées en versions plus légères et subtiles,
Parmi les autres aphorismes de ce gros livre qui résumera la vie et l’œuvre de l’auteur et dans le même esprit :
« Le talent d’un bon cuisinier est plus conservateur de la santé que la science factice de certains docteurs, dont l’intérêt règle la conduite médicale. »
Antonin CARÊME (1784-1833), L’Art de la cuisine française au XIXe s, Traité élémentaire et pratique (1833)
Le mépris des médecins est un classique bien français depuis Molière.
En vertu de quoi Carême allège avec bon sens tous ses plats en gras et en sucre. On pourrait en douter à la vue de ses fameuses « pièces montées » ou à la lecture de diverses recettes, mais notre chef cuisinier pratique déjà une diététique qui ne dit pas encore son nom.
« L’Art de la cuisine au XIXe siècle ou traité élémentaire des bouillons en gras et en maigre, des essences, fumets, des potages français et étrangers, grosses pièces de poisson, des grandes et petites sauces, des ragoûts et des garnitures, grosses pièces de boucherie, de jambon, de volaille et de gibier, suivi des dissertations culinaires et gastronomiques utiles au progrès de cet art. »
Antonin CAREME (1784-1833). Titre complet de son dernier livre inachevé (daté de 1828 pour la première édition, 1833 pour l’édition achevée par Plumerey)
« J’ai encore à publier un livre sur l’état entier de ma profession à l’époque où nous sommes » dit-il pressé par le temps et une santé déclinante. Ce dernier témoignage est le plus important de sa biographie. Carême tire la leçon historique de sa vie avec Talleyrand et les autres maîtres dont il assura le service.
Il meurt pauvre à 49 ans – l’argent qu’il gagnait devait servir à payer les produits les plus coûteux des mets qu’il « offrait » à ses fastueux convives, de même que la publication de ses livres - autoédition très pratiquée à l’époque et qui ruina nombre d’écrivains plus ou moins connus.
Carême ne laisse en héritage que ses ouvrages plusieurs fois réédités, entre autres :
- Le Pâtissier pittoresque (orné de 128 planches par l’auteur) (1815).
- Le Maître d’hôtel français ou Parallèle de la cuisine ancienne et moderne considérée sous le rapport de l’ordonnance des menus à servir selon les quatre saisons, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres et à Vienne (1822).
- Le Pâtissier royal parisien. Traité élémentaire et pratique orné de quarante et une planches par l’auteur.
- Le Cuisinier parisien (1828).
- L’Art de la cuisine au XIXe siècle. Traité élémentaire et pratique (1833).
À la lecture (à la fois anecdotique et instructive, souvent divertissante), on voit quelle haute idée Carême se faisait de son art. Il y a dans son travail une érudition rare qui montre un véritable amour de sa profession.
« Qu’importe. Moins de vie, plus de gloire ! »
Antonin CARÊME (1784-1833), cité dans « Talleyrand et Antonin Carême : la gastronomie au service de la diplomatie », Charles de Saint-Sauveur, Le Parisien, 23 septembre 2018.
Son métier est épuisant, tous les grands chefs le savent et l’avouent parfois, l’élégant Carême restant toujours discret et même secret sur sa vie, préférant œuvrer pour sa légende – comme nombre d’artistes. Mais pas question de se reposer ! Carême travaillera jusqu’à la limite de ses forces - un sacerdoce.
Il meurt à 49 ans, empoisonné par la fumée toxique du charbon de bois inhalé pendant quatre décennies et dont on ignorait le danger - impossible de ne pas penser à la radioactivité funeste à la famille Curie, Marie en tête. Autre hypothèse : des caries dentaires non traitées entraînant diverses complications, dues au fait qu’il se faisait un devoir de goûter tous ses plats à toutes les étapes de la création : « Qu’importe. Moins de vie, plus de gloire ! »
De la misère à la reconnaissance internationale des têtes couronnées, le parcours de Carême est un destin quasi-romantique qui fait écho à celui de Napoléon Bonaparte, petit nobliau corse qui mit l’Europe à genoux en une dizaine d’années.
Fondateur de la grande cuisine, créateur du vol-au-vent revu et corrigé, maître ès sauces et potages en versions démultipliées, complexes ou allégées, virtuose inégalé de la pièce montée, il pose les jalons de la cuisine moderne en brisant la lourdeur de la gastronomie d’Ancien Régime. Sa carrière fut un exemple pour tous les cuisiniers du XIXe siècle qui œuvraient pour l’ascension sociale du cuisinier.
Dans la droite ligne de la diplomatie géopolitique chère à Talleyrand (précurseur de l’Entente cordiale avec l’Angleterre), Carême est aussi prémonitoire des relations franco-américaines. Les ambassadeurs français se succédant à Washington à partir de 1893 pratiqueront la diplomatie culinaire - un bon repas peut avoir une vertu pacificatrice. En période de tensions ou de crises entre la France et les États-Unis, l’ambassadeur organise des dîners à la Résidence de Kalorama pour détendre l’atmosphère, maintenir le dialogue ou le renouer entre les deux pays. Souvenir du Congrès de Vienne.
« Au milieu des prodigalités du Directoire, Carême avait préparé le luxe délicat et l’exquise sensualité de l’Empire. »
Alexandre DUMAS (1802-1870), Le Grand Dictionnaire de cuisine (posthume, 1873)
Dès le début du XIXe siècle paraissent un grand nombre de livres consacrés à l’alimentation. Fin gourmet, c’est le dernier manuscrit remis à l’éditeur par Dumas-père en mars 1870 - il meurt le 5 décembre. Texte publié après sa mort, signé d’un fin connaisseur : « Alexandre Dumas partageait son temps entre la littérature et la cuisine ; lorsqu’il ne faisait pas sauter un roman, il faisait sauter des petits oignons. » (Charles-Pierre Monselet, Alexandre Dumas en tablier blanc, 2001).
Dumas, critique à juste titre de Vatel, rend hommage à Carême, Dans le concert des culinographes et des gastrolâtres, il occupe une place à part. Parfait artisan, il parle en praticien et sans effets littéraires de la cuisine et du statut de cuisinier - premier « chef » de l’histoire, rappelons qu’il instaura aussi la « toque » blanche en 1821, lors de son séjour à Vienne. Nostalgique et novateur, il incarne à la fois le dernier officier de bouche à la façon de l’Ancien Régime inspiré par le goût italien de Catherine de Médicis et le premier cuisinier artiste de la culture bourgeoise au XIXe, avec l’introduction de la diététique propre au XXe siècle. Son obsession du décor et sa manie du dessin caractérisent également la culture et la sensibilité de son époque.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.