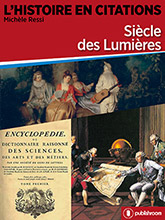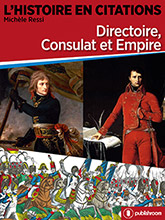« Nul doute que notre patrie ne doive beaucoup à l’influence étrangère. Toutes les races du monde ont contribué pour doter cette Pandore. […] Races sur races, peuples sur peuples. »
Jules MICHELET (1798-1874 ), Histoire de France, tome I (1835)
Le phénomène de l’immigration n’est pas traité en tant que tel. Il mérite pourtant d’être repensé à l’aune de ces noms plus ou moins célèbres.
- Diversité d’apports en toute époque, avec une majorité de reines (mères et régentes) sous l’Ancien Régime, d’auteurs et d’artistes (créateurs ou interprètes) à l’époque contemporaine.
- Parité numérique entre les femmes et les hommes, fait historique exceptionnel.
- Origine latine (italienne, espagnole, roumaine), slave (polonais) et de proximité (belge, suisse), plus rarement anglo-saxonne et orientale.
- Des noms peuvent surprendre : Mazarin, Lully, Rousseau, la comtesse de Ségur, Le Corbusier, Yves Montand, Pierre Cardin… et tant d’autres à (re)découvrir.
III. De Louis XIV à Napoléon : nouveaux apports étrangers marquant la fin de l’Ancien Régime.
Scaramouche, Lully, Marie-Thérèse, Henriette d’Angleterre, La Palatine, Marie Leczinska, Goldoni, Rousseau, Necker, Marie-Antoinette, Mme de Staël, Marie Walevska, Marie-Louise.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Scaramouche, alias Tiberio Fiorilli (1648-1694), homme de théâtre inspiré de la commedia dell’arte, exerçant une influence personnelle sur son ami et confrère, Molière.
« Tout aussi tôt que Scaramouche
A commencé d’ouvrir la bouche
Ses sauts, ses postures, ses mots,
Charment les sages et les sots
Et même on a vu des belles
En pisser de rire sous elles. » 1TALLEMANT des RÉAUX (1619-1692), Historiettes (posthume)
Le personnage de Scaramouche acquit les particularités et les virtuosités de son créateur, Tiberio Fiorilli (1648-1694) lui-même identifié à sa création.
Né à Naples, mauvais drôle dans sa jeunesse et trop habile à s’approprier le bien d’autrui, il quitte l’Italie vers 1640 pour fuir une intrigue politique – et suivre une troupe de comédiens ambulants. Après diverses pérégrinations, Fiorilli arrive à Paris sous le règne de Louis XIII : son jeu de Scaramouche, mélange des types italien et espagnol, plaît à la reine Anne d’Autriche et lui ouvre l’accès à la cour.
Le petit Louis XIV voulut le voir. L’artiste se présenta dans son costume de théâtre, avec sa guitare, son chien, son chat et son perroquet. L’enfant roi rit très fort de son numéro (et pissa comme les belles). Ce Scaramouche devint dès lors son amusement indispensable. Jusqu’à la fin de sa vie à 83 ans, le Roi le protégea et resta bon public pour cette fameuse commedia dell’arte.
Plus fondamentale, sa rencontre avec Molière marque l’histoire du spectacle. Les deux hommes se partagent le Théâtre du Petit-Bourbon, puis le Théâtre du Palais-Royal – Paris ne dispose que de trois salles dignes de ce nom et subventionnées. Loin de se disputer ou se jalouser comme il est coutume, les deux « stars » de la scène deviennent amies. Molière admire son ainé, s’inspirant de son jeu très physique dans les rôles de farces des Comédiens-Italiens, y ajoutant son génie propre et sa profonde humanité. Le personnage de Scaramouche est par la suite devenu un rôle type de la commedia dell’arte au même titre que le Capitan. Il aura les honneurs du dictionnaire de la langue française, véritable référence au XIXe siècle.
« Personnage bouffon de l’ancienne comédie italienne habillé de noir de la tête aux pieds. »
Définition du LITTRÉ (1872-77)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) né Giovanni Battista Lulli à Florence, représentant de la musique baroque et maître de l’opéra en France, courtisan arriviste et bisexuel tombé en disgrâce.
« Il y a des endroits de la musique qui ont mérité mes larmes. Je ne suis pas seule à ne les pouvoir soutenir, l’âme de Madame de La Fayette en est tout alarmée. » 2
Marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696), Lettre à sa fille Mme de Grignan (8 janvier 1674), écrite au lendemain d’une représentation de Cadmus et Hermione
Né en Italie, il incarne le modèle de la musique française du Grand Siècle, ayant eu le génie de synthétiser l’héritage de son pays d’origine et celui de la France. L’évolution de son langage musical et l’originalité de sa création apparaissent à travers l’ensemble de son œuvre : ballets, comédies-ballets, tragédies lyriques (Atys, Armide…), motets. On comprend ainsi l’extraordinaire succès de Lully et l’influence durable qu’il exerça.
Fils du meunier Lorenzo Lulli, né à Florence en 1632, remarqué par Roger de Lorraine, chevalier de Guise, il se retrouve à 14 ans « garçon de chambre » chez la nièce du chevalier, la duchesse de Montpensier dite « la Grande Mademoiselle » , soucieuse de parfaire ses connaissances en italien. Elle entretient un petit orchestre privé dont les six violons donnent de nombreux concerts. Lulli apprend le violon, le clavecin, la théorie et la composition musicales. Brillant danseur de surcroît, il crée pour sa protectrice la « Compagnie des violons de Mademoiselle » qui jouent mieux que ceux du roi.
Après la Fronde et la disgrâce de sa turbulente cousine, Louis XIV engage Lulli dans la Grande Bande des Violons du Roi, composée de 24 instruments. En 1653, il danse avec le monarque dans le Ballet royal de la nuit. C’est le début de son irrésistible ascension. Premier compositeur de la Cour, courtisan opportuniste et homme d’affaires avisé, surintendant de la musique royale, il écrit un ballet allégorique où le Soleil se trouve entouré de planètes, à l’image de Louis XIV avec ses ministres.
Naturalisé français en 1661 (début du règne personnel), le voilà devenu Lully.
À partir de 1664, il travaille avec Molière qui surnomme son ami « le paillard » . Il crée un genre nouveau, la comédie-ballet, sans renoncer aux ballets de cour chers au roi. Les pièces de Molière combinent alors comédies, ballets et chants : L’Amour médecin (1665), La Pastorale comique (1667), George Dandin (1668), Monsieur de Pourceaugnac (1669), Le Bourgeois gentilhomme et sa turquerie (1670). L’étroite collaboration entre ces deux génies de la scène française cesse en mars 1672, quand Lully rachète le privilège de l’Académie d’Opéra accordé en 1669 à Perrin. Il obtient des lettres patentes interdisant à toute personne « de faire chanter aucune pièce entière en France, en vers français ou autres langues, sans la permission par écrit dudit sieur Lully, à peine de dix mille livres d’amende, et de confiscation des théâtres, machines, décorations, habits… » L’Académie d’Opéra prend jusqu’à la Révolution le nom d’Académie royale de musique et s’installe dans la Salle du Jeu de paume, rue de Vaugirard.
En 1673, Lully compose sa première tragédie en musique (tragédie lyrique), Cadmus et Hermione, sur un livret de Philippe Quinault devenu son librettiste attitré. Il déloge les comédiens de Molière juste après sa mort en février 1673 et installe son Académie royale de musique en juillet dans l’aile droite du Palais-Cardinal (Palais Royal). Somptueusement agrandie, la salle peut accueillir 3 000 spectateurs.
Comblé d’honneurs et de richesses, Lully produit une tragédie par an. Fort de son monopole, il éclipse tous les compositeurs dramatiques de son époque (Marc-Antoine Charpentier, André Campra, Louis-Nicolas Clérambault). En 1681, devenu « secrétaire du roi » , élevé à la noblesse héréditaire en qualité d’écuyer, il est l’apogée de sa carrière.
« On entend quelquefois les partisans de Lulli se récrier d’admiration sur ce que c’est un étranger qui a créé notre récitatif ; il y paraît, on sait à quel point la prosodie y est estropiée, surtout dans les finales. » 3
Jean le Rond d’ALEMBERT (1717-1783), De la liberté de la musique
L’artiste est souvent encensé à juste titre, mais le courtisan très discuté – ayant notamment trahi l’amitié de Molière !
Louis XIV a fermé les yeux sur la bisexualité de son musicien préféré – son propre frère Philippe de France est notoirement homosexuel. Mais sous l’influence de la très catholique Mme de Maintenon, le roi tolère plus difficilement cette « bougrerie » nommée aussi « vice italien » . Jusqu’au scandale en 1685 : la liaison de Lully avec Brunet, un jeune page de la Chapelle royale de Versailles logeant chez lui. Lully perd son crédit auprès du roi qui n’assiste pas aux représentations d’Armide en 1686. Sa dernière œuvre, Acis et Galatée, une pastorale en forme d’opéra, est créée au château d’Anet, devant le Grand Dauphin (fils aîné de Louis XIV) en septembre 1686.
Le 8 janvier 1687, son Te Deum doit être chanté pour la guérison du roi atteint d’une fistule anale. Lors d’une répétition avec ses150 musiciens, Lully s’emporte comme souvent et se blesse au pied avec le lourd bâton de direction dont on frappe le sol pour battre la mesure. Sa jambe va s’infecter. Danseur, il refuse l’amputation. La gangrène se propage et il meurt le 22 mars 1687, « âgé de 55 ans ou environ » .
« Et tous ces lieux communs de morale lubrique
Que Lully réchauffa des sons de sa musique. »Nicolas BOILEAU (1660-1711) Satires
En d’autres termes, Boileau accuse ses tragédies lyriques d’inciter à la débauche – il figure pourtant au nombre de ses librettistes. Le maître du bon goût artistique en son temps lui rend hommage à sa manière, cependant que la postérité joue en sa faveur. Ce génie musical a véritablement mis à la mode l’opéra français en France – après son compatriote Mazarin, né Mazarini, qui introduisit l’opéra italien en 1645 avec La Finta Pazza (La Folle supposée), par le biais du grand spectacle « à machines » toujours très prisé du public et du ballet.
L’apport artistique de l’étranger en France ne cessera de se développer jusqu’à nos jours, notamment dans la musique et le spectacle, l’appétit culturel et la mode triomphant heureusement du racisme.
Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683), infante d’Espagne, femme relativement effacée de Louis XIV.
« Vive tout ce qui vient d’Espagne
Hors la fille de leur Roi ! » 803Ils sont gens de parole, chanson (1660). L’Avènement du Roi-Soleil (1967), Pierre Goubert
La chanson, bien avant les sondages, reflète l’opinion publique : on aime bien les Espagnols, leurs bons vins et leurs pistoles, mais pas les reines qu’ils donnent à la France. La reine mère Anne d’Autriche fut parfois impopulaire et l’on voit venir avec crainte la nouvelle Espagnole, l’infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV : mariage négocié, lié au traité des Pyrénées. La France limite ses exigences territoriales (Artois, Roussillon, quelques places fortes en Flandre et Lorraine) pour mieux réussir l’affaire du mariage : l’infante renonce à ses droits sur l’Espagne contre une dot exorbitante (500 000 écus d’or). L’Espagne (ruinée) ne pourra payer. Et Louis XIV pourra faire valoir ses droits – c’est dire que la guerre, en germe, est inscrite entre les lignes du traité.
Pour l’heure, le mariage est une cérémonie à grand spectacle, célébré comme il se doit.
« Elle est digne de lui comme il est digne d’elle.
Des Reines et des Rois, chacun est le plus grand.
Et jamais conquête si belle
Ne mérita les vœux d’un si grand conquérant. » 804Jean RACINE (1639-1699), La Nymphe de la Seine (1660)
Le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse est célébré le 6 juin 1660, avant l’entrée triomphale à Paris le 26 août.
Poète très courtisan et quelque peu besogneux quand il écrit ainsi à la louange des jeunes époux en attendant d’être promu historiographe du roi, Racine n’exprime pas moins l’admiration et même la vénération des Français pour leur roi, image de Dieu sur Terre, par ailleurs fort bel homme et attendu comme un nouveau héros de leur histoire.
« Vous devez oublier que vous avez été infante pour vous souvenir seulement que vous êtes reine de France. »
PHILIPPE IV (1605-1665)
Marie-Thérèse d’Autriche dit adieu à son père et tous deux savent qu’ils ne se reverront jamais – une scène si déchirante que Louis XIV et son frère Phillipe d’Orléans versèrent quelques larmes. Mais le roi d’Espagne insiste auprès de sa fille sur le fait qu’elle est désormais française. Telle est le sort de toutes nos souveraines étrangères.
Le mariage a lieu le 9 juin 1660, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz – ville près de la frontière entre l’Espagne et la France où Marie-Thérèse demeura dans la maison Joanoenia, construite en 1640 par un riche armateur Joannot de Haraneder, dite aujourd’hui encore « maison de l’Infante » .
La reine souffre des adultères du roi – après la mort de sa mère, il ne prend plus la peine de cacher ses aventures. À l’automne 1666, il tombe sous le charme de Mme de Montespan et après quelques éclats de colère, Marie-Thérèse doit s’éclipser face à la nouvelle favorite. Son époux l’oblige à prendre comme dames de compagnie ses deux maîtresses, Louise de La Vallière et Mme de Montespan. Il voyage ouvertement avec elles. Le peuple murmure, goguenard ou affligé : « Le roi promène les trois reines » . Marie-Thérèse d’Autriche use quand même des privilèges dus à son rang pour mener la vie dure à ses rivales ! Elle souffre aussi des légitimations successives des enfants naturels de son mari qui éclipsent son premier fils Louis de France, dit le Grand Dauphin, l’ainé de ses six enfants. Elle lui fera de nombreux reproches sur sa conduite, en vain.
« La reine est fort bien à la cour. »
Mme de SÉVIGNÉ (1626-1696), citée par Alexandre Maral, Femmes de Versailles (2019)
À partir de l’été 1680 et sous l’influence de Mme de Maintenon, Louis XIV se rapproche de son épouse qu’il avait publiquement délaissée. Marie-Thérèse est visiblement émue par les attentions inattendues de son volage époux : « Dieu a suscité Mme de Maintenon pour me rendre le cœur du roi ! Jamais il ne m’a traitée avec autant de tendresse que depuis qu’il l’écoute ! » En signe de reconnaissance, la reine lui manifeste toute sa bienveillance. Reste l’ultime aveu…
« Depuis que je suis reine, je n’ai eu qu’un seul jour heureux. »
MARIE–THÉRÈSE (1638-1683), son mot de la fin, cité par Marc Lefrançois, Histoires insolites des Rois et Reines de France (2013)
Elle meurt à 44 ans d’une erreur médicale – un abcès au bras gauche qu’il aurait fallu inciser, alors que la traditionnelle saignée ne fait qu’affaiblir la malade.
« Voilà le premier chagrin qu’elle m’ait jamais donné. » 9
LOUIS XIV à la mort de Marie-Thérèse, cité par Chamfort, Maximes et Pensées (posthumes)
Louis XIV est aidé dans cette fermeté d’âme par un remarquable contrôle de soi-même, de ses gestes comme de ses propos, et par un égoïsme foncier, aussi royal que masculin. Ce mot peut d’ailleurs être interprété de diverses manières. Il trahit surtout une forme de royale indifférence.
Lully fera entendre son Dies irae et son De profundis, Bossuet sera chargé de l’oraison funèbre. Il s’en tira plus laborieusement que dans d’autres cas à venir : Madame, Henriette d’Angleterre, ou Louis de Bourbon dit le grand Condé.
« L’Espagne perdit ce que nous gagnions ; maintenant nous perdons tout les uns et les autres, et Marie-Thérèse périt pour toute la terre. L’Espagne pleurait seule ; maintenant que la France et l’Espagne mêlent leurs larmes et en versent des torrents, qui pourrait les arrêter ? Mais, si l’Espagne pleurait son infante qu’elle voyait monter sur le trône le plus glorieux de l’univers, quels seront nos gémissements à la vue de ce tombeau, où tous ensemble nous ne voyons plus que l’inévitable néant des grandeurs humaines ? »
BOSSUET (1627-1704), Oraison funèbre de Marie Térèse d’Autriche, Infante d’Espagne, Reine de France & de Navarre (1689)
Deux mois après ces grandes cérémonies, le roi épousera secrètement sa dernière maîtresse qu’il surnommait dans le privé « sainte Françoise » : Madame de Maintenon. Cette dernière affecte de porter le deuil et de montrer une mine déconfite, alors que le roi renoua presque aussitôt avec les divertissements.
Henriette d’Angleterre dite Madame (1644-1670), princesse malmenée par l’Histoire, pauvre exilée devenue idole de la cour de France et morte à 26 ans, sans doute empoisonnée.
« Mon frère, vous allez épouser tous les os des Saints Innocents. » 856
LOUIS XIV (1638-1715), à son frère Philippe d’Orléans, fin mars 1661. Mémoires de Mlle de Montpensier
On le marie malgré lui à Henriette Anne d’Angleterre, fort maigre (d’où la métaphore avec le cimetière parisien des Saints Innocents), alors que la mode est aux femmes bien en chair. Étonnant mariage « forcé » assurément contre-nature et pour raison d’État très particulière.
Monsieur est un homosexuel notoire. Mazarin, alors Premier ministre, s’est chargé d’éduquer Philippe d’Orléans de façon à affaiblir sa personnalité, pour éviter que Louis XIV ait avec lui les mêmes ennuis que Louis XIII avec son frère Gaston d’Orléans, l’éternel comploteur ! Il l’a fait initier à l’homosexualité par son neveu Filipo Mancini, en flattant ses penchants innés pour les fards et les déguisements. Ses mœurs choquent la cour et le mariage sera bienvenu. Philippe fera nombre d’enfants à ses deux femmes successives (la seconde étant la princesse Palatine, mère du futur Régent). Il se révélera aussi l’un des meilleurs chefs militaires de son temps, au point que Louis XIV, jaloux, lui retirera tout commandement !
Henriette est doublement de sang royal, Stuart par son père Charles Ier d’Angleterre et Bourbon par sa mère (Henriette Marie de France), fille d’Henri IV et sœur de Louis XIII. Suite à la révolution anglaise qui aboutit à l’exécution du roi, elle se réfugie en France avec sa fille. Négligée, ignorée, vivant pauvrement au couvent de Chaillot, mal chauffée, guère éduquée, la jeune Henriette redevient princesse digne de ce nom quand son frère aîné retrouve le pouvoir et devient Charles II d’Angleterre. À 16 ans, avec la reine et la reine-mère, la voilà devenue l’une des trois femmes les plus importantes de la Cour et de France, le pays le plus puissant d’Europe.
Le mariage d’Henriette et de Monsieur est décidé par Louis XIV et sa mère Anne d’Autriche en 1661, l’année où Mazarin meurt et où le roi commence son règne personnel. C’est l’une des premières grandes décisions du Roi-Soleil qui renforce ainsi les liens entre les deux principaux royaumes d’Europe. Mais le bonheur de la princesse sera de courte durée.
« Vous ne m’avez jamais aimée. »
Henriette D’ANGLETERRE (1644-1670) à son époux, ses derniers mots qui résument des centaines de pages d’une Correspondance parfois désespérée
Philippe se dira amoureux de sa femme les quinze premiers jours de leur mariage. Il la délaisse ensuite pour ses favoris. Il lui fera quand même quatre enfants viables (sur huit grossesses en dix ans) pour l’empêcher de trop plaire ailleurs. Peine perdue, la nouvelle idole de la cour attire tous les regards.
Louis XIV trouve soudain bien des charmes à sa belle-sœur, plus présentable que sa propre épouse Marie-Thérèse. Elle chante et danse à ravir, brille dans toutes les fêtes et s’épanouit visiblement. Leur relation dépasse l’amitié – amour platonique doublé d’une grande complicité. On parla d’une véritable liaison entre le roi et Madame, c’est peu probable. Ce serait considéré comme un inceste entre frère et sœur par la religion de l’époque (on ignore le terme de « belle-sœur » ) et Louis XIV est très croyant. Mais pour couper court aux rumeurs, il feindra une liaison avec Mlle de la Vallière qui sert de paravent, avant de devenir sa prochaine favorite.
Au plan politique, le roi se sert très officiellement d’Henriette : il l’envoie en mission auprès de son frère Charles II qui l’aime tendrement, déclenchant à nouveau la jalousie de son frère Philippe et de son mignon le comte de Guiche (ex-amant d’Henriette) qui aurait bien voulu qu’on lui confie ce rôle. Mission accomplie : la signature du traité de Douvres scelle le rapprochement entre l’Angleterre et la France Quinze jours après son retour, elle tombe subitement malade.
« Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte. » 873
BOSSUET (1627-1704), Oraison funèbre d’Henriette Anne d’Angleterre (1670)
Depuis dix ans, l’évêque de Meaux est le prédicateur de la cour : des sermons par centaines et une éloquence incantatoire dont Malraux, ministre de la Culture, retrouvera les accents et le lyrisme, trois siècles après.
On imagine mal le choc provoqué par la mort de cette princesse de 26 ans qui fut pendant dix ans le plus bel ornement de la cour de Louis XIV, qui avait la grâce, l’esprit, les vertus de sa bisaïeule Marie Stuart – sa fin prématurée et cruelle lui donne un autre trait de ressemblance. L’éloge funèbre de Madame, femme de Monsieur, fait écho à cette émotion et reste un modèle du genre : « Le roi, la reine, Monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré ; et il me semble que je vois l’accomplissement de cette parole du prophète : « Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d’étonnement. » » Le choc est d’autant plus terrible que tous les présents pensent à l’empoisonnement !
Cette opinion fut contredite par l’historien du règne, Voltaire qui la regarde comme un bruit populaire dénué de fondement. Madame de La Fayette, amie de la princesse, parle dans son Histoire de Madame Henriette d’Angleterre d’un malaise récurrent et décrit les symptômes d’une péritonite. Une autopsie confirme le délabrement de son corps : elle avait toujours vécu au-dessus des moyens d’une santé fragile.
À l’inverse, la publication des Lettres de Madame (la Palatine, seconde femme du duc d’Orléans), les Mémoires du duc de Saint-Simon et surtout les Fragments historiques de Duclos ont changé les soupçons d’empoisonnement en certitude. Morel, « contrôleur de la bouche » , fut introduit secrètement la nuit même suivant la mort de cette princesse dans le cabinet du roi et confirma : « Madame a été empoisonnée : le chevalier de Lorraine a envoyé de Rome le poison au marquis d’Effiat, et nous l’avons mis dans l’eau que Madame a bue. » Le chevalier était l’amant en titre de Monsieur et le marquis un serviteur totalement dévoué au couple. Le témoin donne mille autres détails.
Au terme d’un destin hors norme, le mystère reste entier sur cette mort.
La Palatine (1652-1722), mère du Régent, Bavaroise qui étonne et détone à la cour par sa liberté de ton.
« Ma taille est monstrueuse, je suis carrée comme un dé, la peau est d’un rouge mélangé de jaune, je commence à grisonner, j’ai les cheveux poivre et sel, le front et le pourtour des yeux sont ridés, le nez est de travers comme jadis, mais festonné par la petite vérole, de même que les joues ; je les ai pendantes, de grandes mâchoires, des dents délabrées ; la bouche aussi est un peu changée, car elle est devenue plus grande et les rides sont aux coins : voilà la belle figure que j’ai, chère Amelise ! » 14
Princesse PALATINE (1652-1722), Lettre à sa demi-sœur, 22 août 1698
Cruel autoportrait, dans l’une des 60 000 lettres qui valent à son auteur un surnom pour le moins original : « Océan d’encre » . Mme de Sévigné est battue, même si les deux femmes ne jouent pas sur le même terrain ni avec les mêmes armes. L’une crée un genre littéraire et le porte à la perfection « classique » , l’autre « déballe » au fil de ses emportements et ne s’impose aucune censure de fond ni de forme. C’est un personnage totalement atypique du siècle de Louis XIV.
Venue de Bavière, la Palatine épousa Monsieur, frère du roi (veuf de la première Madame, Henriette d’Angleterre, morte en 1670 à 26 ans). Ils firent trois enfants pour assurer la descendance, et ensuite lit à part – lui n’aimait pas les femmes, elle était devenue obèse et marquée par la petite vérole, ainsi qu’elle se décrit sans complaisance.
Elle n’épargne pas non plus les gens de la cour – sauf son beau-frère Louis XIV, par respect dû au roi. Il lui en voudra des abominables surnoms donnés à sa seconde épouse, Mme de Maintenon, mais à la mort de son frère (Monsieur) et contrairement à la règle, il autorisera la veuve Palatine à conserver son rang, ses résidences et ses appartements au château de Versailles.
Elle nous laisse un témoignage littéralement extraordinaire de la vie à la Cour du Roi Soleil, alliant un humour rare et une insolente franchise qui manquent aux Mémoires de Saint Simon dont l’envie et l’aigreur altèrent parfois le jugement. Mère du Régent, on la retrouvera sous la Régence, jugeant son propre fils.
« Il aura tous les talents, excepté celui d’en faire usage. » 1070
Princesse PALATINE (1652-1722), parlant de son fils, le Régent, et « citant » avec humour la mauvaise fée venue lui jeter un sort, lors de ses couches. Histoire de France (1852), Augustin Challamel
Son amour maternel ne l’aveugle pas sur ce fils qu’elle n’épargne guère : premier prince du sang, elle le gifle devant la cour à l’annonce de son mariage avec Mlle de Blois, fille légitimée de Louis XIV et de la Montespan, malgré tout bâtarde et « qui ressemble à un cul comme deux gouttes d’eau » .
Elle admire son intelligence, ses succès militaires. Pierre Gaxotte confirme : « Il avait reçu en partage tous les dons de l’intelligence, toutes les curiosités de l’esprit, une bonté réelle et expansive, une bravoure, une endurance et des talents qui avaient brillé à la guerre » (Le Siècle de Louis XV).
Mais elle déplore ses mœurs indignes d’un Régent : il multiplie les blasphèmes, les beuveries et les bâtards, se plaisant en mauvaise compagnie (avec ses « roués » , bons pour le supplice de la roue), soupçonné d’inceste (avec sa fille), de sorcellerie et d’empoisonnement (sur la personne de ses cousins). Son goût de la provocation le pousse à afficher ses pires côtés. Au grand dam de sa mère !
Marie Leczinska (1703-1768), reine à jamais amoureuse de Louis XV le Bien aimé, bientôt lassé de cette femme soumise et toujours enceinte.
« La princesse de Pologne avait près de vingt-deux ans, bien faite et aimable de sa personne, ayant d’ailleurs toute la vertu, tout l’esprit, toute la raison qu’on pouvait désirer dans la femme d’un roi qui avait quinze ans et demi. » 1095
Maréchal de VILLARS (1653-1734), 28 mai 1725. Mémoires du maréchal de Villars (posthume, 1904)
La vertu est indiscutable chez la nouvelle reine de France – et le demeura. Peut-être le bonheur la fît elle jolie un temps, car elle adorait son roi qui en fut aussitôt épris. Mais son propre père, le roi de Pologne, assurait n’avoir jamais connu de reines plus ennuyeuses que sa femme et sa fille ! Or Louis XV, de nature mélancolique, aura surtout besoin de légèreté, de gaieté, d’esprit. On ne peut donc imaginer couple plus mal assorti. Et pourtant…
Après le mariage (4 septembre 1725) et selon le témoignage de Villars, fringant septuagénaire, « la nuit du 5 au 6 a été pour notre jeune roi une des plus glorieuses […] la nuit du 6 au 7 a été à peu près égale. Le roi, comme vous croyez bien, est fort content de lui et de la reine, laquelle, en vérité, est avec raison bien reine de toutes les façons. » Le duc de Bourbon confirme par lettre au père de la mariée que le roi donna à la reine « sept preuves de tendresse » la première nuit qui avait duré treize heures.
C’est le début de la carrière amoureuse de Louis XV et la preuve que les rois n’ont pas de vie privée. Toujours ce mélange de petite et grande histoire !
« Toujours coucher, toujours grosse, toujours accoucher. » 1106
Marie LECZINSKA (1703-1768), en 1737. Les Rois qui ont fait la France, Louis XV le Bien-Aimé (1982), Georges Bordonove
Telle est la vocation assignée à une reine. C’est peu dire qu’elle fait son devoir. En dix ans de mariage, elle donne dix enfants au roi (dont sept filles). La dernière grossesse est difficile, sa santé s’en ressent, elle doit se refuser à son époux sans lui dire la raison, il s’en offusque et s’éloigne d’elle.
Elle perd toute séduction, se couvre de fichus, châles et mantelets pour lutter contre sa frilosité. Toujours amoureuse, elle sera malheureuse et l’une des reines les plus ouvertement trompées. Mais elle reste populaire et garde son surnom : « Notre Bonne Reine » . La prochaine, Marie-Antoinette l’Autrichienne, finira en Veuve Capet, déchue, haïe et guillotinée.
Pour la petite histoire culinaire, on doit à Marie Leczinska l’invention de la fameuse « bouchée à la reine » par le pâtissier alsacien de Versailles, Nicolas Stohrer qui ouvrit boutique au 51 rue de Montorgueil à Paris. Elle existe toujours.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Carlo Goldoni (1707-1793), surnommé le Molière italien, c’est aussi l’Italien de Paris au siècle de la « théâtromanie » .
« Paris est un monde. Tout y est grand : beaucoup de mal et beaucoup de bien. Aller aux spectacles, aux promenades, aux endroits de plaisir, tout est plein. Aller aux églises, il y a foule partout. » 980
Carlo GOLDONI (1707-1793), Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie et à celle du théâtre (1787)
Il est immédiatement séduit par le lieu : « Paris est beau, ses environs sont délicieux, ses habitants sont aimables. »
Auteur dramatique vénitien adopté par la capitale, il profite du goût des Parisiens pour les spectacles. Les salles se multiplient (c’est la fameuse « théâtromanie » du siècle des Lumières), cependant que les superbes hôtels particuliers voisinent avec des immeubles de rapport cossus. Le très français Montesquieu confirme : « Je hais Versailles parce que tout le monde y est petit ; j’aime Paris parce que tout le monde y est grand. »
« C’est le ton de la nation ; si les Français perdent une bataille, une épigramme les console ; si un nouvel impôt les charge, un vaudeville les dédommage. » 1149
Carlo GOLDONI (1707-1793), Mémoires (1787)
L’Italien de Paris connaît bien notre pays et notre littérature. Surnommé « le Molière italien » , il voulut réformer la comédie italienne dans son pays, ôtant les masques aux personnages et supprimant l’improvisation pour écrire ses pièces de bout en bout, d’où son premier chef-d’œuvre, La Locandiera. Il fut violemment attaqué par Carlo Gozzi, comte querelleur et batailleur défendant la tradition de la commedia dell’arte à coups de libelles et de cabales.
Fatigué de cette « guerre des deux Carlo » , le paisible Goldoni, invité par Louis XV, s’installe définitivement à Paris en 1762. Il écrit en français pour la Comédie-Italienne (rivale de la Comédie-Française), devient professeur d’italien à la cour. Il sera également pensionné sous Louis XVI. Il rédige ses Mémoires à la fin de sa vie, pauvre, malade, presque aveugle, mais exprimant toujours sa gratitude pour la France – même si la Révolution supprime sa pension à l’octogénaire.
Rappelons trois de ses titres restés au répertoire. La Locandiera, Arlequin valet de deux maîtres et la Trilogie de la Villegiature.
« Ceux qui me courent après ont vite fait de m’ennuyer. La noblesse, ce n’est pas pour moi. La richesse, je l’estime, mais pas plus que ça. Tout mon plaisir consiste à me voir servie, courtisée, adorée. C’est là mon point faible et celui de presque toutes les femmes. »
Carlo GOLDONI (1707-1793), La Locandiera (1752)
Dans une auberge de Florence, un marquis et un comte rivalisent de grâces auprès de la maîtresse des lieux dont ils voudraient l’un et l’autre obtenir les faveurs. Mais Mirandolina prête davantage d’attention à un autre de ses clients, le sombre Chevalier de Ripafratta, misogyne et rugueux, plein de morgue à son endroit. Pour venger l’affront qu’il fait à son sexe, elle se met en tête de le séduire – pour mieux le berner.
Jouée pour la première fois le 26 décembre 1752, cette satire de la bourgeoisie italienne, comédie de mœurs et d’humour, doit beaucoup à l’héroïne dont la faconde, le charme et le talent de simulation ne font pas oublier la face d’ombre que le chevalier finit par découvrir tardivement et à ses dépens. Son caractère se construit ainsi sous nos yeux et justifie la remarque de Stendhal disant de Goldoni que ses personnages « tournent et vivent. »
« J’ai servi à table deux maîtres, et aucun des deux ne s’est douté qu’il y en avait un autre. Mais puisque j’ai servi pour deux, maintenant, je veux manger pour quatre. »
Carlo GOLDONI (1707-1793), Arlequin valet de deux maîtres (1753)
Servir deux maîtres à la fois, tel est le défi de Truffaldin. Ingénu autant qu’ingénieux valet. Il s’invente un double, bouleverse les amours de ses maîtres, reçoit double ration de coups de bâton, mais finit par triompher avec ce principe : « L’amour, c’est le meilleur des menus ! »
Simple canevas en 1745, la pièce parfaitement construite et écrite au final est à la fois un hommage virtuose à la commedia dell’arte née deux siècles plus tôt et un premier pas vers la réforme de la comédie et des comédiens voulue par Goldoni.
« Le monde a un charme si puissant qu’il vous fait faire des choses qu’on ne voudrait pas. »
Carlo GOLDONI (1707-1793), Trilogie de la Villegiature (1761)
Pour imiter la mode aristocratique, des bourgeois de Venise s’adonnent aux migrations estivales de la « villégiature » . Tout le monde prépare un séjour à la campagne. Des intrigues amoureuses se nouent et se dénouent déjà. Guglielmo et Giacinta qui s’aiment décident, par respect des engagements pris pour eux, de renoncer à leur amour…
En 1954, au théâtre de l’Odéon à Paris, la mise en scène magique et brechtienne de Giogio Strehler (1921-1997) marqua une génération de spectateurs. On peut regretter le caractère éphémère du spectacle vivant – cela fait aussi son charme.
« Il y a des plaisirs pour tous les états : bornez vos désirs, mesurez vos forces, vous serez bien ici, ou vous serez mal partout. »
Carlo GOLDONI (1707-1793), Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie et à celle du théâtre (1787)
Laissons le mot de la fin au personnage le plus attachant : cet auteur aussi français qu’italien, singulièrement doué pour le bonheur (par l’art) et en cela proche des philosophes des Lumières : « Je ne suis pas Musicien, mais j’aime la musique de passion ; si un air me touche, s’il m’amuse, je l’écoute avec délice, je n’examine pas si la musique est Française ou Italienne ; je crois même qu’il n’y en a qu’une. »
Rousseau (1712-1778), né en Suisse (et genevois), philosophe des Lumières qui fait bande à part et reste comme le meilleur ami-ennemi du grand Voltaire.
« Depuis l’Évangile jusqu’au Contrat social, ce sont les livres qui ont fait les révolutions. » 1000
Vicomte Louis de BONALD (1754-1840), Mélanges littéraires, politiques et philosophiques, « Sur les éloges historiques de MM. Séguier et de Malesherbes »
Les philosophes n’étaient pas révolutionnaires, mais leur pensée le devint, diffusée par leurs œuvres. En schématisant : à Voltaire le temps de la pré-Révolution ; Montesquieu triomphe sous la Constituante où Diderot aussi a son heure ; Législative et Convention s’inscrivent sous le signe de Rousseau qui inspire l’élan des discours jacobins.
« Avec Voltaire, c’est un monde qui finit. Avec Rousseau, c’est un monde qui commence. » 1032
GOETHE (1749-1832). Encyclopædia Universalis, article « Voltaire »
Le siècle de raison va céder le pas au siècle des passions. Voltaire exprime et résume le XVIIIe siècle avec son ardente humanité, sa vocation à l’universel, sa sagesse, sa défense des libertés, des droits formels. Rousseau annonce le XIXe avec l’égalité, la fraternité, la fibre civique, les droits réels.
Brouillés « à mort » dans la vie, Voltaire et Rousseau seront réconciliés devant l’éternité par la même « panthéonisation » d’une Révolution qui rend ainsi hommage à tout le siècle philosophique.
« Personne ne nous a donné une plus juste idée du peuple que Rousseau, parce que personne ne l’a plus aimé. » 1033
ROBESPIERRE (1758-1794), Discours aux Jacobins (1792). Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des Assemblées nationales (1834-1838), P.J.B. Buchez, P.C. Roux
Le personnage se situe aux antipodes du courtisan Voltaire, ou de Montesquieu le seigneur. Si La Bruyère a dit « je veux être peuple » , Rousseau l’a prouvé. Sa vie sociale, en accord avec sa philosophie, est sa défense contre qui l’attaque. Laquais, vagabond, aventurier, précepteur, secrétaire, se déconsidérant par une liaison avec la servante d’auberge Thérèse Levasseur, il refuse pensions et sinécures, se fait copiste de musique pour vivre et seul de tous les écrivains militants de son siècle signe tous ses écrits, ce qui lui vaudra encore plus d’ennuis qu’aux autres. Luttant contre la misère plus que pour la gloire, Rousseau éprouvera toujours une rancœur de roturier contre l’inégalité sociale.
« Jeté dès mon enfance dans le tourbillon du monde, j’appris de bonne heure par l’expérience que je n’étais pas fait pour y vivre. » 1034
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Les Rêveries d’un promeneur solitaire (posthume, 1782)
Voltaire et Diderot furent injustes et même cruels envers lui, comme Hugo le traitant de « faux misanthrope rococo » . Sincèrement épris de nature et de solitude, il est inapte à la vie sociale, incompris et déplorant de si mal communiquer, rebelle à toute contrainte, dégoûté de ce qui l’entoure et souffrant du contact des hommes jusqu’à la folie de la persécution. Exception à la règle dans ce siècle éminemment sociable et volontiers heureux, il conclut dans un dernier paradoxe de ses Rêveries d’un promeneur solitaire : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. »
« La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable. » 1035
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Dialogues : Rousseau juge de Jean-Jacques (1772-1776)
Ce postulat fonde toute son œuvre politique, pédagogique, morale, religieuse, romanesque. On le trouve dès 1750 dans le Discours sur les sciences et les arts : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Il récidive avec sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758) qui dit les dangers du théâtre en général et de Molière en particulier, « école de mauvaises mœurs » . Rousseau en fait aussi un roman par lettres, « best-seller » du temps (plus de 70 éditions en quarante ans), hymne à la nature, la vertu et la passion : Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761). Ce « barbare » qui dénonce le faux progrès de la civilisation des Lumières heurte les autres philosophes.
« J’ose presque assurer que l’état de réflexion est un état contre nature et que l’homme qui médite est un animal dépravé. » 1036
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755)
Cette petite phrase va naturellement faire réagir Voltaire ! Provocation lancée à ce siècle épris de raison et à tous ses confrères qui font métier de penser. Le Discours sur l’inégalité est un brûlot dangereux à bien d’autres égards…
« Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ! » 1037
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755)
Constat numéro un, l’inégalité naît de la propriété : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : « Ceci est à moi » , et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » Mise en cause du principe de la propriété sur lequel reposent les sociétés modernes, c’est la voie ouverte au socialisme. Rousseau se montre ici le plus hardi des philosophes, n’en déplaise à Voltaire.
« Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien. » 1038
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
Œuvre majeure de l’auteur et autre constat : la législation, sous prétexte de protéger les faibles, renforce l’inégalité. C’est le cercle vicieux de l’injustice sociale née du mal initial qu’est la propriété.
« L’homme est né libre et partout il est dans les fers. » 1039
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social, Préambule (1762)
Constat réitéré de l’échec des sociétés modernes. Et d’ajouter aussitôt : « Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. » Il méditait depuis longtemps de livrer le message de son idéal politique : selon Edgar Quinet, le Contrat social est le « livre de la loi » de la Révolution et Rousseau « est lui-même à cette Révolution ce que le germe est à l’arbre » .
« Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. » 1041
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
La liberté naturelle n’a pour bornes que les forces de l’individu, alors que la liberté civile est limitée par la volonté générale ; la possession n’est que l’effet de la force ou du droit du premier occupant, alors que la propriété ne peut être fondée que sur un titre positif. Dans la mesure où les citoyens adhèrent librement au pacte social, la liberté est respectée, car « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » .
« La volonté est générale, ou elle ne l’est pas : elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. » 1042
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
Idée neuve : le peuple est un, doué d’une volonté comme un individu, et non pas une multitude désordonnée d’individus et de pensées en conflit – Voltaire parle de « populace » . Rousseau rendit possible et acceptable l’opération littéralement révolutionnaire : remplacer le roi et sa volonté par ceux qui expriment la volonté du peuple. Cette volonté une, donc indivisible, fondera aussi chez les révolutionnaires le refus d’un partage et d’un équilibre des pouvoirs (si chers à Montesquieu).
« Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. » 1044
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
Le principe de la ratification populaire des lois est l’une des rares idées rousseauistes précises, apportée à la Révolution et adoptée par la Constitution de 1793. Le plus souvent, l’inspiration est au niveau de principes aussi généraux que généreux, dont la relative indétermination permettra d’ailleurs d’inspirer des politiques contradictoires. Mais n’est-ce pas là le destin politique de bien des idées philosophiques et théoriques !
« Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux. » 1047
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
C’est le droit à l’insurrection, et même le devoir, quand le contrat social est violé. Il sera reconnu dans l’éphémère Constitution de 1793, inappliquée mais aussi inapplicable.
« Il n’y a qu’une science à enseigner aux enfants, c’est celle des devoirs de l’homme. » 1050
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), L’Émile ou De l’Éducation (1762)
Pas de société saine sans des hommes sains. Idéal pédagogique : préserver la liberté naturelle de l’enfant. Rousseau qui doit beaucoup à Montaigne s’inspire aussi de son expérience d’autodidacte : « L’essentiel est d’être ce que nous fit la nature ; on n’est toujours que trop ce que les hommes veulent que l’on soit. »
« Si les corps des enfants ne sont plus oppressés par des ressorts de baleine, si leur esprit n’est plus surchargé de préceptes, si leurs premières années du moins échappent à l’esclavage et à la gêne, c’est à Rousseau qu’ils le doivent. » 1193
Marquis de CONDORCET (1743-1794), en 1774. Lettres d’un théologien, Œuvres complètes de Condorcet, volume X (1804)
Disciple des physiocrates, auteur de plusieurs articles d’économie politique dans l’Encyclopédie, ce philosophe et mathématicien qui jouera un rôle politique sous la Révolution, rend hommage à l’auteur de l’Émile. Les idées des philosophes parfois ont changé la vie, avant de révolutionner la France.
Immense succès de ce traité sur l’éducation. Cette « régénération » morale profite aussi aux esprits. « Il me semble que l’enfant élevé suivant les principes de Rousseau serait Émile, et qu’on serait heureux d’avoir Émile pour son fils » dira Mme de Staël en 1788. Moins heureux furent les cinq enfants de Rousseau et Thérèse Levasseur, abandonnés aux Enfants trouvés – Rousseau affirmant n’avoir pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins…
« La femme est faite pour céder à l’homme et pour supporter même son injustice. » 1051
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), L’Émile ou De l’Éducation (1762)
Peut-on parler d’une ombre à la philosophie des Lumières, dans un siècle où les femmes, reines en leurs salons littéraires, ont aussi une influence dans la politique et l’art ?
Rousseau précise : « Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès l’enfance. » C’est dire que la petite Sophie ne partira pas avec les mêmes chances dans la vie que le petit Émile !
« Proposez ce qui est faisable, ne cesse-t-on de me répéter. C’est comme si l’on me disait : proposez de faire ce que l’on fait […] Pères, mères, ce qui est faisable est ce que vous voulez faire. » 1052
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), L’Émile ou De l’Éducation (1762)
Toute la Révolution va marcher dans l’élan de ce « vouloir, c’est pouvoir » , appliqué aux choses politiques, et comparable deux siècles plus tard au fier slogan de Mai 68 : « Soyons réalistes, demandons l’impossible. »
« J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain […] On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage. » 1138
VOLTAIRE (1694-1778), Lettre à Jean-Jacques Rousseau, 30 août 1755, Correspondance (posthume)
Ce jugement vise le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, point de départ de la philosophie politique de Rousseau qui annonce le Contrat social. Il y a incompatibilité d’esprit entre les deux personnages et Rousseau écrira cinq ans plus tard à son ami M. Moulton : « Je le haïrais davantage, si je le méprisais moins. »
Les deux hommes s’opposent en tout. Rappelons le mot de Goethe : « Avec Voltaire, c’est un monde qui finit. Avec Rousseau, c’est un monde qui commence. » La Révolution va les réunir, au Panthéon.
« Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables […] Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions. » 1167
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Du contrat social (1762)
En note, il ajoute : « Je tiens pour impossible que les grandes monarchies de l’Europe aient encore longtemps à durer. » La guerre de Sept Ans fut le révélateur d’une crise morale profonde, ayant épuisé tous les pays, même l’Angleterre et la Prusse, gagnantes, mais à quel prix ! Les pertes militaires sont partout considérables et les populations civiles ont souffert, y compris du pillage, des famines.
Les philosophes des Lumières, prophètes des idées nouvelles sans être pour autant révolutionnaires, voient-ils venir la Révolution ?
La même année 1762, Rousseau publie L’Émile et La Profession de foi du vicaire savoyard. C’en est trop pour le Parlement, irrité surtout par ses idées religieuses : décrété de prise de corps, il passe en Suisse et l’homme traqué commence huit années d’errance, persécuté dans sa vie et dans sa tête malade.
« C’était un fou, votre Rousseau ; c’est lui qui nous a menés où nous sommes. » 1712
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), à Stanislas Girardin, lors d’une visite à Ermenonville, dans la chambre où mourut le philosophe, 28 août 1800. Œuvres du comte P. L. Roederer (1854)
Il n’y a sans doute pas une phrase du Contrat social « tolérable » pour Bonaparte Premier Consul, et moins encore Napoléon Empereur. Mais aucun philosophe des Lumières ne peut être pris pour maître à penser ou à gouverner d’un homme aussi autoritaire. Il l’a d’ailleurs écrit dans ses Maximes et pensées : « On ne fait rien d’un philosophe. »
Necker (1732-1804), banquier suisse, homme des Lumières et politique aux idées modérées, financièrement très généreux avec la France et populaire jusque sous la Révolution.
« La plupart des étrangers ont peine à se faire une juste idée de l’autorité qu’exerce en France l’opinion publique […] puissance invisible qui, sans trésors, sans gardes et sans armée, donne des lois à la ville, à la cour et jusque dans le palais des rois. » 990
Jacques NECKER (1732-1804), De l’administration des finances de la France (1784)
Ce grand banquier suisse, très populaire en France et ministre des Finances de la dernière chance sous Louis XVI, fait remonter très précisément à l’époque de la Régence la naissance de cette force nouvelle : l’opinion publique. Éclairée par les philosophes des Lumières selon les uns, manipulée par la « secte » philosophique selon les autres, elle va remettre en question les fondements de l’Ancien Régime et conduire logiquement, quoique sans le vouloir ni le savoir, à la Révolution.
« Cela ressemble à mes idées […] comme un moulin à vent ressemble à la lune. » 1227
TURGOT (1727-1781), prenant connaissance du projet de Necker, Lettre à Dupont de Nemours, février 1778. La Tactique financière de Calonne (1901), G. Susane
Necker, ministre en charge des Finances en fait sinon en titre, est salué comme un nouveau Colbert qui va moderniser l’économie de la France. Banquier suisse ayant prêté de l’argent à l’abbé Terray (surnommé Vide-gousset aux Finances en 1772), il espérait lui succéder en 1774, mais Turgot l’a évincé.
En fait, Necker emprunte des sommes considérables pour faire face, sans nouveaux impôts, aux dépenses militaires. Reprenant un projet de Turgot pour limiter le rôle des intendants, il tente une décentralisation qui multiplie les compromis – et mécontentera finalement tout le monde.
Les deux ministres sont l’un et l’autre honnêtes et compétents, mais Turgot, proche des physiocrates, prône une politique économique libérale. Il y a aussi opposition de caractère : le doctrinaire Turgot passe en force, quand Necker, philanthrope et diplomate, cherche la conciliation.
« Mais c’est du Necker tout pur que vous me donnez là ! » 1245
LOUIS XVI (1754-1793), lisant le mémoire de Calonne, d’ordinaire moins rigoureux dans sa gestion publique. Histoire de France (1874), Victor Duruy
Le roi s’étonne du changement de politique proposé par son ministre. Plus que « du Necker » , c’est du Turgot. Face à la crise économique et financière, le contrôleur général des Finances propose au roi un projet radical pour unifier l’administration des provinces et établir l’égalité fiscale. Mais jamais les Parlements n’accepteront de cautionner cette réforme remettant en cause tous les privilèges !
Contre Vergennes (qui fait office de Premier ministre depuis la mort de Maurepas et ménage les coteries de la cour), Calonne va convaincre le roi de convoquer une Assemblée des notables pour leur présenter son projet, au début de 1787. C’est le type même de la « fausse bonne idée » .
« Grand prince, votre bienfaisance
De nos maux peut tarir le cours.
Rendez vous aux cris de la France :
Rappelez Necker à votre cour. » 1257Ô toi qui sais de la finance (1788), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
25 août 1788, le roi se décide à rappeler Necker. La reine, qui a poussé à cette décision, tremble cependant. Elle ne sait plus que conseiller au roi. Elle aura plus tard ce mot terrible : « Je porte malheur à tous ceux que j’aime. »
« Voici enfin M. Necker roi de France ! » 1258
MIRABEAU (1749-1791), à la fin du mois d’août 1788. Necker (1938), Édouard Chapuisat
Lié au duc d’Orléans et partisan d’une monarchie constitutionnelle, il ironise au rappel de Necker qui devient ministre principal (ministre d’État) : c’est l’homme de la dernière chance pour cette monarchie.
Le banquier suisse prête 2 millions à l’État sur sa fortune personnelle, en trouve quelques autres, le temps de tenir jusqu’aux États généraux. Et convoque une seconde Assemblée des notables, pour novembre.
« Bienheureux Déficit, tu es devenu le Trésor de la Nation ! » 1260
Camille DESMOULINS (1760-1794), septembre 1788. Citation qui lui est attribuée, sans source, et sans doute apocryphe
Bon résumé de ce qu’il a écrit : « En France, le déficit aura rétabli la liberté. Tout le monde sera devenu citoyen, parce que tout le monde aura été contribuable. Ô bienheureux déficit ! ô mon cher Calonne ! » (La France libre).
Avocat, confrère et ami de Robespierre dont il partage les idées avancées, il ironise à son tour et se réjouit de prévoir le pire. Il n’a pas tort…
Necker s’imagine que les États généraux voteront de nouveaux impôts et de nouveaux emprunts pour rétablir la situation financière catastrophique de la monarchie, cause à la fois immédiate et profonde de la Révolution. Le roi, dit-on, ne calcule pas ses dépenses sur ses recettes, mais ses recettes sur ses dépenses. Les frais de la Maison royale ne sont cependant qu’un des postes dans les dépenses de l’administration, et peu de chose comparé au service de la dette publique (triplée pendant les quinze ans du règne de Louis XVI) et aux dépenses militaires : ces deux derniers postes atteignaient 74 % du budget en 1786, année de paix.
« Vous qui nous traitez de racaille,
Si poliment,
Comme nous vous payerez la taille
Très noblement.
Vive le sauveur de la France,
Necker, vivat !
D’où ce héros tient-il naissance ?
Du tiers état. » 1264Le Tiers État, chanson de janvier 1789. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La chanson célèbre le roi et son ministre qui a obtenu, non sans difficulté, que le tiers ait à lui seul autant de représentants que les deux autres ordres réunis.
Paris illumine à cette nouvelle – décision prise le 27 décembre 1788 en Conseil royal et connue le 1er janvier 1789. Le roi est baptisé « restaurateur de la liberté française » . Mais à la fin de l’année 1788 et dans les premiers mois de 1789, l’effervescence populaire est partout aggravée par de très mauvaises récoltes qui font monter le prix du pain, d’où des émeutes. Cependant qu’on procède à la rédaction des cahiers de doléances et à l’élection des députés.
« Votre Majesté perd l’homme du monde qui lui était le plus tendrement dévoué. » 1327
Jacques NECKER (1732-1804), Lettre à Louis XVI, 11 juillet 1789. Œuvres complètes de M. Necker (1820)
Le roi, par lettre, invite son directeur général des Finances à « sortir momentanément du royaume » . Exiler ce financier sage et honnête, l’un des hommes les plus populaires du royaume, est une erreur grave.
Le renvoi de Necker est connu le 12 juillet au matin. Le peuple s’amasse au Palais-Royal. Camille Desmoulins, sortant du café de Foy établi sous les galeries, saute sur une chaise, brandit son épée d’une main, un pistolet dans l’autre, et crie : « Aux armes ! » Il improvise son premier discours : « Necker est chassé ; c’est le tocsin d’une Saint-Barthélemy de patriotes. Ce soir même tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ de Mars pour nous égorger. Une ressource nous reste, c’est de courir aux armes ! » Des milliers de voix hurlent : « Aux armes ! » Les manifestations ne vont plus cesser dans les rues : la Révolution est en marche.
« Je retourne en France en victime de l’estime dont on m’honore […] Il me semble que je vais rentrer dans le gouffre. » 1335
Jacques NECKER (1732-1804). Manuscrits de M. Necker publiés par sa fille (1804), Jacques Necker, Mme de Staël
Rappelé par le roi le 16 juillet 1789, il va en effet accepter de reprendre un pouvoir impossible à assumer : situation économique et financière déplorable, contexte politique et social explosif. Cet homme honnête et sage en est douloureusement conscient.
« Une suite d’événements sans pareils ont fait de la France un monde nouveau. » 1731
Jacques NECKER (1732-1804), Dernières vues de politique et de finances (1802)
Retiré de la scène politique depuis 1790, installé en Suisse à Coppet, sur les bords du lac Léman, avec sa fille Mme de Staël, le septuagénaire, partisan de toujours du gouvernement anglais, revient sur son préjugé contre la Révolution à la française et ses effets.
Marie-Antoinette (1755-1793), destin de princesse et de femme qui passe du meilleur au pire et dépasse une jeune reine devenue trop tard digne de ce nom.
« Ne parlez point allemand, Monsieur ; à dater de ce jour, je n’entends plus d’autre langue que le français. » 1186
MARIE–ANTOINETTE d’Autriche (1755-1793), à M. d’Antigny, chef de la Cité (Strasbourg), 7 mai 1770. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Il lui adressait la bienvenue en allemand. On parle couramment le français dans toutes les cours d’Europe. C’est aussi la langue de la diplomatie. Mais Marie-Antoinette, à 14 ans, est sans doute l’une des princesses les moins couramment francophones, vue son éducation imparfaite à la cour d’Autriche.
La jeune « princesse accomplie » va à la rencontre de son fiancé le dauphin Louis (futur Louis XVI) et de toute la cour qui l’attend à Compiègne. Elle a déjà dû, selon l’étiquette de la cour, se dépouiller de tout ce qui pouvait la rattacher à son ancienne patrie, pour s’habiller à la mode française. Le mariage fut négocié par le ministre Choiseul et la mère de la mariée, également soucieux de réconcilier les Bourbons et les Habsbourg. Cette alliance géopolitique renforce la position de la France en Europe, en cas de guerre avec l’Angleterre ou la Prusse.
« Madame, vous avez là deux cent mille amoureux. » 1192
Duc de BRISSAC (1734-1792), gouverneur de Paris, à Marie-Antoinette, 8 juin 1773. Mémoires de Mme la comtesse du Barri (posthume, 1829), Jeanne Bécu du Barry
Le vieux courtisan lui montre la foule immense venue l’acclamer pour son entrée solennelle à Paris. La Dauphine de France découvre le peuple se pressant dans les jardins de Versailles pour l’entrevoir. Cet excès de popularité a retardé de trois ans son entrée dans la capitale – elle s’est mariée avec le Dauphin le 16 mai 1770, à Versailles.
Elle écrira à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche : « Je ne puis vous dire, ma chère maman, les transports de joie, d’affection, qu’on nous a témoignés. Avant de nous retirer, nous avons salué avec la main le peuple, ce qui a fait grand plaisir. Qu’on est heureux dans notre état de gagner l’amitié d’un peuple à si bon marché ! Il n’y a pourtant rien de si précieux. Je l’ai senti et je ne l’oublierai jamais. » Plus dure sera la chute – on ne peut lire ces mots sans se rappeler la fin de l’Histoire, sous la Révolution.
« Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ! » 1205
LOUIS XVI (1754-1793) et MARIE–ANTOINETTE (1755-1793), Versailles, 10 mai 1774. Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI (1823), Jeanne-Louis-Henriette Genet Campan
Louis XV est mort, les courtisans se ruent vers le nouveau roi. Le petit-fils du défunt roi, âgé de 20 ans, est tout de suite effrayé par le poids des responsabilités, plus qu’enivré par son nouveau pouvoir. Marie-Antoinette est d’un an sa cadette. Est-elle déjà consciente de ce qui attend la reine de France ?
« Belle, l’œil doit l’admirer,
Reine, l’Europe la révère,
Mais le Français doit l’adorer,
Elle est sa reine, elle est sa mère. » 1207Romance en l’honneur de Marie-Antoinette, chanson (1774). Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La jeune et jolie reine jouit d’une immense popularité depuis son arrivée en France il y a quatre ans et Versailles la salue en ce style précieux. C’est l’état de grâce, comme jamais avant et jamais après.
Certes, il y a des jalousies et déjà quelques soupçons contre l’« Autrichienne » à la cour. On aura plus tard la preuve qu’elle est manipulée par sa famille autrichienne, restant très attachée à sa mère Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche durant trente ans et forte personnalité.
Délaissée par son royal époux, peu soucieuse de l’étiquette à la cour et moins encore des finances de l’État, dépensière et futile, Marie-Antoinette va accumuler les erreurs. « Ma fille court à grands pas vers sa ruine » , confie sa mère à l’ambassadeur de France à Vienne, en 1775. Pour l’heure, et pour trois ans encore, le peuple adore sa reine. La suite sera d’autant plus brutale et en partie injuste.
« Plus scélérate qu’Agrippine
Dont les crimes sont inouïs,
Plus lubrique que Messaline,
Plus barbare que Médicis. » 1242Pamphlet contre la reine. Vers 1785. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
Dauphine jadis adorée, la reine est devenue terriblement impopulaire en dix ans, pour sa légèreté de mœurs, mais aussi pour ses intrigues et son ascendant sur un roi faible jusqu’à la soumission. La malencontreuse « affaire du Collier » va renforcer ce sentiment, même si elle n’est pour rien dans cette escroquerie.
La Révolution héritera certes de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, mais aussi des « basses Lumières » , masse de libelles et de pamphlets à scandale où le mauvais goût rivalise avec la violence verbale, inondant le marché clandestin du livre et sapant les fondements du régime. Après le Régent, les maîtresses de Louis XV et le clergé, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée : quelque 3 000 pamphlets la visant relèvent, selon la plupart des historiens, de l’assassinat politique.
« Une femme, la honte de l’humanité et de son sexe, la veuve Capet, doit enfin expier ses forfaits sur l’échafaud. » 1538
Jean-Nicolas BILLAUD–VARENNE (1756-1819), Convention, 3 octobre 1793. L’Agonie de Marie-Antoinette (1907), Gustave Gautherot
Un parmi d’autres conventionnels à réclamer la mise en jugement de la « Panthère autrichienne » . Marie-Antoinette, en prison depuis près d’un an, attendait son sort au Temple, avant son transfert à la Conciergerie, le 1er août 1793.
Le 3 octobre, au moment où la Convention vient de décréter que les Girondins seront traduits devant le Tribunal révolutionnaire, Billaud-Varenne parle en ces termes : « Il reste encore un décret à rendre : une femme, la honte de l’humanité et de son sexe, la veuve Capet, doit enfin expier ses forfaits sur l’échafaud. On publie qu’elle a été jugée secrètement et blanchie par le Tribunal révolutionnaire, comme si une femme qui a fait couler le sang de plusieurs milliers de Français pouvait être absoute par un jury français. Je demande que le Tribunal révolutionnaire prononce cette semaine sur son sort. » La Convention adopte cette proposition.
« Immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, elle est si perverse et si familière avec tous les crimes qu’oubliant sa qualité de mère, la veuve Capet n’a pas craint de se livrer à des indécences dont l’idée et le nom seul font frémir d’horreur. » 1541
FOUQUIER–TINVILLE (1746-1795), Acte d’accusation de Marie-Antoinette, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (1862), Émile Campardon
« Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, âgée de 37 ans, veuve du roi de France » , ayant ainsi décliné son identité, a répondu le 12 octobre à un interrogatoire (secret) portant sur des questions politiques et sur le rôle qu’elle a joué auprès du roi, au cours de divers événements, avant et après 1789. Elle nie pratiquement toute responsabilité.
Au procès, cette fois devant la foule, elle répond à nouveau et sa dignité impressionne. L’émotion est à son comble, quand Fouquier-Tinville aborde ce sujet intime des relations avec son fils. L’accusateur public ne fait d’ailleurs que reprendre les rumeurs qui ont moralement et politiquement assassiné la reine en quelque 3 000 pamphlets, à la fin de l’Ancien Régime. L’inceste (avec un enfant âgé alors de moins de 4 ans) fut l’une des plus monstrueuses.
« Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère : j’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » 1542
MARIE–ANTOINETTE (1755-1793), réplique à un juré s’étonnant de son silence au sujet de l’accusation d’inceste, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. La Femme française dans les temps modernes (1883), Clarisse Bader
La reine déchue n’est plus qu’une femme et une mère humiliée à qui l’on a enlevé son enfant devenu témoin à charge, évidemment manipulé. L’accusée retourne le peuple en sa faveur. Le président menace de faire évacuer la salle. La suite du procès est un simulacre de justice et l’issue ne fait aucun doute.
Au pied de la guillotine, les dernières paroles de Marie-Antoinette sont pour le bourreau Sanson qu’elle a heurté, dans un geste de recul : « Excusez-moi, Monsieur, je ne l’ai pas fait exprès. » Un mot de la fin sans doute authentique, mais trop anodin pour devenir citation.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Mme de Staël (1766-1817), fille de Necker et bête noire de Napoléon, coupable d’être la femme la plus intelligente et la plus libre de son temps.
« En France, on ne permet qu’aux événements de voter. » 1672
Mme de STAËL (1766-1817), Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et les principes qui doivent fonder la République en France (posthume, 1906)
C’est l’adage d’un homme d’esprit qu’elle rapporte pour le conjurer, dans cet ouvrage écrit en 1798 et dont le titre est tout un programme. Un an après, le coup d’État de Bonaparte va balayer la réforme constitutionnelle et l’équilibre des pouvoirs que la fille de Necker et l’élève des philosophes éclairés appelait de ses vœux !
« Une nation n’a de caractère que lorsqu’elle est libre. » 1697
Mme de STAËL (1766-1817), De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800)
Fille du banquier suisse Necker (ministre de Louis XVI), c’est l’une des rares voix qui s’élève pour oser dénoncer le pouvoir de plus en plus absolu du futur empereur. Épouse de l’ambassadeur de Suède en France (Erik Magnus de Staël-Holstein), Mme de Staël, fervente lectrice de Rousseau, fut d’abord favorable à la Révolution. Mais elle ne lui pardonne pas la mort du roi, moins encore celle de la reine et la Terreur. Après trois ans d’exil, elle revient à Paris pleine d’espoir et impressionnée par le nouveau héros, ce général Bonaparte qui va redonner vie à l’idéal révolutionnaire de 1789.
Le coup d’État du 18 Brumaire et la Constitution de l’an VIII lui ôtent toutes ses illusions.
Elle le dit, elle l’écrit, elle se fait détester par le grand homme par ailleurs misogyne, supportant mal l’intelligence et la libre expression d’une femme. D’où son nouvel exil – doré, en Suisse, à Coppet sur les bords du lac Léman, dans le château de famille, auprès de son père.
« Bonaparte, très en colère de l’impassibilité de Paris, a dit à ses courtisans réunis : « Que leur faut-il donc ? » Et personne ne s’est levé pour lui dire : « La liberté, citoyen consul, la liberté ! » » 1723
Mme de STAËL (1766-1817). Lettres inédites de Mme de Staël à Henri Meister (posthume, 1903)
C’est évidemment le genre de vérité que le « citoyen consul » et futur empereur ne saurait entendre. Mais l’opposition est discrète, la censure impériale y veille et l’opportunisme prudent est quasiment de règle, chez les auteurs qu’on n’appelle pas encore « intellectuels » .
« Voici le second pas fait vers la royauté. Je crains que cet homme ne soit comme les dieux d’Homère, qu’au troisième acte il n’atteigne l’Olympe. » 1729
Mme de STAËL (1766-1817), jugeant l’irrésistible ascension du Premier Consul. Bonaparte (1977), André Castelot
Opposante résolue, elle ironise quand le 15 août (anniversaire de Bonaparte né sous le signe astral du Lion) devient jour de fête nationale. Le prénom Napoléon s’inscrit déjà sur des pièces de monnaie. Le sénatus-consulte du 4 août 1802 (Constitution de l’an X) augmente encore les pouvoirs du Premier Consul à vie au détriment du législatif.
« L’arrivée de cette femme, comme celle d’un oiseau de mauvais augure, a toujours été le signal de quelque trouble. Mon intention n’est pas qu’elle reste en France. » 1738
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), au Grand Juge Régnier (ministre de la Justice). Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Il vient d’apprendre le retour de Mme de Staël près de Beaumont-sur-Oise, le 3 octobre 1803. Il lui donne cinq jours pour partir, sinon, il la fera reconduire à la frontière par la gendarmerie.
Les seuls grands talents seront des opposants au régime : Chateaubriand hostile à Napoléon après l’exécution du duc d’Enghien (1804), Mme de Staël, coupable d’être la femme la plus intelligente et la plus libre de son temps. Paradoxalement, le personnage de Napoléon Bonaparte inspirera des chefs-d’œuvre de la littérature française et mondiale.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Marie Walewska (1786-1817), la « femme polonaise de Napoléon » qui lui donne un espoir de liberté pour la Pologne en échange d’un fils.
« Je n’ai vu que vous, je n’ai admiré que vous, je ne désire que vous. Une réponse bien prompte pour calmer l’impatiente ardeur de… N. » 21
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre, janvier 1807. Napoléon (2019), André Castelot
Coup de foudre impérial devenu un véritable amour – le second après Joséphine. La naissance d’un fils prolongera cette aventure polonaise qui aurait pu devenir un fait historique.
Marie épousa à 17 ans le comte et chambellan Anastazy Walewski, noble polonais quasi septuagénaire. Aussi jolie que bien éduquée (au couvent Notre-Dame-de-l’Assomption à Varsovie), rêvant d’une Pologne libre, « elle nourrit une haine virile du Russe qui occupe la Mazovie où elle est née, à quelques lieues de Varsovie, mais aussi du Prussien et de l’Autrichien qui se sont partagé le reste du pays » (Guy Godlewski). À 20 ans, elle donne naissance à son premier fils, Antoni.
Talleyrand, ministre français des Relations extérieures, a organisé un bal à Varsovie pour l’ouverture du carnaval. La gazette de Varsovie fait état d’une contredanse avec l’épouse du chambellan – le Diable boiteux est très amateur de jolies femmes. À midi le lendemain, une voiture s’arrête devant l’hôtel des Walewski. Duroc, grand maréchal du palais, en descend avec un gigantesque bouquet de fleurs et une lettre fermée du sceau vert impérial.
Marie ne répond pas. L’Empereur réattaque : « Vous ai-je déplu, madame ? J’avais cependant le droit d’espérer le contraire. Me suis-je trompé ! Votre empressement s’est ralenti, tandis que le mien augmente. Vous m’ôtez le repos ! Oh ! donnez un peu de joie, de bonheur à un pauvre cœur tout prêt à vous adorer. Une réponse est-elle si difficile à obtenir ? Vous m’en devez deux. N. »
Même silence de la jeune femme. Son entourage lui assure qu’être la maîtresse de l’Empereur, ce n’est pas manquer à l’honneur… et ce serait utile pour le salut et la grandeur de la Pologne. Marie refuse ce compromis. Napoléon insiste une troisième fois. Son billet est plus tendre encore, plus long. Et il promet ce que tous les Polonais désirent.
« Il y a des moments où trop d’élévation pèse, et c’est ce que j’éprouve. Comment satisfaire le besoin d’un cœur épris qui voudrait s’élancer à vos pieds et qui se trouve arrêté par le poids de hautes considérations paralysant les plus vifs désirs ? Oh ! si vous vouliez !… Il n’y a que vous seule qui puissiez lever les obstacles qui nous séparent. Mon ami Duroc vous en facilitera les moyens. Oh ! venez ! venez ! Tous vos désirs seront remplis. Votre patrie me sera plus chère quand vous aurez pitié de mon pauvre cœur. « N. »
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre, janvier 1807. Napoléon (2019), André Castelot
Le chantage impérial est clair, mais il est normal que cet homme follement amoureux se serve de ses armes. Marie va céder, à son corps défendant. Elle a montré les lettres à son mari, il lui conseille de se rendre au rendez-vous, elle peut se croire vraiment prédestinée pour sauver sa patrie.
Elle arrive en larmes. Napoléon l’interroge sur sa famille, sur l’âge de son époux. Elle lui parle de la nécessité de rendre à la Pologne son indépendance. Il l’appelle « ma douce colombe » . Mais rien ne se passe, ce premier soir. Il ne la force pas. Elle promet de revenir. Faut-il qu’il soit épris pour être aussi patient, lui dont la réputation était de ne même pas enlever ses bottes pour satisfaire son désir… et de ne pas supporter les larmes de femme.
Marie reviendra le voir comme promis et devient finalement sa maîtresse. Elle lui donne sa tendresse, alors que la passion impériale s’exprime avec une touchante naïveté.
« Marie, ma douce Marie, ma première pensée est pour toi, mon premier désir est de te revoir. Tu reviendras, n’est-ce pas ? Tu me l’as promis. Sinon l’aigle volerait vers toi. Je te verrai à dîner… Daigne donc accepter ce bouquet : qu’il devienne un lien mystérieux qui établisse entre nous un rapport secret au milieu de la foule qui nous environne. Exposés aux regards de la multitude, nous pourrons nous entendre. Quand ma main pressera mon cœur, tu sauras qu’il est tout occupé de toi et, pour répondre, tu presseras le bouquet ! Aime-moi, ma gentille Marie, et que ta main ne quitte jamais ton bouquet. N. »
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre, janvier 1807. Napoléon (2019), André Castelot
La conversation s’engage entre elle et l’Empereur à l’aide de ce bouquet. Elle revient au palais. L’habitude prise, elle y revient chaque soir. Et l’homme pressé va changer de vie.
Loin de Varsovie, au château de Finckenstein, l›« idylle » printanière du couple (d’avril à juin) est un moment unique dans l’existence de Napoléon qui déploie ce qu’un historien appela une « énergie miraculeuse » . Les deux amants sont finalement très épris l’un de l’autre et l’empereur consacre du temps à ses amours, comme avec Joséphine de Beauharnais au temps du Consulat.
Dans cette nouvelle résidence, Marie mène une vie cloîtrée, enfermée dans un château morne où elle ne voit personne. L’Empereur paraît aux heures des repas, pris en tête à tête. Elle le passe le reste du temps, à lire, à broder, à voir la parade impériale à travers les persiennes.
Avec son doux caractère polonais, Marie ramène la conversation sur son idée fixe : la résurrection de la Pologne. Patiemment, Napoléon discute avec elle sans toutefois s’engager. Ses arguments sont toujours les mêmes : que les Polonais fassent preuve de cohésion, de maturité, qu’ils soutiennent militairement sa lutte contre l’Empire russe et ils seront récompensés selon leurs mérites.
Napoléon crée en 1807 le Duché de Varsovie – qui disparaîtra peu après la défaite de la campagne de Russie en 1812-1813. C’était un compromis pour ne pas déplaire au tsar, mais une réponse faible à l’attente des Polonais dont des milliers de soldats sont morts pour l’empereur.
« Venez à Vienne, je désire vous voir et vous donner de nouvelles preuves de la tendre amitié que j’ai pour vous. Vous ne pouvez douter du prix que je mets à tout ce qui vous regarde. Mille tendres baisers sur vos belles mains et un seul sur votre belle bouche. »
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre de 1809. Maîtresses et femmes d’influence ( 2021), Robert Schneider
13 mai 1809, Napoléon entre dans Vienne et s’installe à Schönbrunn. Après sa victoire définitive sur les troupes autrichiennes à Wagram le 6 juillet, il demande à la comtesse Marie Walewska, sa maîtresse qu’il n’a pas vue depuis seize mois, de venir le rejoindre.
Deux jours après, Marie quitte la Pologne pour faire une cure à Bad Gastein. En réalité, elle part rejoindre l’empereur. Il a retenu pour elle une agréable maison dans le vieux village de Modling, à quinze kilomètres de Schönbrunn. Le fidèle Duroc veille toujours sur leurs amours. Il s’est occupé de la location de la maison et, une fois Marie arrivée, il va secrètement la chercher tous les soirs dans une voiture fermée, sans armoiries, avec un seul domestique sans livrée. Il l’amène au palais par une porte dérobée et l’introduit chez l’empereur.
Elle le suivra ensuite à Paris où il lui achète un hôtel particulier au 48 rue de la Victoire. Et le 4 mai 1810, de retour en Pologne, elle accouchera d’un fils.
« Je suis né au château Walewice en Pologne. »
Alexandre WALEWSKY (1810-1868), La Vie passionnante du comte Walewsky (1953), Comte d’Ornano
Anastazy Walewski, 73 ans, pour éviter le ridicule ou par patriotisme polonais, reconnaît l’enfant, déclarant qu’il est issu de son mariage avec Maria née Łączyńska – 23 ans. On le retrouvera dans l’Histoire, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III.
Napoléon apprend la naissance de son fils au cours d’un voyage triomphal en Belgique avec Marie-Louise d’Autriche qu’il a épousée pour avoir l’enfant que Joséphine n’était plus en âge de lui donner. Fou de joie, il fait parvenir des dentelles de Bruxelles et 20 000 francs en or pour Alexandre.
Le 5 mai 1812, à Saint-Cloud, en présence de Marie, Napoléon signe un long document juridique garantissant l’avenir du jeune homme. La dotation consistait en 69 fermes dans le royaume de Naples pour un chiffre d’affaires de 170 000 francs, et le titre de comte.
Malgré les rumeurs, Marie garde une position confortable dans la haute société, polonaise comme française. Le 17 août 1812, son mariage avec le vieux comte est déclaré nul, grâce au témoignage de son frère affirmant que cette union lui avait été imposée. Il fallait surtout éviter que le mari couvert de dettes ne ruine sa femme. Marie revint à Paris au début de l’année suivante.
Quand Napoléon se retrouve en exil à l’Île d’Elbe, elle vient le voir (avec son fils) le 1er septembre 1814 – Caroline Bonaparte aura la même attention pour son frère. Comme elle, on la retrouve à ses côtés en 1815, pendant les Cent Jours. Après la seconde abdication et l’exil pour Sainte-Hélène, Marie se pensa dégagée de tout serment, pour épouser… un cousin de l’Empereur, Philippe-Antoine, général comte d’Ornano, ancien colonel des dragons de la Garde. Elle met au monde un troisième fils, le 9 juin 1817. Quelques mois après, elle meurt à Paris dans son hôtel de la rue de la Victoire.
« Toute la maison était plongée dans un vrai désespoir. Ma mère était l’une des femmes les plus remarquables qui eût existé. »
Alexandre WALEWSKY (1810-1868), La Vie passionnante du comte Walewsky (1953), comte d’Ornano
Elle avait 31 ans. Dans son testament, celle qui fut sept ans la maîtresse de Napoléon exprima le désir que son cœur reste en France et que son corps soit transporté en Pologne dans le caveau familial de Kiernozia. Conformément à ce vœu, une urne contenant son cœur repose aujourd’hui au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des d’Ornano, portant la simple inscription : « Maria Walewska, comtesse d’Ornano » – et le corps fut emmené en Pologne quatre mois plus tard.
« Une femme charmante, un ange ! C’est bien d’elle qu’on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure ! » Parole de Napoléon à Sainte-Hélène.
Marie-Louise (1791-1814), impératrice et seconde épouse soumise de Napoléon à qui elle donne le fils espéré, l’Aiglon, avant une seconde vie plus épanouie en « Bonne duchesse » de Parme.
« C’est un ventre que j’épouse. » 1846
NAPOLÉON Ier (1769-1821). Le Fils de l’empereur (1962), André Castelot
Napoléon confirme la référence à la « belle génisse » sacrifiée par l’Autriche et assume le rôle du Minotaure prédateur, sans y mettre les formes. Il manifeste tant de hâte qu’on parle d’un enlèvement, plus que d’un mariage. La cérémonie religieuse a lieu le 2 avril 1810. Marie-Louise a 18 ans, il vit une lune de miel de trois semaines qui le comble et sa seconde femme lui donnera un fils, le 20 mars 1811 : le roi de Rome.
C’est peu dire que la nouvelle impératrice est impopulaire dans son pays d’adoption ! À la cour, toutes les sœurs et belles-sœurs de Napoléon se refusent à porter la traîne de « l’Autrichienne » : même accueil et même surnom que pour Marie-Antoinette la dauphine et future reine. Mais la famille impériale n’aimait pas davantage Joséphine la coquette Créole, ex-impératrice répudiée pour cause de stérilité.
Marie-Louise tient surtout à sa tranquillité (mot récurrent dans ses lettres et trait de caractère constant) et semble ignorer ce qu’on dit d’elle dans tout Paris : les bonapartistes préfèrent Joséphine, les républicains la haïssent en sa qualité de nièce de la reine décapitée, les monarchistes ne peuvent accepter le semblant de légitimité que ce mariage donne à la famille !
Pendant quatre ans, elle joue dignement le rôle de première dame. Elle donne le fils attendu à Napoléon, père comblé, fou de joie ! Mais les épreuves à venir pour son époux et pour son pays d’adoption la France sont trop fortes pour cette jeune femme. Écrasée par le désespoir, elle se confie à Hortense de Beauharnais (fille de Joséphine et femme de Louis, frère de Napoléon) : « Je porte malchance partout où je vais. Tous ceux avec qui j’ai eu affaire ont été plus ou moins touchés, et depuis l’enfance je n’ai fait que passer ma vie à fuir. » On croirait entendre Marie-Antoinette sous la Révolution : « Je porte malheur à tous ceux que j’aime. »
Sa vie en France se termine en 1814, quand Napoléon part en exil à l’île d’Elbe. Elle a renoncé à le suivre. Les Cent-Jours seront un nouveau drame vécu de loin. Au second exil de Napoléon, elle écrit à son père.
« J’espère qu’on le traitera avec bonté et douceur, et je vous prie, très cher papa, d’y contribuer. » 1959
MARIE–LOUISE (1791-1847), Lettre à son père l’empereur d’Autriche, 15 août 1815. Revue historique, 28e année, volume LXXXII (1903)
La femme de l’empereur déchu ajoute : « C’est la seule prière que je puisse oser pour lui et la dernière fois que je m’intéresse à son sort, car je lui dois de la reconnaissance pour la tranquille indifférence dans laquelle il m’a laissée vivre, au lieu de me rendre malheureuse. » Ce sont vraiment des paroles de fille et d’épouse soumise, aspirant toujours à la tranquillité.
Les Alliés ont décidé d’accorder à Marie-Louise le duché de Parme, en Italie. Elle va vivre une seconde existence plus heureuse. L’entrée officielle a lieu le 18 avril 1816. Elle écrit à son père sur un tout autre ton…
« Les gens m’ont accueillie avec tant d’enthousiasme que j’ai eu les larmes aux yeux. »
MARIE–LOUISE (1791-1847), Marie-Louise – Le destin d’une Habsbourg de Paris à Parme (1997), Franz Herre
Marie-Louise s’installe avec son amant Neipperg à qui elle laisse le soin d’administrer ses territoires. Il le fait d’une main de fer, tandis que la duchesse s’attache à créer des hôpitaux, des monuments et des musées. Elle mérite et apprécie son nouveau surnom : « la Bonne duchesse » .
Avant de partir en Italie, Marie-Louise a dû laisser à Vienne son fils, devenu duc de Reichstadt à sa demande : il lui fallut renoncer à vivre avec son enfant, elle a cependant insisté pour qu’il puisse avoir ce titre et des terres pour être plus tard libre de choisir sa vie… Mais le roi de Rome meurt de la tuberculose à 21 ans, dans les bras de sa mère qui s’est précipitée à Vienne pour vivre les derniers instants du fils qu’elle aura peu connu, mais beaucoup pleuré.
Après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821, elle a pu épouser Neipperg le 8 août suivant. Le couple aura quatre enfants avant que Neipperg ne meure en 1829. Suite aux émeutes à Parme en 1831, Marie-Louise, réputée trop laxiste et naïve dans la gestion de ses sujets épousera en 1834 le comte Charles-René de Bombelles, chargé de reprendre l’administration par la puissance autrichienne qui domine ce territoire italien. Encore un destin de femme malmenée par l’Histoire qui n’épargne personne, en ces temps bouleversés.