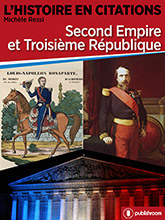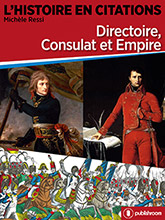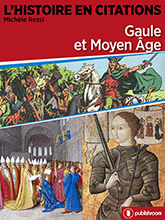Épisode 9 : les femmes historiques de la première moitié du XXe siècle
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
1. Marie Curie (1867-1934), Polonaise mariée à Pierre Curie, couple voué à la science, nobélisé et panthéonisé.

« La vie n’est facile pour aucun de nous. Mais il faut avoir de la persévérance, et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l’on est doué pour quelque chose, et que cette chose, il faut l’atteindre coûte que coûte. »
Marie CURIE (1867-1934) Madame Curie (1938), Ève Curie
D’apparence froide, allure austère, silhouette fantomatique, toujours en noir, elle n’a aucun souci de son apparence. Son monde reste celui des laboratoires, des chaudrons fumants et des fioles débordant de liquide incandescent. Les images que nous en avons semblent d’un autre âge.
Veuve à 39 ans, Marie Curie se retrouve seule à élever ses deux filles, Ève et Irène.
Irène Joliot-Curie recevra comme ses parents le prix Nobel de chimie en 1935 avec son époux Frédéric Joliot-Curie pour leurs travaux sur la radioactivité artificielle. Sous-secrétaire d’État à la recherche scientifique, c’est l’une des trois premières femmes faisant partie d’un gouvernement en 1936, sous le Front Populaire.
Ève Curie écrira une biographie mondialement connue de sa mère. Elle épousera le directeur de l’UNICEF Henry Labrousse, qui reçoit le Nobel de la paix attribué à cette organisation en 1965.
« Sans la curiosité de l’esprit, que serions-nous ? Telle est bien la beauté et la noblesse de la science : désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie sans idée préconçue des conséquences éventuelles. »
Marie CURIE (1867-1934) Madame Curie (1938), Ève Curie
Sa carrière culmine en 1911 : prix Nobel de chimie (doublé unique dans l’histoire, après son prix Nobel de physique partagé avec son époux et avec Henri Becquerel). Mais comme Pierre, elle n’a que faire de reconnaissance et elle affronte la rumeur : la « Veuve radieuse » est la maîtresse de son confrère Paul Langevin, en instance de divorce. La presse nationaliste dénonce le scandale et plusieurs duels à l’épée au vélodrome du Parc des Princes opposent les partisans et les détracteurs du couple.
Marie va désormais consacrer toute sa passion à la recherche. Quand la guerre éclate en 1914, elle se rapproche du Dr Béclère qui lui enseigne l’usage des rayons X à des fins diagnostiques. Elle décide de mettre ses connaissances au service de la santé - et de la France.
Sur le front, elle découvre l’horreur de la guerre : pénurie de denrées alimentaires et de médicaments, blessés évacués à même la paille dans des wagons à bestiaux avec une majorité de médecins qui ne savent pas opérer. Des milliers de soldats meurent faute de soins. D’autres sont amputés à cause d’erreurs de diagnostic.
Mi-août 1914, elle crée le premier service de radiologie mobile. Soutenue par de riches bienfaiteurs, elle récupère plus de 200 véhicules (les « petites Curie ») qu’elle équipe de dynamos, d’appareils à rayons X et de matériel photo. Elle sillonne les routes et longe les tranchées à la recherche de blessés. Ses postes de radiologie auraient sauvé un million de vies pendant la guerre ! À 17 ans, Irène rejoint Marie au front. Sa fille la seconde, en même temps qu’elle apprend sur le terrain.
« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
Marie CURIE (1867-1934) Madame Curie (Gallimard, 1938), Ève Curie
Et d’ajouter ce message qui vaut aujourd’hui encore : « C’est maintenant le moment de comprendre davantage, afin de craindre moins. La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. »
Marie Curie souffre d’une trop grande exposition aux éléments radioactifs qu’elle étudie depuis 1898, atteinte notamment au niveau des yeux et des oreilles. Au début des années 1920, très affaiblie, elle pense que le radium pourrait avoir une responsabilité dans ses problèmes de santé… Elle reste cependant à la direction de son Institut spécialisé dans la thérapeutique contre le cancer grâce aux radiations produites par le radium.
Atteinte d’une leucémie radio-induite ayant déclenché une anémie aplasique, elle part en juin 1934 au sanatorium de Sancellemoz (Haute-Savoie). Elle refuse tout acharnement thérapeutique qu’elle sait inutile et meurt le 4 juillet, à 66 ans. Sa fille Irène Joliot-Curie mourra en 1956 d’une leucémie aiguë liée à son exposition au polonium et aux rayons X.
20 avril 1995, sur décision du président Mitterrand, les cendres de Pierre et Marie Curie sont transférées du cimetière familial de Sceaux au Panthéon de Paris.
2. Alexandra David-Néel (1868-1969), une longue vie d’exploratrice en Asie et de pratique bouddhiste, en passant par la cité interdite de Lhassa.

« J’ai quitté ma famille à cinq ans parce que je voulais voir ce qu’il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà. Je me suis sauvée. Et puis quand j’ai été plus grande, je me suis sauvée davantage. Quand mes parents étaient en vacances à la mer à Ostende, je me suis sauvée pour aller en Angleterre. Après ça, je me suis sauvée à 18 ans, j’ai traversé le Saint-Gothard à pied. Pour voir ce qu’il y avait plus loin. »:
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969). Interview à la radio, ORTF, 1954
Née Louise David à Saint-Mandé (Val-de-Marne), elle est éduquée à la rude dans des pensionnats (calviniste puis catholique). Dès 15 ans, habituée aux jeûnes et à l’ascèse qu’elle s’inflige, cette fille d’un instituteur ami de Victor Hugo et d’Élisée Reclus (géographe anarchiste) fugue en Angleterre. Montagnarde précoce, sa prochaine fugue sera plus sportive, prouvant son exceptionnelle endurance physique. La tête et les jambes : ce sera vraiment la féministe capable de toutes les prouesses.
« À l’origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité ! Elle est une condition essentielle du progrès. »
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969), France Culture, Livres, 26 décembre 2017. London, David-Néel, St-Exupéry, Bouvier et Tesson : écrivains et voyageurs, par Alisonne Sinard
Fascinée par les philosophies orientales alors inconnue en France, la jeune femme se passionne pour l’Asie, sans savoir qu’elle y passera vingt-cinq années de sa vie ! Elle se lance dans des études d’orientaliste et se convertit au bouddhisme à 21 ans, allant apprendre le tibétain au Collège de France… et l’anglais en Angleterre – ça peut toujours servir quand on voyage. Elle fréquente aussi les sociétés secrètes et deviendra franc-maçonne comme son père. Sous son influence et pour aider financièrement sa famille, elle apprend le piano et le chant, commençant une belle carrière de chanteuse lyrique qui l’amène à voyager. C’est ainsi qu’elle découvre l’Asie en 1895, à 27 ans, devenant durant deux saisons première chanteuse à l’opéra d’Hanoï !
À 30 ans, elle publie un premier essai féministe, Pour la vie. En tournée lyrique à Tunis et malgré ses succès, elle abandonne le chant. Elle renonce à l’idée d’avoir un enfant pour se consacrer librement à ses travaux intellectuels, mais à 36 ans, elle finit par se marier avec son amant, Philippe Néel. Il sera son plus fidèle ami, son correspondant attentionné et son mécène pour les voyages à venir… et cette vocation irrésistible.
« Les chiens aboient, les chats miaulent, c’est leur nature, moi, je philosophe, c’est la mienne, cela est tout aussi spontané et involontaire et n’a pas plus d’importance. »
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969). Interview à la radio, ORTF, 1954
En 1911, elle publie son premier essai sur le bouddhisme et part seule en Inde pour un troisième voyage « de 18 mois » annonce-t-elle… En réalité, ce parcours initiatique va durer quatorze ans !
« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. »
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969) Le Lumineux destin d’Alexandra David-Néel (2019), Jean Chalon
Lors de son périple en Himalaya sur les traces de Bouddha, elle rencontre en 1912 le 13e Dalaï-Lama en même temps que d’autres bouddhistes, réfléchissant aux moyens de promouvoir le bouddhisme dans le monde. On connaît aujourd’hui l’importance de cette spiritualité…
Elle suit des enseignements ésotériques, se retire dans des ermitages à 5 000 mètres d’altitude et rencontre le jeune lama tibétain Aphur Yongden qui l’accompagnera désormais sa vie durant. De son maître yogi, elle reçoit le titre religieux de « Lampe de la sagesse » - titre d’un de ses essais à venir, lisible en Google book et bizarrement qualifié « livre d’auto-assistance », pour ne pas dire feel good. Qu’importe, si le message passe !
« Tout le bouddhisme est basé sur la possibilité de se libérer de la souffrance, de s’en libérer par soi-même et d’être seul capable de s’en libérer. »
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969), La Lampe de sagesse (1986)
En 1916, ignorant les interdictions des missionnaires, elle part pour le Tibet avec Yongden, visite temples et monastères, rencontre des religieux et consulte des écrits bouddhistes, avant d’être expulsée par les autorités coloniales britanniques. Alexandra et Yongden se rendent alors en Inde, au Japon, en Corée. Accompagnés d’un lama tibétain, ils traversent la Chine d’est en ouest pendant plusieurs années, avant de s’arrêter trois ans au monastère de Kumbum.
En 1924, déguisés elle en mendiante crasseuse (en fait, elle se lavait chaque soir et se noircissait de boue au matin) et lui en moine, ils franchissent clandestinement la frontière du Tibet et séjournent deux mois à Lhassa, la ville interdite, visitant les monastères environnants. Elle finit par être démasquée, mais quitte les lieux avant que le gouverneur de la ville intervienne. De retour en France l’année suivante, Alexandra découvre la notoriété que son aventure lui a valu et ça la fait bien rire…
« Sitôt que je suis revenue de Lhassa, on m’a décerné ce prix : 1er prix d’athlétisme féminin. Et j’ai cru qu’on se moquait de moi, j’ai été très fâchée. Et puis on m’a dit ‘mais pas du tout, on ne se moque pas.’ Parce qu’ils ont trouvé que faire ce voyage-là à pied, des milliers et des milliers de kilomètres dans des conditions pareilles, à travers des montagnes, c’était un exploit féminin. »
Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969), Interview à la radio, ORTF, 1968
De retour en Provence à Digne-les-Bains où elle a acheté une maison en 1928, elle fonde à 64 ans le premier ermitage lamaïste de France. Elle adopte légalement Yongden, écrit ses récits de voyage… et part donner des conférences un peu partout en Europe.
À 69 ans, en 1937, le Transsibérien la ramène en Chine pour étudier le tao : Alexandra et Yongden arrivent en pleine guerre sino-japonaise et découvrent ses conséquences, avec la famine, les épidémies. En 1941, apprenant la mort de son mari, profondément touchée, elle doit rentrer en France pour des questions de succession. Mais elle repart en Inde avant de rentrer en France à 78 ans, pour se remettre à écrire. En 1955, nouveau coup dur : la mort de Yongden.
À 100 ans, infatigable exploratrice quoique physiquement à la peine, elle demande le renouvellement de son passeport… avant de s’éteindre quelques mois plus tard. Ses cendres seront éparpillées dans le Gange avec celles de son fils adoptif.
3. Alice Guy (1873-1968), réalisatrice et productrice de films, pionnière injustement oubliée.

« Tournez, mesdames ! »/
Alice GUY (1873-1968), en 1914
Cette petite phrase et son étonnante carrière de cinéaste en font un modèle pour beaucoup de féministes et une figure tutélaire.
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe et tournent l’Arroseur arrosé, sorte de documentaire humoristique tourné en un plan. Moins d’un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. C’est une véritable fiction, jouée par des comédiens costumés, avec décor et mise en scène.
Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l’Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade.
Première femme à créer sa propre maison de production en 1910 (la Solax Film Co), elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune.
« Be Natural ! » (« Soyez naturels ! »)
Alice GUY (1873-1968), Inscription sur les panneaux de ses tournages
Elle tourne aussi bien des mélodrames que des westerns, elle s’intéresse aux problèmes ethniques. Lorsque ses acteurs blancs refusent d’apparaître à l’écran avec des acteurs noirs, elle réalise l’un des premiers films joués uniquement par des acteurs afro-américains.
Témoin de la naissance du monde moderne, elle aura côtoyé tous les pionniers de l’époque aujourd’hui célèbres : Louis et Auguste Lumière, Georges Méliès, Charlie Chaplin, Buster Keaton.
Mais son mari Herbert Blaché à qui elle a confié la gestion de l’entreprise lui fait tout perdre, parti à Hollywood avec une actrice… Divorcée, ruinée, avec deux enfants, elle rentre en France à 50 ans, écrit des contes pour enfants et donne des conférences, repart aux USA pour tenter de rassembler son œuvre…
Elle meurt décorée de la Légion d’honneur, mais sans avoir revu aucun de ses films - perdus et oubliés. En 2011, à New York, Martin Scorsese redonnera un coup de projecteur sur cette artiste exceptionnelle.
4. Colette (1873-1954), une vie accomplie de romancière, mime, comédienne, journaliste, bisexuelle assumée, parisienne amoureuse de la nature sous toutes ses formes, de la bonne chère, des chats, etc.

« La mort ne m’intéresse pas… La mienne non plus. »1
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1927)
Livre écrit à la mémoire de sa mère Sido, adorée ou détestée, mais omniprésente dans sa vie et son œuvre. Or, Colette n’ira pas à son enterrement – ce qui lui sera reproché. (Fait rarissime pour un écrivain, hormis Hugo et Paul Valéry, elle aura droit à des obsèques nationales – non religieuses, « ultime pied de nez à la France bourgeoise et catholique » (Le Monde).
Ce mot étonnant est l’une des clés de Madame Colette. Il l’oppose à la majorité des humains plus ou moins obsédés par l’idée de la mort – qui tient une grande place dans les œuvres de tant d’auteurs et artistes, sans parler des philosophes !
Il définit parfaitement le personnage de cette amoureuse de la Vie sous toutes ses formes – la nature, les animaux, les hommes (dont trois maris), les femmes (liaisons plus ou moins affichées et scandaleuses), le music-hall et le théâtre (pratiqué en scène et fréquenté en journaliste), la bonne chère dont elle a quelque peu abusé, les voyages plus ou moins rituels… et naturellement l’écriture au cœur de sa vie.
« C’est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis quarante-cinq ans qu’on commence à s’en apercevoir. »
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1928)
C’est d’abord une remarquable styliste. Elle apprit son métier avec la série des Claudine et Willy son premier mari. Mais l’élève dépassa bientôt le maître, avant de l’humilier.
« Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. »
COLETTE (1873-1954). La Retraite sentimentale (1907)
L’écriture musicale obéit à cette même règle et Colette aimait la musique au point d’écrire aussi une charmante « fantaisie lyrique » sur une partition de Ravel, l’Enfant et les sortilèges.
En littérature, elle épure son style et se démarque de ses grands contemporains (André Gide, Romain Rolland, Jean Giraudoux), mais c’est surtout le choix de ses sujets qui fait la différence. C’est évident dans ses Dialogues de bêtes (1904). Kiki la Doucette, angora tigré, ne peut parler comme Toby-Chien le bull bringé ! Dans tous ses romans où la description est soignée à l’extrême, chaque personnage a son style et ce qu’il dit sonne infiniment juste. Colette (femme de théâtre et scénariste) est aussi une excellente dialoguiste.
« Le monde m’est nouveau à mon réveil, chaque matin. »
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1927)
Roman-récit de la cinquantaine, écrit dans sa maison sur les hauteurs de Saint-Tropez. Certes, le réveil doit y être sublime en été. Mais de son village natal de Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne) au jardin du Palais-Royal qui fut son dernier spectacle à domicile (9 rue de Beaujolais, premier arrondissement, au cœur de Paris), en passant par tous les lieux visités, habités, vécus… elle n’a cessé de s’émerveiller. Et de nous enchanter par sa description de la nature, plus originale et personnelle que dans les romans de Sand comparable à divers titres – féminisme très particulier, bisexualité affichée, amour de la vie sous toutes ses formes, etc.
« L’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. »
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1928)
« Plus que sur toute autre manifestation vitale, je me suis penchée, toute mon existence, sur les éclosions. C’est là pour moi que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort qui n’est qu’une banale défaite… L’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin, et je ne cesserai d’éclore que pour cesser de vivre. »
« Il y a deux sortes d’amour : l’amour insatisfait, qui vous rend odieux, et l’amour satisfait, qui vous rend idiot. »
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1928)
Lucide, presque trop intelligente, Colette fera de l’amour entre hommes et/ou femmes le sujet majeur de son œuvre, fidèle reflet de sa vie. Entre drames et comédies, c’est évidemment une sensibilité très féminine qui s’exprime, sans tabou, avec provocations parfois et une infinité de nuances.
« Le vice, c’est le mal qu’on fait sans plaisir. »
COLETTE (1873-1954), Claudine en ménage (1902)
Elle fut à bonne école avec Willy… et à plus d’un titre, avec et sans jeu de mot ! Mais elle trouva naturellement son plaisir ailleurs et autrement.
« Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l’homme. Une femme intelligente y renonce. »
COLETTE (1873-1954). Chéri (1920)
Pas féministe au sens où on l’entend aujourd’hui… mais acharnée à obtenir et défendre son indépendance financière, même si « les femmes libres ne sont pas des femmes » (dans Claudine à Paris, œuvre de jeunesse revue et corrigée par son premier mari, Willy).
Elle se battra fort bien pour la défense de ses droits d’auteur (financiers et moraux), mais échouera comme femme d’affaires, avec une boutique de produits de beauté sombrant assez vite dans le ridicule.
« Le difficile, ce n’est pas de donner, c’est de ne pas tout donner. »
COLETTE (1873-1954). La Naissance du jour (1928)
Femme amoureuse, souvent passionnée… mais pas généreuse comme Sand – et mauvaise mère. Elle donnera quand même quelques bons conseils à sa fille…
« Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. »
COLETTE (1873-1954). Lettre à sa fille (1916-1953). Gallimard, 2003
La mère a suivi ce conseil, sa fille n’en a pas vraiment eu le temps ni le goût. Colette de Jouvenel (1913-1981) est née de son deuxième mariage avec Henri de Jouvenel, une passion qui s’est mal terminée, source de drames, de quelques scandales tout-parisiens et de romans-récits du meilleur cru.
Surnommée Bel-Gazou, cette fille qui ne fut pas vraiment désirée ne sera jamais très heureuse. Interviewée à la fin de sa vie, à la question « qu’est-ce que cela a représenté, pour vous, d’avoir une mère si célèbre ? » elle répondit simplement : « Il faut toute une vie pour s’en remettre. »
« Choisir, être choisi, aimer : tout de suite après viennent le souci, le péril de perdre, la crainte de semer le regret. »
COLETTE (1873-1954). Le Fanal bleu (1949)
Roman en fin de vie, voyage immobile de Paris à Genève en passant par Grasse, Saint-Tropez, le Maroc et les vignobles du Beaujolais. Souvenirs, scènes entre amis : Jean Cocteau son voisin de jardin, Jean Marais qui joua Chéri au théâtre, Marguerite Moreno amie intime… anecdotes et réflexions s’enchaînent sous le regard vigilant d’une femme-chatte blottie dans un intérieur feutré, sous la lumière du fanal bleu, souvent immobilisée par une arthrite de la hanche dans sa « solitude en hauteur » sur son « lit-radeau » (offert par la princesse de Polignac).
« Mon Dieu ! Que la vieillesse est donc un meuble inconfortable ! »
COLETTE (1873-1954), Correspondance, 5 décembre 1949
Elle ne se plaint jamais, elle se bat jusqu’au bout, veillée par sa fidèle gouvernante et son dernier mari, Maurice Goudeket, juif arrêté par la Gestapo en décembre 1941, libéré en février 1942, grâce à l’intervention du gouvernement de Vichy et aux démarches de Colette auprès de l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, Otto Abetz dont l’épouse française admire Colette.
« À fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir. Serait-ce par calcul que depuis un demi-siècle, je recherche sa compagnie ? »
COLETTE (1873-1954), Les Vrilles de la vigne (1908)
« … Je n’eus jamais à le chercher loin : il naît sous mes pas. Chat perdu, chat de ferme traqueur et traqué, maigri d’insomnie, chat de librairie embaumé d’encre, chats des crèmeries et des boucheries, bien nourris, mais transis, les plantes sur le carrelage ; chats poussifs de la petite bourgeoisie, enflés de mou ; heureux chats despotes qui régnez chez Claude Farrère, sur Paul Morand – et sur moi. » Bel exemple de style !
Le chat est omniprésent dans la vie et l’œuvre de Colette ! Surnommée « Minet-Chéri » par Sido sa mère, entourée de chats dans son village natal de Bourgogne, elle est souvent prise en photo avec des chats, dans la rue, au jardin, à sa table de travail. Vêtue d’un collant noir, elle incarne La Chatte amoureuse dans une pantomime au Ba-Ta-Clan (1912). Elle invite le chat dans Claudine à l’école, fait converser un Angora gris, Kiki-la-doucette et un bulldog, Toby-chien dans ses Dialogues de Bêtes. Elle vécut avec un chat sauvage venu du Tchad, Bâ-Tou, parfaitement apprivoisé, avant d’être obligée de la confier à un Zoo, éternel remords. On retrouve Saha, chatte de Colette, dans son roman La Chatte, passion de son maître Alain et follement jalousée par Camille sa compagne qui sera finalement perdante dans ce jeu inégal. Elle resta sans chat à la mort de Chatte Dernière, son Chartreux – sa race préférée. Mais il lui reste tous les chats du Palais-Royal : dernières photos bouleversantes de Madame Colette, assise comme une vieille clocharde sur le trottoir, caressant les gouttières qui courent entre les poubelles du Véfour, sa cantine de luxe, et sa dernière adresse, rue du Beaujolais.
« Le temps passé avec un chat n’est jamais perdu… Il n’y a pas de chat ordinaire. » (La Naissance du jour)
5. Cécile Sorel (1873-1966), reine des planches et du tout-Paris de la Belle Époque aux Années folles, passée de la Comédie-Française au music-hall et au couvent, après quelques ennuis à la Libération.

« Mes amours ? Je me suis éprise, je me suis méprise, je me suis reprise. »-
Cécile SOREL (1873-1966), Petite histoire des mots d’esprit célèbres, collectif (2014)
C’est une Sarah Bernhardt qui aurait mal tourné. Attirée très jeune par le théâtre, elle entre à l’Odéon puis à la Comédie française. Elle joue un peu comme elle, mais en moins bien, en exagérant ses gestes et son articulation.
Très appréciée du public, classée parmi les grandes coquettes et cocottes (à la ville comme à la scène), elle épouse finalement un mauvais comédien, arrière-petit-fils de la comtesse de Ségur.
Elle continue de fréquenter des artistes, dont Jean Rostand – mais il ne lui écrira pas de rôle sur mesure comme l’Aiglon pour Sarah - et des hommes politiques comme Barrès, Félix Faure, le plus célèbre étant Clemenceau, mais il ne fut pas son amant. Il lui fit seulement l’humour sans trop de méchanceté, brossant d’elle ce savoureux portrait : « Une sorte de travesti empanaché. À travers les plumes, j’ai fini par reconnaître l’autruche. Elle s’était surpassée, ce qui me paraissait impossible. Une robe pour le Carnaval de Rio ou le couronnement du roi Pausole. » Pas rancunière, elle lui enverra des chrysanthèmes et il lui répondra par ces mots : « Merci de vos admirables fleurs, par lesquelles il vous a plu d’humilier ma vieillesse. »
« L’ai-je bien descendu ? »
Cécile SOREL (1873-1966) au Casino de Paris, 1933. Petite histoire des mots d’esprit célèbres, collectif (2014)
C’est son mot le plus célèbre et il nous reste l’enregistrement – six syllabes en trois secondes chrono, sur le Net.
La grande coquette vient de quitter la Comédie-Française pour le music-hall. Le soir de la première de « Vive Paris », tout Paris attend au tournant la sexagénaire débutante. Les célèbres marches du vertigineux escalier Dorian ont brisé plus d’une carrière de danseuse légère.
Soulagée d’être parvenue au bas des marches couvertes d’or avec son casque à plumes, sa traîne de velours et un costume d’une quinzaine de kilos, elle balance le mot à Mistinguett, ancienne reine des lieux passée au Moulin Rouge et bien visible à l’avant-scène.
Elle ne fera pas vraiment carrière au cinéma, tournant seulement dans un film connu, les Perles de la Couronne (1937) de Sacha Guitry, un rôle pléonastique. Elle récidive dans un film à sketches de Raymond Leboursier, les Petits riens (1941). Ce n’est pas grand-chose, même si son personnage de La Clermont, c’est quand même elle, Cécile Sorel. Ajoutons la Tosca, mais en 1909, le cinématographe ne pouvait pas encore faire honneur aux stars – même pas Sarah Bernhardt.
Cécile Sorel aura quelques problèmes après la dernière guerre – tout le contraire de Sarah qui s’illustra à sa manière lors des deux précédentes.
Quand on lui reproche ses relations galantes avec les Allemands pendant la guerre :
« Mais, Messieurs, si vous ne vouliez pas que je les reçoive chez moi, il ne fallait pas les laisser passer. »2824Cécile SOREL (1873-1966), réponse aux membres du Comité d’épuration. Histoire juridique des interdits cinématographiques en France (2007), Albert Montagne
C’est ce qu’on appelle la collaboration horizontale. Hormis les noms de vedettes, combien de femmes seront tondues (crâne rasé) pour avoir simplement couché avec l’ennemi ! Le phénomène est à distinguer de la collaboration proprement dite : un cinquième des collaborateurs sont des femmes, 6 000 incarcérées à Fresnes, mêmes condamnations que pour les hommes : prison, travaux forcés, exceptionnellement peine de mort.
« Je remercie Dieu de m’avoir permis d’ensoleiller mon époque et de m’avoir donné une vie si magnifique »
Cécile SOREL (1873-1966)
Veuve d’après-guerre, sinon de guerre, elle est saisie d’une « conversion » aussi parfaitement datée que celles de Blaise Pascal ou Paul Claudel. 15 août 1950. À 77 ans, elle prononce ses vœux dans le tiers-ordre franciscain à la chapelle des Carmes de Bayonne. Elle prend le nom de sœur sainte Cécile de l’Enfant-Jésus. Son dernier rôle. Ses dernières années sont consacrées à l’écriture et à la foi. Hormis une émission télévisée consacrée à sa carrière en 1965, ce qui lui sera pardonné.
Elle meurt à 92 ans, après une fracture du col du fémur, à la villa Réjane de Trouville-sur-Mer, murmurant ces mots à un âgé de 5 ans qui a su les répéter. Un homme politique bien moins connu, Jean Rieu, qu’elle aura le mot de la fin : « Elle a vécu ce que vivent les roses, les roses en fer forgé ».
Et pourtant, ce fut une star en son temps, avec une cinquantaine de rôles à la Comédie Française et des photos qui rendent justice à sa beauté d’époque, quelque peu datée.
6. Isadora Duncan (1877-1927), femme et artiste en liberté qui révolutionne la danse (bien avant Béjart).

« Ma devise - sans limites. »2
Isadora DUNCAN (1877-1927), Ma vie (1928)
Au nom de quoi elle fait le projet de révolutionner la danse à tout point de vue : technique, spirituel, économique, sociétal. Son pouvoir est aussi grand que sa foi, mais sa force a naturellement des limites, le monde réel est têtu et la tragédie contrarie tôt ou tard tous les destins.
« Le corps du danseur est tout simplement la manifestation lumineuse de l’âme (…) Danser, c’est prier. »
Isadora DUNCAN (1877-1927)
Née à San Francisco, elle abandonne rapidement l’école trop contraignante pour sa nature essentiellement libre. Attirée par la danse et déjà pédagogue, elle donne des cours aux enfants du quartier pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses frères et sœurs plus âgés. À 17 ans, elle s’engage dans une compagnie théâtrale, avant de partir pour l’Europe, d’abord à Londres, puis à Paris, en 1900. Elle rencontre Loïe Fuller, américaine et pionnière de la danse moderne, bien connue pour ses danses tournoyantes, drapée dans des voiles avec des effets de lumière – véritable performance sportive et acrobatie épuisante dont elle seule sera capable. En deux ans, Isadora va devenir plus célèbre qu’elle, confortée dans cette voie totalement non académique, mais dans un esprit totalement différent !
« L’art n’est nullement nécessaire. Tout ce qu’il faut pour rendre ce monde plus habitable, c’est d’aimer, d’aimer comme Christ a aimé, comme aimait Bouddha. »
Isadora DUNCAN (1877-1927), Ma vie (1928)
Cette idéaliste née va quand même ouvrir trois écoles, naturellement pas comme les autres. Avec un point commun : il n’y aura que des filles. Sa conception de la danse ne convient absolument pas aux garçons : « amener une renaissance de la religion au moyen de la danse, pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain par l’expression de ses mouvements, et non pour distraire après-dîner des bourgeois gavés. » Elle détesta toujours les aspects commerciaux des performances publiques : les représentations( payantes), les tournées, les contrats et autres aspects pratiques de son métier, autant de distractions la détournant de sa double mission : la création de la beauté et l’éducation des jeunes.
Pieds nus, vêtue d’écharpes clinquantes et de tuniques grecques dont la transparence met en valeur son corps nu, elle crée un style primitif basé sur l’improvisation chorégraphique, opposée aux styles rigides de l’époque. Inspirée par la mythologie grecque, elle rejette les pas du ballet classique (et romantique) « laid et contre nature », avec ses règles strictes et ses codifications qui martyrisent les corps. À l’inverse, elle met en valeur l’improvisation, l’émotion et la forme humaine.
C’est toute une philosophie qui séduit dans divers pays. L’Allemagne sera la plus accueillante à sa première école, crée à Grunewald et donnant naissance au groupe le plus célèbre de ses élèves : les « Isadorables » prirent son nom et dansèrent avec elle, mais de façon tout à fait indépendante. Française, la deuxième école eut une brève existence avant la Première Guerre mondiale, dans un château situé en-dehors de Paris. Russe, la troisième école vient après la Révolution de 1917 qui installe une nouvelle République. Pour montrer son adhésion à l’expérience sociale et politique de la nouvelle Union soviétique, elle décide de s’installer à Moscou en 1922. Son personnage sortait totalement du cadre de plus en plus austère imposé par le régime des Soviets et elle fut bien accueillie par le milieu artistique – elle se maria d’ailleurs au poète Essénine. Mais l’incapacité du gouvernement russe à soutenir ses propositions extravagantes combiné aux conditions de vie difficiles du pays la poussèrent à retourner à l’Ouest en 1924.
« Chacune de mes histoires d’amour aurait pu faire un roman ; elles se terminèrent toutes mal. »
Isadora DUNCAN (1877-1927), Ma vie (1928)
Sa vie est ponctuée de tragédies. La plus terrible, c’est la perte de ses deux enfants, le 19 avril 1913. Deirdre et Patrick, noyés dans la Seine avec leur nourrice, prisonniers dans une voiture de retour d’une journée d’excursion. Folle de douleur, Isadora part en Italie et conçoit un enfant avec un aristocrate italien. Le 1er août 1914, elle accouche d’un fils qui ne vit que quelques heures : « Je crois qu’à ce moment-là, j’atteignis le sommet de la douleur humaine, car avec cette mort il me semblait que mes autres enfants mouraient encore une fois ; c’était comme la répétition de la première agonie, avec quelque chose qui s’y ajoutait encore » (Ma vie).
Autre drame, son mariage avec le poète révolutionnaire Sergueï Essénine, son cadet de dix-huit ans, rencontré en Russie et sitôt épousé en mai 1922. Relation tumultueuse avec ce génie alcoolique, suicidaire et dépressif, dureté des conditions de vie sous le régime des Soviets : Isadora repart, mais il la suit lors d’une nouvelle tournée en Europe. Essénine fait scandale dans tous les hôtels, détruit les meubles, enfonce portes et fenêtres. L’année suivante, il quitte Isadora et retourne à Moscou. Dépressif bientôt placé dans une institution spécialisée, il en sort et se suicide, fin décembre 1925, à 30 ans. Mais les circonstances de sa mort ne sont pas claires et le doute persiste entre meurtre et suicide.
Isadora Duncan meurt tragiquement le 14 septembre 1927 à Nice, étranglée par le long foulard qu’elle portait pris dans les rayons de la roue d’une Amilcar GS.
« Adieu, mes amis. Je vais à la gloire. »
Isadora DUNCAN (1877-1927), ses derniers mots
Elle avait 50 ans. Son nom marque à jamais l’histoire de la danse. Serge Lifar, danseur et chorégraphe ukrainien, naturalisé français, rendra hommage à la « danse nouvelle » incarnée par Isadora : « une prière et ses mouvements doivent diriger leurs ondes vers le ciel en communiquant au rythme éternel de l’univers. »
7. Marie Marvingt (1875-1963), « femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d’Arc » selon le quotidien américain Chicago Tribune, injustement oubliée dans l’histoire des sports.

Exception à la règle, cette brève chronique doit presque tout à une seule source, l’article très long et documenté de Wikipédia qui nous a fait découvrir le personnage.
« Savoir vouloir, c’est pouvoir. »
« Je décide de faire mieux encore et toujours. »;Marie MARVINGT (1875-1963)
Deux devises pour une seule femme… qui aura tout fait pour les suivre jusqu’aux limites du possible sans cesse repoussées, avec ses 34 médailles et décorations (record pour une Française).
Outre un physique et un mental hors norme, le contexte familial est une clé essentielle. Son père, receveur des postes, est passionné de sports. Il décide d’initier sa fille aux disciplines qu’il aurait voulu enseigner à ses fils, tous morts… sauf le dernier, de santé fragile (qui mourra à 19 ans).
Elle commence par la natation, apprenant à nager et à marcher au même âge. Fascinée par son premier spectacle de cirque, elle suit une formation de funambule, trapéziste, jongleuse et cavalière avec le cirque Rancy, devenant une gymnaste accomplie.
Elle s’initie au vélo et scandalise les Nancéens peu habitués à voir une femme à bicyclette. Son père, désormais retraité, s’implique totalement dans l’entraînement de sa fille. Premier exploit homologué à quinze ans : Nancy-Coblence en canoë par la Meurthe et la Moselle. En 1899, c’est l’une des premières titulaires du permis de conduire (avant les brevets de pilote avion, ballon, hydravion, hélicoptère). Elle participera plus tard à des courses automobiles dans le Sahara.
La tête marche avec les jambes : après sa licence de lettres, elle s’inscrit dans d’autres facultés, étudie la médecine et le droit, apprend cinq langues dont l’espéranto et obtient son diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge.
Elle dort quatre à cinq heures, refuse catégoriquement le mariage et la maternité, profitant de son « temps libre » pour écrire des poèmes, publiés sous le pseudonyme de Myriel.
En 1904, première course cycliste, Nancy-Bordeaux l’année suivante, Nancy-Milan puis Nancy-Toulouse en 1906. Les femmes n’étant pas autorisées à porter un pantalon et la jupe n’étant pas pratique, elle adopte la jupe-culotte. En 1908, elle pose sa candidature pour le Tour de France cycliste. Devant le refus des organisateurs, la Lorraine de 33 ans effectue le même parcours que les hommes en prenant le départ quelques minutes après eux… et termine la compétition, comme 36 des 114 compétiteurs hommes.
Nageuse, première Française à accomplir les 12 km de la traversée de Paris à la nage en juillet 1906, elle récidive en septembre 1907 et remporte la traversée de Toulouse en devançant ses plus proches poursuivantes de plus de trois minutes.
Elle s’illustre dans les sports de montagne : juillet 1905, première féminine de la traversée Charmoz-Grépon. L’exploit lui vaut d’être mentionnée comme l’une des pionnières de l’alpinisme français. Elle gravit la Dent du Géant, la Dent du Requin, le Mont Rose, la Jungfrau, les aiguilles Rouges et l’aiguille du Moine. Entre 1908 et 1910, elle remporte plus de vingt médailles d’or à Chamonix en ski, patinage artistique et patinage de vitesse, concours de saut et gymkhana sur glace. Le 26 janvier 1910, elle remporte la première compétition féminine de bobsleigh à Chamonix.
Décrite comme la « première sportswoman du monde », elle reçoit la grande médaille d’or de l’Académie des sports en 1910 : c’est la première et dernière fois que l’Académie distribue un prix « toutes disciplines ».
Une nouvelle passion lui fera bientôt abandonner toutes les autres disciplines, à l’exception des sports d’hiver. 1901, premier vol accompagné en ballon libre et brevet de pilote de ballon libre. Son premier vol en solo date du 19 juillet 1907. 26 octobre 1909, elle devient la première femme à piloter un ballon au-dessus de la mer du Nord et la Manche vers l’Angleterre. Sur l’Étoile filante, notre aéronaute française accumule les problèmes pour finir éjectée de la nacelle, mais elle déclare garder un bon souvenir de ce périlleux voyage. En octobre 1910, elle passe les épreuves du brevet de pilote aviateur à Mourmelon et devient officiellement titulaire du brevet de pilote - troisième femme au monde, mais première à avoir piloté seule un avion. Elle cumule 717 vols de mai à décembre 1912 sans la moindre casse. Mais l’année suivante, elle échappe de peu à la mort…
« Une fois de plus je reste la fiancée du danger, mais le mariage n’a pas été loin… »
Marie MARVINGT (1875-1963)
Dans l’édition du 15 avril 1913 de Lectures pour tous, Armand Rio la surnomme « la fiancée du danger ». Elle a décrit la situation, suite au crash : « Mon casque était complètement enfoncé dans la terre, mon visage baignait dans le sang. Écrasée sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu’avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d’aspirer un peu d’air… » Mais l’aviation reste sa passion.
Elle invente l’aviation sanitaire avec un prototype d’avion-ambulance pensé avec un ingénieur et qu’elle imposera non sans mal au début de Première Guerre mondiale, sous le signe de la Croix-Rouge. En Lorraine patriote, elle veut s’engager dans l’aviation, vu que l’armée russe accepte les femmes. Sans réponse à ses démarches, elle n’attend pas et participe à deux bombardements aériens au-dessus de la base aérienne de Metz, ce qui lui vaut la croix de guerre 1914-1918. Mais c’était pour remplacer un pilote blessé et au final, elle n’intègrera pas les corps aériens de l’armée… qui lui oppose un refus officiel !
Ses études en médecine lui permettent de devenir infirmière-major et d’assister un chirurgien réputé à Nancy. Après deux années passées à ses côtés, elle veut retourner sur le front. Elle se déguise en homme et intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied sous le nom de Beaulieu. On retrouve Marie en poilu(e) dans les tranchées, participant à des bombardements, mais aussi aide-soignante.
Quelques mois plus tard, après 47 jours cumulés en première ligne, son identité est démasquée, elle doit quitter le front. Mais le maréchal Foch l’autorise personnellement à rejoindre le 3e régiment des chasseurs alpins en tant qu’infirmière et correspondante de guerre aux Dolomites, sur le Front italien. Elle y évacue régulièrement les blessés à skis, renouant avec l’une de ses anciennes passions.
« L’aviation en général, l’aviation de tourisme et l’aviation sanitaire n’ont pas de meilleure propagandiste que l’aviatrice française — une des premières aviatrices du monde entier — Mlle Marie Marvingt. »
Frantz REICHEL (1871-1932), Le Figaro, 31 juillet 1930
Au cours de sa vie, elle aura prononcé plus de 3 000 conférences sur l’aviation sanitaire.
Dans les années 1920, elle a multiplié les conférences, de l’Afrique du Nord à l’Afrique du Sud en passant par Dakar, intervenant dans les écoles ou devant le grand public. En 1929, elle organise le premier Congrès international de l’aviation sanitaire. L’année suivante, elle se rend en Grèce à l’occasion des fêtes de Delphes et parcourt le pays, toujours en conférencière. Elle accompagne ses conférences de démonstrations de vol, ce qui n’est pas donné à tous les orateurs !
En prime, elle réalisera deux films documentaires : Les Ailes qui sauvent (1935) et Sauvés par la colombe (1949). Cette même année, elle devient officier de la Légion d’honneur.
« Alors Madame Marvingt, avez-vous aimé ce vol ?
— Je suis déçue. Nous n’avons pas fait bang ! »Marie MARVINGT (1875-1963)
20 février 1955, pour son 80e anniversaire, le gouvernement américain lui offre un vol au-dessus de Nancy à bord d’un chasseur supersonique. Elle est naturellement partante et impatiente : « Mais attendez, dit le pilote, il faut d’abord passer une visite médicale. _ Eh bien, allons-y. » Ils effectuent le vol au-dessus de Nancy et atterrissent. « Alors Madame Marvingt, avez-vous aimé ce vol ? _ Je suis déçue. Nous n’avons pas fait bang ! »
Elle continue de se lancer des défis. En 1959, elle passe son brevet de pilote d’hélicoptère et pilote l’année suivante le premier hélicoptère à réaction du monde, le Djinn. Au cours de sa vie, elle battra un total de 17 records en tant que pilote.
En 1961, forte de ses 86 printemps, elle n’hésite pas à enfourcher son vélo de Nancy à Paris où elle devait effectuer un vol en hélicoptère. Morte six ans avant de voir le premier Homme fouler la Lune, c’était l’un de ses ultimes rêves. Elle aurait tout fait pour aller dans l’espace, elle se serait même inscrite à un programme de voyage sur la Lune, assure sa biographe.
« Elle n’a jamais eu de limites. Elle a ouvert le ciel et le sport aux femmes. On en bénéficie toutes aujourd’hui. Mais c’était de manière inconsciente et involontaire. Elle ne le faisait pas spécialement pour les femmes, mais parce qu’elle le voulait. C’était peut-être la manière la plus intelligente de faire avancer les choses ».
Rosalie MAGGIO (1943-2021) Marie Marvingt - 1875-1963. La femme d’un siècle (1991)
Elle meurt le 14 décembre 1963 dans un hospice à Laxou, sans ressources et dans un relatif anonymat - Le Monde et deux journaux américains, The New York Times et Chicago Tribune, lui consacrent une rubrique nécrologique.
Peut-on expliquer si peu de reconnaissance ? Elle a fini très âgée et dans des circonstances banales, les records féminins étaient peu reconnus à son époque, elle n’a pas gagné beaucoup d’argent, n’étant payée que pour son travail de journaliste. Et elle n’a pas recherché la gloire plus que l’argent. Mais quand même !
8. Nelly Roussel (1878-1922), féministe extrême, antinataliste déclarée.

« Faisons donc la grève, camarades ! la grève des ventres. Plus d’enfants pour le Capitalisme, qui en fait de la chair à travail que l’on exploite, ou de la chair à plaisir que l’on souille ! »2637
Nelly ROUSSEL (1878-1922), La Voix des femmes, 6 mai 1920. Histoire du féminisme français, volume II (1978), Maïté Albistur, Daniel Amogathe
Rares sont les féministes de l’époque aussi extrêmes que cette journaliste marxiste, militante antinataliste, en cette « Journée des mères de familles nombreuses ». Le féminisme, revendiquant des droits pour une catégorie injustement traitée, se situe logiquement à gauche dans l’histoire. Mais, du seul fait de la guerre, la condition des femmes a bien changé.
« La femme est sacrifiée non seulement par Dieu et par la Nature mais aussi par la société républicaine elle-même. »
Nelly ROUSSEL (1878-1922), L’Éternelle sacrifiée (1906)
Dans cette conférence éditée, elle oppose à « l’éternel féminin » ce qu’elle nomme « l’éternelle sacrifiée ». Elle présente le mariage sans amour comme de la prostitution, milite pour supprimer les dispositions du Code civil qui font de la femme mariée une mineure au regard du droit et de la société, ainsi que pour l’obtention du droit de vote.
Elle est initiée en franc-maçonnerie à la Grande Loge symbolique écossaise. Proche du noyau fondateur de l’Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain », elle est affiliée à la loge no 48. Elle épouse le sculpteur Henri Godet, avec qui elle a trois enfants.
9. Gabrielle Chanel dite « Coco Chanel » ou Mademoiselle (1883-1971), créatrice de mode unique en son genre, artiste et femme d’affaires de génie, mais mythomane au caractère difficile.

« Je ne fais pas la mode. Je suis la mode. »
Coco CHANEL (1883-1971), Vogue France, 19 août 2021
Impossible de citer un artiste si génial soit-il osant affirmer : « Je suis le théâtre… la danse… la peinture… la littérature… » Il faudrait avoir un complexe de supériorité démesuré ou un besoin de reconnaissance infini. Mademoiselle avait peut-être les deux, mais elle a quand même beaucoup apporté à la mode pendant un demi-siècle.
Enfant naturelle issue de camelots et marchands forains des Cévennes, placée à 12 ans dans un orphelinat cistercien en Corrèze, autant dire abandonnée par son père (pourtant adoré et durablement fantasmé), elle y apprend à coudre et vit son adolescence dans un milieu austère qui lui inspirera sa mode minimaliste – mais rien n’est sûr dans sa biographie, hormis sa mythomanie avérée, avec la volonté de se créer un destin conforme à ses ambitions. Elle fuit le noviciat aussi bien que le mariage forcé, se réfugie chez une tante, se retrouve dans une pension de jeunes filles à Moulins, snobée par des filles de riches et promise à un destin de « cousette ». Pas question ! Elle sait déjà qu’« une fille doit être deux choses : classe et fabuleuse » pour exister. Elle sera donc les deux. Vive la Belle-Époque !
À 24 ans, elle rêve de faire du music-hall, attire les regards et gagne son surnom de « Coco » (référence à une de ses chansons), des relations bien placées (une constante dans sa vie) et un premier amour (unique ?) avec Arthur Capel, Anglais de son âge surnommé Boy, irrésistiblement riche et classe. Il lui offre en 1910 sa première boutique à Paris, 21 rue Cambon, dans le très chic premier arrondissement. Deux boutiques d’été à Deauville lui serviront aussi de vitrines de luxe, avant Biarritz, tout aussi classe.
« Le luxe, ce n’est pas le contraire de la pauvreté, c’est celui de la vulgarité. »
Coco CHANEL (1883-1971), Vogue France, 19 août 2021
Chanel vise le luxe, mais elle n’a pas (encore) le professionnalisme des grands couturiers de l’époque et elle s’en distingue par un style décalé, écolière en tenue sage noire et blanche ou garçonne portant polo, cardigan, jodhpurs et pantalons. Elle invente une allure bien à elle, conforme à sa silhouette longiligne qu’elle gardera toute sa vie et que les femmes voudront imiter, rêvant d’« être maigre comme Coco ».
En 1915, année de guerre et de restriction, la pénurie de tissu renforce cette tendance et elle s’impose fièrement comme « la reine du genre pauvre ». Manquant d’étoffe, elle taille des robes de sport à partir des maillots de garçons d’écurie en jersey et des tricots de corps pour les soldats. Elle achète à Rodier des pièces entières d’un jersey utilisé uniquement pour les sous-vêtements masculins et lance la marinière. Le blazer de son amant Boy Capel l’a également inspirée. Libérant le corps (après Paul Poiret qui supprima le corset en 1906), elle abandonne la taille et annonce cette « silhouette neuve » qui fera sa réputation.
C’est l’une des premières femmes aux cheveux courts à créer des vêtements simples et pratiques, s’inspirant d’une vie dynamique et sportive et jouant (déjà) avec les codes féminins/masculins.
Dès 1918, elle va édifier l’une des maisons de couture les plus importantes de l’époque, avec plus de 300 ouvrières. Elle rembourse son amant, refusant le statut de femme entretenue. La guerre terminée, Boy doit se marier, selon les règles de l’aristocratie anglaise et il épouse une femme de son monde : insupportable humiliation pour Mademoiselle Chanel. Mais elle accepte la situation et continue d’aimer Boy. La nuit du 22 décembre 1919, elle apprend qu’il s’est tué au volant de son automobile.
« En perdant Capel, je perdais tout. »
Coco CHANEL (1883-1971) cinquante ans après, citée dans Coco Chanel (2013), Élisabeth Weissman
La Première Guerre mondiale ne l’avait pas vraiment affectée, mais cette perte la bouleverse. Seul moyen de réagir pour ne pas sombrer dans la drogue et la dépression : céder à sa passion de la mode, travailler pour réussir, créer pour se renouveler tout en restant fidèle à son style.
Désormais lancée, rien ne pourra plus l’arrêter (hormis la Seconde Guerre, son collaborationnisme et son antisémitisme la rendant définitivement infréquentable… pendant dix ans).
En un demi-siècle de carrière, Mademoiselle s’arrangera pour rencontrer tous les artistes qui comptent et vont participer à son irrésistible ascension, de Picasso à Stravinsky, en passant par Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Salvador Dali, Cécile Sorel et Misia Sert, Serge Diaghilev (imprésario des Ballets russes qu’elle aide financièrement), le duc de Westminster, l’homme le plus riche d’Angleterre… Parmi eux, des amants, quelques maîtresses.
Signe particulier, elle emprunte souvent à ses amis masculins une particularité vestimentaire qui se retrouvera adoptée par toutes les femmes qui suivent la « mode Chanel ». À ce propos, elle multiplie les déclarations qui transcendent le temps et les modes. Elles valent citations, ne cessant de définir l’indéfinissable.
« La mode se démode, le style jamais. »
Coco CHANEL (1883-1971), Vogue France, 19 août 2021
Elle dit aussi : « La mode est architecture: c’est une question de proportions. »
« Il n’y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue. »
« La mode n’est pas quelque chose qui existe uniquement dans les vêtements. La mode est dans l’air, portée par le vent. On la devine. La mode est dans le ciel, dans la rue. »
Que reste-t-il de la mode Chanel et de sa maison, « symbole de l’élégance française » dans le monde ? Ses petits chapeaux de jeune modiste à ses débuts, ses bijoux en toc, ses sacs au sommet de sa carrière, la fameuse « petite robe noire » créée en 1926 (couleur jusqu’alors exclusivement réservée au deuil), les premiers pantalons pour femmes, les cardigans en maille jersey sur des jupes courtes, la jupe plissée courte, le tailleur orné de poches, les marinières…
Chanel est la première couturière à lancer ses propres parfums avec l’aide de son parfumeur Ernest Beaux : No 5 (1921), qui connaîtra une célébrité mondiale grâce à Marylin Monroe, mais aussi No 22 (1922), Gardénia (1925), Bois des Îles (1926) et Cuir de Russie (1926).
Après la guerre, le retour à Paris est difficile en 1954. Le « New Look » de Christian Dior fait fureur : taille de guêpe et seins « pigeonnants » obtenus par la pose d’un corset ou d’une guêpière sous des balconnets. Mademoiselle est effondrée, tout son travail de libération du corps de la femme semblant réduit à néant… et elle a 71 ans, sa nouvelle collection est mal accueillie, avec ses robes près du corps et sa silhouette androgyne. Avant le triomphe de son tailleur en tweed gansé, complété par une blouse de soie, des chaussures bicolores, un sac matelassé à chaîne dorée : le nouveau style Chanel va devenir un classique, souvent copié.
Les vêtements Chanel sont portés par les stars du moment, Romy Schneider à la ville, Jeanne Moreau dans Les Amants (1958) de Louis Malle, Delphine Seyrig dans L’Année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais. Et Jackie Kennedy portait un tailleur Chanel rose lors de l’assassinat de son mari John F. Kennedy.
En 1957, Chanel reçoit à Dallas un « Oscar de la mode ». Marilyn Monroe contribue à cette consécration en affirmant qu’elle ne porte, la nuit, que « quelques gouttes de No 5 ».
Elle distribue toujours ses conseils aux femmes et les mots ont valeur d’ordre, surtout dans sa bouche, avec son caractère tranchant et ses idées bien arrêtées.
« Pour être irremplaçable, il faut être différente. »
Coco CHANEL (1883-1971), Femme d’influence, 10 janvier 2016
Elle dit aussi : « Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque. »Et encore : « Ne sortez jamais de chez vous, même pour cinq minutes, sans que votre mise soit parfaite, bas tirés et tout. C’est peut-être le jour où vous allez rencontrer l’homme de votre vie. »
Mais les années 1960 voient naître d’autres modes, la minijupe déferle sur les podiums et dans la rue, popularisée par Mary Quant et André Courrèges.
Chanel ne relèvera jamais la jupe au-dessus du genou, assurant que les genoux sont laids. Elle ne touchera pas à son tailleur classique, restera insensible aux influences anglo-saxonnes véhiculées par la musique pop. Elle déteste la jeunesse en minijupe ou en blue-jean, elle critique le féminisme. Elle souffre de blessures intimes jamais cicatrisées, enfermée dans son rôle de « femme de fer ». Son immense fortune ne fera plus jamais son bonheur.
« Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. »
Coco CHANEL (1883-1971), Sur les pas de Gabrielle Chanel, Janette magazine, 19 août 2020
Elle finit richissime, mais très seule au Ritz où elle avait séjourné à sa Belle Époque. Elle y a ses appartements. Les défilés de haute couture se déroulent toujours dans les salons du 1er étage, 31 rue Cambon, où Chanel est spectatrice assise sur les marches de l’escalier menant à l’étage supérieur, observant les réactions de ses clientes par le biais des miroirs qui tapissent les parois.
Ses biographes saluent le génie de l’Artiste, mais se montrent sans indulgence pour l’égocentrisme et la dureté de la femme, sans pouvoir percer le mystère qui remonte sans doute à l’enfance vécue sans tendresse.
10. Louise Weiss (1893-1983), militante féministe et européenne, pratiquant le happening avant l’heure.

« Un rien m’agite, mais rien ne m’ébranle. »,
Louise WEISS (1893-1983), citée dans Louise Weiss (1999), Célia Bertin
S’est-on assez interrogé sur le mystère de ces mots souvent cités. La réponse est simple.
C’est la devise de son auteur, illustrée par le chêne. Cet arbre est particulièrement solide, autrement dit inébranlable, contrairement à la fable de La Fontaine l’opposant au roseau qui plie, mais ne rompt pas. Considéré comme le roi des arbres, le chêne symbolise la puissance et la pérennité : l’arbre le plus grand et le plus majestueux de nos forêts de l’hémisphère nord, sa croissance est lente. Mais son feuillage (aux superbes couleurs automnales) frémit au moindre souffle du vent.
« Les obsessions sont des fontaines de jouvence. Elles épouvantent la mort. »
Louise WEISS (1893-1983), Dernières voluptés (1979)
Louise Weiss est morte à 90 ans. C’est peu dire qu’elle s’est battue avec constance et fermeté pour les deux grandes causes qui ont donné un sens à sa vie. L’Europe (et la paix à maintenir), le féminisme (et les droits à conquérir).
Mais consciente de la difficulté à atteindre des résultats concrets au-delà des beaux discours, elle s’est toujours insurgée contre une certaine race de militants ou de témoins : « La tribu des il-n’y-a-qu’à est la plus redoutable. »
Après la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de jeunes de sa génération, Louise Weiss est marquée par les milliers de morts et l’ampleur des destructions.
Initiée aux nouvelles conditions géopolitiques de l’Europe par ses amis tchèques et slovaques (Bénès, Stefanik…), elle fonde en 1918, à 25 ans, une revue de politique internationale, l’Europe Nouvelle, qu’elle dirige entre 1920 et 1934. Les articles, rédigés par les plus grands noms politiques et universitaires, traitent des questions économiques, diplomatiques et littéraires.
En 1924, elle rencontre Aristide Briand à l’Assemblée générale de la Société des Nations (SDN) à Genève. Dans sa revue, elle soutient sa politique en faveur de la paix (rapprochement franco-allemand et désarmement) et défend ses idées sur la construction européenne (mémorandum sur l’Union fédérale européenne et projet d’Union européenne). Elle surnommera Briand « le Pèlerin de la Paix ».
« Certes, nos différends n’ont pas disparu, mais, désormais, c’est le juge qui dira le droit […] Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! »2654
Aristide BRIAND (1862-1932), ministre des Affaires étrangères, Discours du 10 septembre 1926. Histoire de l’Europe au XXe siècle : de 1918 à 1945 (1995), Jean Guiffan, Jean Ruhlmann
À l’inverse de Poincaré qui (avec le président Doumergue) incarne la fermeté face à l’Allemagne, Briand croit à la réconciliation, au désarmement, au droit international et à la Société des nations (SDN) garante de la paix. Après le pacte de Locarno d’octobre 1925 qui garantit les frontières fixées au traité de Versailles, le ministre des Affaires étrangères salue l’entrée de l’Allemagne au sein de la SDN.
« Moi, je dis que la France […] ne se diminue pas, ne se compromet pas, quand, libre de toutes visées impérialistes et ne servant que des idées de progrès et d’humanité, elle se dresse et dit à la face du monde : « Je vous déclare la Paix ! » »2655
Aristide BRIAND (1862-1932), Paroles de paix (1927)
Le 10 décembre 1926, le « Pèlerin de la Paix », surnommé aussi « l’Arrangeur » pour son aptitude à trouver à tout problème une solution de compromis, plus de vingt fois ministre (notamment aux Affaires étrangères), reçoit le prix Nobel de la paix – avec son homologue allemand, Gustav Stresemann. Mais Briand meurt en 1932. En pleine « entre-deux-guerres ».
En janvier 1934, dans un contexte international défavorable à son combat en faveur de la paix (avènement du nazisme en Allemagne), Louise Weiss démissionne de l’Europe nouvelle. En 1940, elle entre dans la Résistance sous le surnom de Valentine et participe à la rédaction du journal clandestin Nouvelle République. Après 1945, elle envisage de reprendre la publication de sa revue et entreprend des voyages sur les continents américain, africain et asiatique.
Mais un autre combat mobilise la militante : la condition féminine qui peine à progresser.
« Une brune aux yeux de braise entra un jour dans notre boutique [siège de l’association La Femme nouvelle] et s’offrit à nous aider… J’espère que mes références vous paraîtront suffisantes, nous dit-elle. J’ai tué mon mari. »
Louise WEISS (1893-1983), Combats pour les femmes, 1934-1939 (1980)
C’était assurément une militante du genre plutôt battante que parlante pour ne rien faire. Mais de telles femmes sont quand même rares, dans leur extrémisme.
« Les paysannes restaient bouche bée quand je leur parlais du vote. Les ouvrières riaient, les commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient horrifiées. »2665
Louise WEISS (1893-1983) Ce que femme veut (1946), évoquant une de ses conférences de 1934
En 1979, à l’âge de 86 ans, elle est élue aux premières élections européennes au suffrage universel direct du Parlement européen sur la liste gaulliste. Lors de la séance d’ouverture, qui a lieu le 17 juillet 1979, elle prononce en sa qualité de doyenne un discours où elle salue la mémoire des Européens qui l’ont précédée. Pour l’avenir, elle distingue trois problèmes essentiels : l’identité, la natalité et la légalité. Enfin elle lance un appel à l’unité dans cette même conférence de 1934.
« L’Europe ne retrouvera son rayonnement qu’en rallumant les phares de la conscience, de la vie et du droit »
Louise WEISS (1893-1983) Ce que femme veut (1946)
Rentrée dans le rang des députés de 1979 à 1983 (année de sa mort à 90 ans), elle est membre de la commission parlementaire Culture, Jeunesse et Sport. Elle imagine notamment la création d’une Université européenne, envisage l’échange généralisé de professeurs ou projette de créer à Strasbourg un Musée de l’idée européenne. Ainsi, beaucoup de réalisations de l’Union européenne ces dix dernières années portent sa trace.
11. Clara Haskill (1895-1960), pianiste virtuose mondialement reconnue à la carrière atypique.

« J’ai connu trois génies dans ma vie : Einstein, Churchill et Clara Haskil ».
Charlie CHAPLIN (1889-1977), lors de l’enterrement de Clara Haskil, 1960, film documentaire sur Clara Haskil, Pascal Cling, Prune Jaillet et Pierre-Olivier François
Récit d’une vie tourmentée, celui d’une personnalité complexe, considérée comme l’une des plus grandes pianistes du XXème siècle. Née en 1895 à Bucarest dans une famille juive, l’enfant prodige partit très tôt étudier à Vienne puis à Paris. Elle joua aux côtés des plus grands : Furtwängler, Ysaÿe, Fauré, Grumiaux, ou encore Lipatti. Mais secouée par la Première et la Seconde Guerre mondiale, une santé fragile, un entourage hésitant, elle peine à percer malgré de nombreux soutiens et des critiques dithyrambiques. Ce n’est qu’à son arrivée à Vevey, en Suisse, sauvée in extremis du nazisme, qu’elle pourra, tardivement, après-guerre, montrer toute l’étendue de son talent - jusqu’à sa mort tragique, en 1960, lors d’un accident à Bruxelles.
« Je ne savais pas qu’il y avait autant de musique dans ce que j’avais écrit ! »
Gabriel FAURÉ (1845-1924), cité dans Télérama, août 2017
Clara Haskil, pianiste roumaine et suisse décédée tragiquement en 1960, est toujours considérée comme une interprète profondément moderne. Son jeu simple, naturel, fluide et poétique lui a valu le qualificatif de génie de la part de Charlie Chaplin et l’admiration de ses pairs. Plusieurs témoins, intimement liés à son univers, dissèquent le toucher, tout en émotion contenue, de la pianiste virtuose.
Lorsqu’elle interprète Thème et variations, de Gabriel Fauré, celui-ci s’exclame : « Je ne savais pas qu’il y avait autant de musique dans ce que j’avais écrit.
« Clara Haskil a été envoyée sur terre pour jouer Mozart. »
Déclaration d’un critique viennois, parue quelques années auparavant dans un journal viennois : France Musique la nuit… L’heure bleue, 11 novembre 2014
Elle part ensuite en tournée aux États-Unis, limitée toutefois à Boston et à New York où elle donne quatre concerts avec Charles Munch et Paul Paray et reçoit des ovations debout. Là comme partout on reprend la formule parue quelques années auparavant dans un journal viennois : « Clara Haskil a été envoyée sur terre pour jouer Mozart ». Telle une comète, la pianiste illumine le ciel nord-américain mais ne reviendra plus : la santé fragile de l’artiste fait peur en effet aux impresarios américains.
12. La Mère Brazier (1895-1977), chef de file des « mères lyonnaises » en cuisine.

« J’ai appris la cuisine en faisant la cuisine. »
Eugénie BRAZIER (1895-1977)
C’est la plus connue des « mères » lyonnaises. À juste titre, par sa forte personnalité, sa réussite exceptionnelle, une notoriété qui transcende les modes et les générations, défiant un microcosme sexiste.. La « mère Brazier » est la première femme dont le nom s’impose depuis Taillevent - premier chef cuisinier professionnel français du XIVe siècle, auteur du Viandier (livre de recettes et de technique).
Première femme à obtenir trois étoiles au Guide Michelin en même temps que Marie Bourgeois, (suivie par Marguerite Bise en 1951 et Anne-Sophie Pic en 2007). La mère Brazier va même obtenir deux fois trois étoiles ( suivie par six noms très connus, dont Alain Ducasse, Marc Veyrat, Joël Robuchon)
Son histoire tient du conte de fées – genre Cendrillon. Née dans une famille de paysans bressans, placée à 10 ans (après la mort de sa mère) dans des fermes de la région où elle garde les vaches et les cochons, elle apprend les bases de la cuisine de Bresse. « Fille-mère » à 19 ans, chassée de la maison par son père et contrainte d’abandonner son bébé à une nourrice, débarquée à Lyon sans le sou, elle se retrouve nourrice (ironie du sort !) dans une famille bourgeoise. La cuisinière tombée malade, elle la remplace. À 20 ans, elle a trouvé sa vocation.
Embauchée à la fin de la Guerre mondiale chez la mère Fillioux, elle fait son apprentissage. Sa réputation naît à la Brasserie du Dragon et deux ans après, elle crée son restaurant, un bouchon lyonnais situé 12 rue Royale, nommé la Mère Brazier. Grâce au bouche-à-oreille et aux éloges du critique gastronomique Curnonsky, sa table devient la plus courue de Lyon. Un second restaurant suivra au col de la Luère, annexe du bouchon lyonnais les week-ends et au retour des beaux jours.
Un beau matin de 1946, un jeune commis arrive de Collonges, dans l’Ain, sur son vélo.
« Eh bien ! Tu n’es pas fainéant. Je t’embauche ! »
Eugénie BRAZIER (1895-1977). Chefs à la Carte, Thierry Marx et Bernard Thomasson
C’est Paul Bocuse. Ce futur grand chef cuisinier apprendra tout de la Mère Brazier, malgré la terreur qu’elle inspire parfois. À 20 ans, héros démobilisé de la Seconde Guerre mondiale, il poursuit son apprentissage chez « la Mère » au col de la Luère. Il entretient aussi le jardin potager, trait les vaches, fait la lessive et le repassage. Il fera ensuite la plus belle carrière dans ce métier-passion.
À 72 ans, la mère Brazier cèdera la place à son fils Gaston. Son restaurant de Lyon momentanément fermé renaît en 2007 sous le signe du chef Mathieu Viannay (« Meilleur Ouvrier de France »), retrouve ses étoiles et garde sa réputation. La Mère Brazier devient l’emblème de Lyon et de la cuisine lyonnaise au niveau international.
« Elle fait plus que moi pour la renommée de la ville. »
Édouard HERRIOT, maire de Lyon et président du Conseil, député, sénateur, ministre. Source : Ouest-France, le 23/10/2019
Des grands classiques qui ont fait la réputation de la Mère Brazier, Viannay son successeur n’en garde que quelques-uns, mais « réinventés au gré des saisons et de la fantaisie » : l’artichaut au foie gras réunit un artichaut poivrade, surmonté d’une bille de foie gras avec un émincé de fond d’artichaut accompagné d’une tranche de foie gras rôti parfumé de balsamique ; la célébrissime « volaille de Bresse Demi-Deuil » (du nom des lamelles de truffes glissées sous la peau) rajeunit grâce aux légumes de saison. Le secret de sa réussite est simple : tradition et innovation. Avec une « attention particulière aux cuissons, ajustées au degré près », aux « produits de saison » et aux « alliances », à l’image de ses coquilles Saint-Jacques au citron confit.
Une dizaine d’autres « mères lyonnaises » ont contribué au rayonnement de la ville, mais quelques centaines l’ont nourri et véritablement animée au sens étymologique : donner une âme.
« Qu’elles aient basculé dans le luxe, façon Brazier, ou soient restées fidèles à une cuisine plus économe, les mères avaient nourri la ville entière. On passait de l’une à l’autre comme on change de chemise, se régalant ici d’une tarte légère à la praline, là d’un saint-marcellin crémeux ou d’une salade de cochonnailles. Elles formaient à elles seules une famille méconnue, hétéroclite et laborieuse, dessinant une géographie sociale de la ville, déroulant un siècle d’histoire. Elles avaient façonné les quartiers, les avaient bercés, accompagnés. »
Catherine SIMON (née en 1956), Mangées : Une histoire des mères lyonnaises (2018)
Lyon leur doit beaucoup de sa réputation, quelques grands cuisiniers leur doivent d’être devenus des « chefs », les clients n’oublieront jamais cette époque, mais leur cuisine appartient à un passé révolu et elles n’ont pas vraiment fait école dans la carrière de femmes chefs… Contrairement à bien des chefs, les « mères » étaient des femmes discrètes qui ne faisaient pas parler d’elles. À l’exception de la mère Brazier, elles n’avaient aucun sens de la com’. Les journalistes les ont laissées dans l’ombre. Les universitaires, les romanciers ne se sont pas intéressés à elles, à leur vie. Eugénie Brazier, une self-made-woman étonnante, n’a pas été interviewée une seule fois par un journal, une radio ou une télé !
Dans une France encore très misogyne, ces femmes n’étaient pas des féministes, mais elles ont réalisé ce que très peu ont osé faire : être leurs propres patronnes, dans un domaine, la cuisine et la restauration, où les hommes dominaient et continuent à dominer.
D’origine campagnarde, souvent très modeste, ce sont des pionnières. Elles ont inventé les « tables d’hôtes ». Elles se sont révélées chefs d’entreprise à une époque où les femmes n’avaient pas le droit de disposer d’un carnet de chèques. Elles ont innové en cuisine, certaines posant les bases de ce qu’on appellera plus tard la « cuisine light ». Préférant s’approvisionner directement auprès des producteurs, elles ont tout naturellement créé le « circuit court ». Les femmes, Lyon et la gastronomie doivent beaucoup à ces « mères » audacieuses.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.