« J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. »
Charles BAUDELAIRE (1821-1867). Le Spleen de Paris (recueil posthume de poèmes en prose, 1869)
Les mystères ont défrayé la chronique en leur temps, nourris par la rumeur – bien avant la presse, les réseaux sociaux et toutes les « autoroutes de la désinformation » !
Petits et grands mystères alternent, souvent associés à des Affaires majuscules – des Templiers à l’Affaire Dreyfus. Tant de fois commentées, souvent fascinantes, elles sont un vivant reflet de leur époque, mais aussi de « l’âme humaine » qui ne varie guère.
Certains mystères sont aujourd’hui résolus – l’épidémie de peste noire, le Collier de la Reine, l’Affaire du Rainbow warrior. D’autres demeurent – l’assassinat d’Henri IV, l’énigme du Masque de fer et l’Affaire des poisons au siècle de Louis XIV, l’affaire du petit Grégory de nos jours.
Quelques personnages restent à jamais (et volontairement) mystérieux – du roi Philippe le Bel à François Mitterrand, en passant par le marquis de Sade… et de Gaulle : « La grandeur a besoin de mystère. On admire mal ce qu’on connaît bien. » Quant à Molière, objet des pires fake-news de son temps, sa vie comporte toujours certains mystères.
De nos jours, les « affaires » se multiplient, le journalisme d’investigation devient un genre prospère et les procès font la une des médias. Faut-il y voir un progrès dans la justice, la « transparence » et la démocratie, ou une dérive sociétale dangereuse ?
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
GAULE ET MOYEN ÂGE
1. Vercingétorix et César : leur duo-duel est le premier mystère de l’Histoire.
« Prends-les ! Je suis brave, mais tu es plus brave encore, et tu m’as vaincu. » 1
VERCINGÉTORIX (vers 82-46 av. J.-C.), jetant ses armes aux pieds de César, fin septembre 52 av. J.-C., à Alésia. Abrégé de l’histoire romaine depuis Romulus jusqu’à Auguste, Florus.
Ces mots du vaincu rapportés par le vainqueur servent d’épilogue à la brève épopée du guerrier gaulois, face au plus illustre des généraux romains.
Excellent stratège, César est parvenu à enfermer Vercingétorix et son armée à Alésia (en Bourgogne). L’armée de secours, mal préparée, est mise en pièces par le général romain qui exagère encore les chiffres : 246 000 morts chez les Gaulois, dont 8 000 cavaliers. Vercingétorix juge la résistance inutile et se rend pour épargner la vie de ses hommes – quelque 50 000, mourant de faim après quarante jours de siège.
La chute d’Alésia marque la fin de la guerre des Gaules et l’achèvement de la conquête romaine. Mais le mythe demeure bien vivant, en France : Vercingétorix, redécouvert par les historiens au XIXe siècle et popularisé jusque dans la bande dessinée d’Astérix, est notre premier héros national. Sa longue relation avec César est moins connue.
« (César) mari de toutes les femmes et femme de tous les maris. »
CURION l’Ancien (124-64 av. J.-C), homme d’État (consul, sénateur, gouverneur) et orateur romain, contemporain et adversaire de César. Cité par Suétone, Vie des douze Césars
Cette citation d’un ennemi rassemble les deux accusations d’adultère et d’homosexualité. Nous ne détaillerons pas la vie privée de César qui est extrêmement riche malgré des zones d’ombre, mais c’est l’occasion d’exprimer deux faits certains et un doute vraisemblable.
Première certitude : la bisexualité est pratique courante dans l’Antiquité, naturellement chez les Grecs, mais également chez les Romains – comme chez les Gaulois. Elle n’est nullement infâmante. Seul reproche fait à César, qui transparait dans cette citation : l’homosexualité passive. Autrement dit, il jouait le rôle de la femme avec un amant.
Seconde certitude : César eut trois ou quatre femmes légitimes (selon les sources), de très nombreuses maîtresses, la plus célèbre étant la belle Cléopâtre, reine d’Égypte… et d’innombrables enfants, reconnus et naturels.
Reste un doute sur ses relations avec Vercingétorix notre premier héros national, beau comme un jeune dieu et célèbre par la Guerre des Gaules de César. César l’a battu non sans peine à Alésia. Au lieu de l’exécuter, il l’emmène à Rome, le garde prisonnier durant cinq ans… pour l’exhiber lors de son triomphe romain, avant l’exécution finale – étranglé sur ordre du romain qui lui épargne ainsi des tortures humiliantes.
L’histoire se complique si l’on rappelle les relations avérées entre les deux hommes : comme beaucoup de fils d’aristocrates, Vercingétorix fut un proche de César, avant de prendre les armes contre lui. C’est même l’un de ses contubernales (« compagnon de tente » ). Selon deux historiens contemporains dignes de foi, Yann Le Bohec et Paul M. Martin, il était même officier de cavalerie de César qui l’appréciait, éprouvant de l’amitié pour le jeune homme et le formant aux méthodes de guerre romaines, en échange de sa coopération et de ses connaissances du pays et des pratiques de la Gaule chevelue. En fait, les deux hommes s’admiraient mutuellement. C’est ensuite que Vercingétorix trahit César, pour revendiquer par les armes l’indépendance du peuple gaulois.
De toute manière et quels que soient les détails de leur relation, cette rencontre reste un épisode fondateur et marquant de notre histoire de France.
La place de la religion chrétienne dans l’Histoire de France reste un mystère, voire un miracle.
« Et le Christ ?
— C’est un anarchiste qui a réussi. C’est le seul. » 11André MALRAUX (1901-1976), L’Espoir (1937)
Sous le règne de Tibère vit en Galilée un homme dont les enseignements vont bouleverser l’histoire du monde. De sa mort sur la croix va naître une religion qui lentement s’étendra sur l’Empire.
Pour les Romains, les premiers chrétiens ne sont qu’une secte juive, dont le fondateur passe pour un agitateur politique. Pour les chrétiens, il est Dieu, fils de Dieu, ce Dieu étant un dieu unique, comme celui qu’adorent les juifs.
La réussite de l’« anarchiste » qui termina sa vie comme un criminel mis en croix entre deux « larrons » est due à ses disciples, et plus particulièrement à Paul de Tarse : il fera du message de Jésus une religion à vocation universelle. La Gaule sera tardivement acquise : l’évangélisation des villes, puis des campagnes, date du ive siècle, le christianisme devenant religion d’État en 391.
La conversion de Clovis, premier roi des Francs, sera l’événement fondateur de l’Histoire à plus d’un titre.
« Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » 77
RÉMI (vers 437-vers 533), à Clovis, baptisé le 25 décembre 496. Histoire des Francs (première impression française au XVIe siècle), Grégoire de Tours
Clovis, comme promis lors de la bataille, va se faire chrétien après la victoire « miraculeuse » de Tolbiac – et 3 000 de ses hommes vont se convertir avec lui. Il est baptisé à Reims, comme tous les rois de France à sa suite. Après qu’il a déposé ses armes et sa cuirasse, Rémi, archevêque de Reims, apôtre des Francs et futur saint, procède à la cérémonie.
Le mot très souvent cité est peut-être apocryphe – Sicambre étant le nom donné à une ethnie des Francs. Il n’en exprime pas moins l’autorité religieuse sur le pouvoir royal, et ce rapport de force moral de l’évêque sur le roi. La religion va désormais marquer l’histoire de France.
« Tout lui réussissait, parce qu’il (Clovis) marchait le cœur droit devant Dieu. » 60
GRÉGOIRE de tours (538-594), Histoire des Francs (Historia Francorum)
Il parle en historien, mais juge aussi en évêque. La religion imprègne sa vie, de même qu’elle marque fortement toute cette époque. Et Clovis, roi converti, se montre assez ardent dans sa nouvelle religion pour que l’évêque de Tours parle ainsi de cet ancien barbare.
« Un roi, une foi, une loi. » 395
Guillaume POSTEL (1510-1581). Dictionnaire universel (1727), Antoine Furetière
À l’origine, l’adage était : « Une foi, une loi, un roi » : la loi divine passait avant les lois royales. Notre Moyen Âge a vécu sous le signe des croisades et des cathédrales, avec l’épopée tout à la fois réelle et symbolique de Jeanne d’Arc.
On a dit ensuite : « Un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême » . Cette formule qui a cours au Moyen Âge (venant sans doute de saint Paul dans l’épître aux Éphésiens) désigne le Seigneur Dieu.
Postel, professeur de grec, d’hébreu et d’arabe au Collège royal (futur Collège de France) créé sous la Renaissance par François Ier, substituera le seigneur royal au seigneur divin et la « loi » au « baptême » . Timide début de laïcisation, même si royauté et religion se fondent toujours l’une l’autre.
« Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. »
Pape Grégoire IX s’adressant à Louis IX, 21 octobre 1239, cité par Camille Pascal, Ainsi, Dieu choisit la France: La véritable histoire de la fille aînée de l’Église (2016)
Devant le futur Saint-Louis, le pape reconnaît à la France un rôle prédestiné depuis la conversion de Clovis.
La France restera « la fille ainée de l’Église » jusqu’en 1905, date officielle de la séparation des Églises et de l’État. Mais aujourd’hui encore, la religion chrétienne continue de marquer notre vie quotidienne avec ses fêtes toujours inscrites au calendrier, et respectées de façons plus ou moins profane : Épiphanie, Chandeleur, Annonciation, Carême, Les Rameaux, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Fête des morts, Avent, Noël.
Le pape Jean-Paul II, en voyage apostolique en France, popularisa la formule. Ayant évoqué ce « titre de fierté » , il demanda aux fidèles réunis : « France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle à ton baptême ? » Discours au Bourget en juin 1980.
An Mil, rumeur millénariste sur la fin du monde, entre mythe, légende et réalité… avant le « Bug de l’an 2000 » et le péril écologique à venir.
« C’était une croyance universelle au Moyen Âge, que le monde devait finir avec l’an mille de l’incarnation […] Cette fin d’un monde si triste était tout ensemble l’espoir et l’effroi du Moyen Âge. » 140
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de France, tome III (1837)
Cette croyance en une fin du monde pour l’an mille aurait fortement marqué les esprits de cette époque. Elle se fonde sur le « millénarisme » , doctrine selon laquelle le Jugement dernier devait avoir lieu mille ans après la naissance du Christ, d’après une interprétation du chapitre XX de l’Apocalypse de saint Jean (Nouveau Testament). Certes, la foi est grande au Moyen Âge, et les superstitions plus encore. Mais la majorité des contemporains, illettrés, ne sont pas sensibles aux dates.
Le témoignage d’un moine est doublement intéressant, pour confirmer tout à la fois que cette rumeur existe et qu’elle est sans fondement.
« On m’a appris que dans l’année 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous. Il n’y a qu’à ouvrir le texte sacré, la Bible, pour voir qu’on ne saura ni le jour ni l’heure. »
Abbon de FLEURY ( 945-1004) , Plaidoyer aux rois Hugues et Robert, v. 998
Ce moine bénédictin réformateur, érudit et écolâtre (directeur de l’école attachée à la cathédrale), élu abbé, sanctifié après sa mort, est reconnu comme l’un des grands théologiens du Haut Moyen Âge.
Il voit ce moment où « les esprits étaient frappés d’une terreur universelle » à l’approche de la fin du monde prévue pour l’an mille. Un moine historien connu, Raoûl le Glabre, fait partie des prophètes de malheur… De Fleury fut alors prié d’écrire un livre dénonçant les préjugés des « faux prophètes et la crédulité publique » . Plus généralement, sa science et sa sagesse universellement reconnues le firent respecter des grands et des savants.
Bien plus tard, les auteurs romantiques du XIXe siècle contribuerons à renforcer ce mythe de la « Grande Peur de l’an mille » , sur la foi de quelques textes douteux, mal interprétés, parfois postérieurs.
« La millième année après la Passion du Seigneur […] les pluies, les nuées s’apaisèrent, obéissant à la bonté et la miséricorde divines […] Toute la surface de la terre se couvrit d’une aimable verdeur et d’une abondance de fruits. » 141
RAOÛL le Glabre (985-avant 1050), Histoires
Ce moine historien décrit ainsi la fin des terreurs du tournant millénariste. Rien ne s’est passé, comme il en a toujours été pour ce genre de superstition.
Lui qui a craint le pire et contribué à la Grande Peur, il témoigne en termes poétiques d’un renouveau de civilisation : « Comme approchait la troisième année qui suivit l’an Mil, on vit dans presque toute la terre, mais surtout en Italie et en Gaule, rénover les basiliques des églises ; bien que la plupart, fort bien construites, n’en eussent nul besoin, une émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que celle des autres. C’était comme si le monde lui-même se fut secoué et, dépouillant sa vétusté, ait revêtu de toutes parts une blanche robe d’église. » Georges Duby (1919-1996), grand médiéviste contemporain, appelle cela « le printemps du monde » .
« Le bug de l’an 2000. » 3356
Non-événement vedette, à la une des médias depuis des mois – et le jour venu, rien
Le serpent de mer ou le monstre du Loch Ness n’est ni plus ni moins virtuel !
Dans une société massivement informatisée, on craignait que le pire ne survienne au 1er janvier 2000 : la pagaille dans le ciel aéronautique et sur le réseau ferré, voire des accidents d’avions et de trains en série. Moins grave, ascenseurs en panne, ordinateurs bloqués, distributeurs de billets refusant de livrer les derniers francs papiers… Même pas.
Alors, on parle de la plus grosse arnaque de ce nouveau millénaire. En réalité, le bug, ou plutôt des milliards de bugs pouvaient survenir dans les logiciels manipulant des dates, et provoquer des dysfonctionnements après le 31 décembre 1999, avec la donnée « année » codée sur deux caractères (les deux derniers chiffres de l’année), pour gagner de la place. Ainsi, le 01/01/00 pouvait nous faire revenir au 1er janvier 1900 !
Bob Berner, co-inventeur de l’ASCII (American Standard Code for Information Interchange) avait prévenu la communauté internationale dès 1971 ! Cinq ans avant la date fatidique, Internet aidant, les entreprises de génie logiciel se sont mobilisées à l’échelle mondiale. Coût total des travaux de contrôle et de maintenance préventive estimé à 500 milliards de francs, pour la France !
Notons que le 1er janvier 2000 ne marque pas le début du troisième millénaire, fêté en France et dans le monde à cette date. Pour que s’achève la 2000e année, il faut attendre le 1er janvier 2001.
Quant à la « fin du monde » ou du moins de notre monde tel que nous le vivons sur terre, ce phénomène est sérieusement envisagé par les écologistes, conséquence de l’activité humaine. Rappelons ce cri d’alarme lancé au début du troisième millénaire et plus actuel que jamais aujourd’hui.
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. » 3377
Jacques CHIRAC (1932-2019), Sommet mondial de Johannesburg, Afrique du Sud, 2 septembre 2002
Plus de 100 chefs d’État (et quelque 60 000 participants) font le bilan du Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro en 1992, et du Protocole de Kyoto (Japon) en 1997, les États signataires s’engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone en tête (le fameux CO2). Centré sur le développement durable, le Sommet adopte un plan d’action écologiquement et généreusement ambitieux : lutte contre la paupérisation, contrôle de la globalisation, gestion des ressources naturelles, respect des droits de l’homme, etc.
« Au regard de l’histoire de la vie sur Terre, celle de l’humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par la faute de l’homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L’Homme, pointe avancée de l’évolution, peut-il devenir l’ennemi de la Vie ? Et c’est le risque qu’aujourd’hui nous courons par égoïsme ou par aveuglement. Il est apparu en Afrique voici plusieurs millions d’années. Fragile et désarmé, il a su, par son intelligence et ses capacités, essaimer sur la planète entière et lui imposer sa loi. Le moment est venu pour l’humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, dont chacune a droit d’être respectée, le moment est venu de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de respect et d’harmonie, et donc d’apprendre à maîtriser la puissance et les appétits de l’homme. » Discours du président français, (bien) écrit par Jean-Paul Deléage, physicien, géopoliticien, maître de conférences universitaire, militant et historien de l’écologie.
Philippe le Bel : le plus mystérieux personnage de l’Histoire reste une énigme.
« Nous qui voulons toujours raison garder. » 229
PHILIPPE IV le Bel (1268-1314), Lettre au roi d’Angleterre Édouard Ier, 1er septembre 1286. Histoire de la France (1947), André Maurois
Il écrit ces mots à 18 ans, son destinataire en a 47. L’un des premiers actes du jeune roi est de rendre à son « cousin » une partie des terres lui revenant (entre Quercy, Limousin et Saintonge), au terme d’un précédent traité non appliqué. Le roi d’Angleterre, par ailleurs duc de Guyenne, est vassal du roi de France pour toutes ses possessions dans le pays, d’où des relations complexes – il faut ménager la susceptibilité de l’un ou l’autre souverain ! Cette lettre fait suite à la visite d’Édouard Ier venu à Paris rendre hommage à son suzerain et à divers remous diplomatiques.
Le même précepte est repris par Philippe le Bel dans ses Enseignements aux dauphins. Et Richelieu dira plus tard : « La raison doit être la règle et conduite d’un État. » Reste, le proverbe débarrassé du « nous » royal, mais gardant l’inversion quelque peu vieille France : « Il faut toujours raison garder. »
Mais chez ce grand roi du Moyen Âge, cette modération prend des proportions démesurées, donc inquiétantes.
« Ce n’est ni un homme ni une bête, c’est une statue. » 230
Bernard SAISSET (vers 1232-vers 1311), parlant de Philippe le Bel. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
L’évêque de Pamiers est ami du pape Boniface VIII qui a créé cet évêché pour lui. Le portrait qu’il fait du roi, ennemi déclaré du pape, est fatalement partial. « Notre roi ressemble au duc, le plus beau des oiseaux, et qui ne vaut rien ; c’est le plus bel homme du monde, mais il ne sait que regarder les gens fixement sans parler. » (allusion faite au Grand-duc d’Europe, le plus grand rapace nocturne du monde).
Les adversaires de Philippe le Bel l’appelleront souvent « roi de fer » ou « roi de marbre » , il doit donc y avoir une part de vérité dans ce portrait. Donnons la parole à notre dernier historien médiéviste qui lui a consacré une longue et belle biographie.
« On ne compte plus les clichés, les légendes, les fausses énigmes dont Philippe le Bel continue à être l’objet ou le prétexte. Les énigmes vraies sont bien suffisantes. Car il en est à chaque détour de la recherche. Le roi en est une à lui seul, et la première de toutes. »
Jean FAVIER (1932-2014), Philippe le Bel (1978)
En multipliant les points d’interrogations, il le décrit personnellement comme : « Froid calculateur, timide, pauvre homme ballotté ? Son silence est-il habileté, refuge ou abdication ? Sa foi est-elle cause première ou prétexte ? Son amitié est-elle fidélité ou favoritisme ? »
Le biographe enchaîne aussitôt sur la série des autres mystères historiques du règne : « Le gouvernement est une deuxième énigme. Roi de fer et hommes de paille ? Prince sage et conseillers avisés ? Jeu subtil de la compétence et du pragmatisme. »
« Chacune de ces ‘affaires’ dont est faite l’histoire du règne est en soi une question : Pourquoi les Juifs ? Pourquoi le Temple ? Pourquoi la dévaluation ? »
Jean FAVIER (1932-2014), Philippe le Bel (1978)
« Même si l’on met de côté les images traditionnelles, quel drame que cette lutte du roi chrétien et du Souverain Pontife ! Quel drame que cet effondrement d’un ordre naguère respecté d’Orient en Occident ! Quel drame que cette fièvre qui s’empare du marché monétaire et qui fait connaître à la France, pour la première fois, dans le même temps, l’inflation galopante et l’instabilité des valeurs ! » Quel résumé du règne !! Quant à la suite…
Le 29 novembre 1314, Philippe IV le Bel meurt à Fontainebleau après une chute de cheval à 44 ans, laissant son royaume à son premier fils qui ne règnera que deux ans. Durant son règne et celui de ses trois fils, les malheurs se succèdent, comme l’affaire de la tour de Nesle où ses belles-filles sont accusées d’adultère. Ses fils meurent tous sans héritiers : c’est la fin de la dynastie des Capétiens qui laissera place à la dynastie des Valois en 1328.
Mais Philippe le Bel sera logiquement considéré comme le premier des « rois maudits » , en relation avec l’affaire du siècle.
L’affaire des Templiers : grand feuilleton médiéval basé sur la calomnie royale et mystère jamais résolu.
« Memento finis. »
« Songe à ta fin. » 246Devise des Templiers. Règle et statuts secrets des Templiers (1840), Charles Hippolyte Maillard de Chambure
On peut aussi la traduire par « Pense à ton but » .
Après sa lutte finalement victorieuse contre le Saint-Siège, puis sur les Flamands, la suppression de l’ordre des Chevaliers de la milice du Temple devient l’un des grands desseins du règne de Philippe le Bel.
Les Templiers, premier ordre militaire d’Occident, créé en 1119 pour la défense des pèlerins, reviennent de Terre sainte d’où les derniers descendants des croisés ont été chassés. Ils se replient sur leurs possessions européennes, disposant par ailleurs d’une force armée considérable pour l’époque (15 000 lances).
Philippe le Bel leur octroie de nouveaux privilèges et songe même à entrer dans l’ordre, mais sa candidature est refusée – selon d’autres sources, le refus concerne le fils du roi. Quoiqu’il en soit, la guerre est désormais déclarée entre le Roi et les Templiers.
« Chacun de vous fait profession de ne rien posséder en particulier, mais en commun vous voulez tout avoir. » 248
Cardinal Jacques de VITRI (vers 1170-1240), aux chevaliers du Temple. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Historien et prélat, contemporain de la quatrième croisade (1202-1204), Jacques de Vitri (ou Vitry) résume le paradoxe de l’ordre. Devenus les banquiers des pèlerins et des marchands, puis des rois et des papes, souvent usuriers, les Templiers ont amassé des richesses immenses. Ainsi, un tiers de Paris – tout le quartier du Temple qui a gardé ce nom – vit sous leur protection.
Leur fortune et leur puissance font des jaloux, leur arrogance est une injure aux pauvres… et leur sens du secret permet de tout imaginer.
« Boire comme un Templier. »
« Jurer comme un Templier. » 249Expressions populaires, au début du XIVe siècle. Le Livre des proverbes français, tome I (1842), Antoine-Jean-Victor Le Roux de Lincy
Dictons toujours cours, même si on en oublie l’origine.
Ils donnent une faible idée des vices, crimes et péchés que la rumeur publique prêtait aux chevaliers. « Le Temple avait pour les imaginations un attrait de mystère et de vague terreur. Les réceptions avaient lieu, dans les églises de l’ordre, la nuit et portes fermées. On disait que si le roi de France lui-même y eût pénétré, il n’en serait pas sorti » (Jules Michelet, Histoire de France).
La rumeur est entretenue par le chancelier Guillaume de Nogaret (1260-1313), juriste et conseiller du roi. Philippe le Bel a décidé d’éliminer cet « État dans l’État » – rappelons que les Templiers ne dépendent que de l’autorité du pape. Toujours à court d’argent, il veut aussi récupérer une part de leur fortune – le fameux « trésor » . L’opération secrète sera vite et bien menée.
« L’an 1307 le 22 septembre, le roi étant au monastère de Maubuisson, les sceaux furent confiés au seigneur Guillaume de Nogaret ; on traita ce jour-là de l’arrestation des Templiers. » 250
Registre du Trésor des Chartres. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
La répression est décidée : des plis scellés sont envoyés à l’adresse des baillis et sénéchaux des provinces. Chaque pli en contient un second également scellé, qui ne doit être ouvert que le 12 octobre. Ainsi le secret de l’opération contre les Templiers sera-t-il fort bien gardé, durant trois semaines.
13 octobre 1307. Les Templiers sont arrêtés dans l’enceinte du Temple à Paris, et pareillement saisis dans leurs châteaux en province. Ils n’opposent aucune résistance : l’effet de surprise est total, et la Règle des moines soldats leur interdit de lever l’épée contre un chrétien. Une douzaine a pu fuir ; les autres, environ 2 000, seront livrés à l’Inquisition.
« Cette engeance comparable aux bêtes privées de raison, que dis-je ? dépassant la brutalité des bêtes elles-mêmes […] commet les crimes les plus abominables […] Elle a abandonné son Créateur […] sacrifié aux démons. » 251
PHILIPPE IV le Bel (1268-1314), parlant des Templiers. Les Templiers (1963), Georges Bordonove
On voit jusqu’où peut aller la duplicité de Philippe le Bel pour justifier une action injustifiable sur le plan de la pure équité. L’affaire des Templiers va durer sept ans !
Sur demande du chancelier Nogaret, l’Inquisition mène les premiers interrogatoires. Cette juridiction ecclésiastique d’exception est compétente pour la répression des crimes d’hérésie et d’apostasie, les faits de sorcellerie et de magie. 138 Templiers comparaissent, sous l’accusation de mœurs obscènes, sodomie, hérésie, idolâtrie, pratique de messes noires.
« On n’entendait que cris, que gémissements de ceux qu’on travaillait, qu’on brisait, qu’on démembrait dans la torture. » 253
Abbé René Aubert de VERTOT (1655-1735), Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (posthume, 1742)
Cet abbé fut le témoin des pratiques de l’Inquisition. Élongation, dislocation, brûlures, brodequins, chevalet, tels sont les moyens utilisés contre les accusés, en octobre et novembre 1307. L’inquisiteur de France, Guillaume de Paris, confesseur du roi, veille aux interrogatoires. Trente-six Templiers meurent sous la torture.
Face aux bourreaux, les Templiers avouent en masse, tout ce qu’on veut. Même le grand maître Jacques de Molay, vraisemblablement pas torturé. Ce qui donnera naissance au premier « mystère des Templiers » : étaient-ils si innocents ?
Le pape Clément V, hésitant par nature, embarrassé par l’affaire et par ailleurs malade, s’était mollement et tardivement ému du destin des Templiers, leur redonnant quelque espoir en février 1308 : il suspend l’action des inquisiteurs et annule les procédures engagées par Philippe le Bel. Fureur du roi !
Le chancelier Nogaret manœuvre en coulisses. Le pape, français d’origine, se soumet finalement à la volonté royale et abandonne les Templiers à leur sort, demandant seulement qu’on y mette les formes, d’un point de vue juridique. Il y aura donc un nouveau procès et quelques bulles papales.
« Jamais je n’ai avoué les erreurs imputées à l’ordre, ni ne les avouerai. Tout cela est faux. » 255
Frère BERTRAND de SAINT–PAUL (fin XIIIe-début XIVe siècle), 7 février 1310. Histoire vivante de Paris (1969), Louis Saurel
Avec lui, 32 Templiers veulent à présent défendre l’ordre au second procès. Leur attitude a changé du tout au tout.
« J’avouerais que j’ai tué Dieu, si on me le demandait ! » 256
Frère AYMERI de VILLIERS–LE–DUC (fin XIIIe-début XIVe siècle), 13 mai 1310. Histoire vivante de Paris (1969), Louis Saurel
Les Templiers qui ont avoué en 1307 vont désormais se rétracter, au risque du bûcher. « J’ai reconnu quelques-unes de ces erreurs, je l’avoue, mais c’était sous l’effet des tourments. J’ai trop peur de la mort » , ajoute Aymeri.
« Vox clamantis. »
« La voix qui crie. » 257CLÉMENT V (vers 1264-1314), Bulle pontificale qui dissout l’ordre des Templiers, 3 avril 1312. Les Templiers (1963), Georges Bordonove
Acte juridique lu à l’ouverture de la deuxième session, au concile de Vienne : l’ordre a fini d’exister. L’expression « Vox clamantis (in deserto) » – soit « La voix qui crie (dans le désert) » – est la réponse de Jean-Baptiste aux envoyés des Juifs venus lui demander « Qui es-tu ? » (Bible, Nouveau Testament, Évangile de Jean, 1, 23).
Par la bulle Ad providam du 2 mai 1312, les biens des Templiers sont transmis aux Hospitaliers. Le roi, sous prétexte de dettes, en a déjà prélevé la plus forte part possible. Mais le fameux « trésor » demeure introuvable.
« Les corps sont au roi de France, mais les âmes sont à Dieu ! » 258
Cris des Templiers brûlés vifs dans l’îlot aux Juifs, 19 mars 1314. Les Templiers (2004), Stéphane Ingrand
Cet îlot, à la pointe de l’île de la Cité, doit son nom aux nombreux Juifs qui ont subi le supplice du bûcher. Le peuple est friand de ce genre de spectacle et les Templiers attirent la foule des grands jours. Cette citation entre dans une catégorie peu fournie : « mot de la fin collectif » .
Ils sont une trentaine de Templiers à rejoindre dans le supplice les deux principaux dignitaires, Jacques de Molay, grand maître de l’Ordre, et Geoffroy de Charnay, le précepteur : après quatre ans de prison et de silence, ils ont proclamé leur innocence et dénoncé la calomnie, à la lecture publique de l’ultime sentence du 19 mars, sur le parvis de Notre-Dame, face à la foule amassée. Comme si le courage leur revenait soudain.
Après sept ans d’« affaire des Templiers » , le roi qui veut en finir au plus vite a ordonné l’exécution groupée des plus « suspects » , le soir même.
« Clément, juge inique et cruel bourreau, je t’ajourne à comparaître dans quarante jours devant le tribunal du souverain juge. » 259
Jacques de MOLAY (vers 1244-1314), sur le bûcher dans l’îlot aux Juifs, île de la Cité à Paris, 19 mars 1314. Histoire de l’Église de France : composée sur les documents originaux et authentiques, tome VI (1856), abbé Guettée
Dernières paroles attribuées au grand maître des Templiers. Ce « mot de la fin » est l’un des plus célèbres de l’histoire.
Quarante jours plus tard, le 20 avril, Clément V meurt d’étouffement, seul dans sa chambre à Avignon, comme aucun pape avant lui, ni après.
Autre version de la malédiction, tirée de la saga des Rois maudits de Maurice Druon et du feuilleton de télévision de Claude Barma, qui popularisa l’affaire des Templiers au XXe siècle : « Pape Clément ! Chevalier Guillaume ! Roi Philippe ! Avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment ! Maudits ! Maudits ! Tous maudits jusqu’à la treizième génération de vos races ! »
Guillaume de Nogaret est mort il y a un an, et il peut s’agir d’un autre Guillaume. Mais le pape va mourir dans le délai imparti, comme Philippe le Bel, suite à une chute de cheval à la chasse (blessure infectée, ou accident cérébral).
Plus troublant, le nombre de drames qui frapperont la descendance royale en quinze ans, au point d’ébranler la dynastie capétienne : assassinats, scandales, procès, morts subites, désastres militaires. Quant à la treizième génération… cela tombe sur Louis XVI, le roi de France guillotiné sous la Révolution. Mystère et Affaire n’ont jamais si bien rimé !
Pandémie de peste noire, dite la Grande Peste (1348) : source de superstitions, rumeurs mortifères, chasses aux juifs, aux sorcières, aux chats noirs…
« Le vulgaire, foule très pauvre, meurt d’une mort bien reçue, car pour lui vivre, c’est mourir. » 289
SIMON de Couvin (??-1367). Étude historique sur les épidémies de peste en Haute-Auvergne, XIVe-XVIIIe siècles (1902), Marcellin Boudet, Roger Grand
Aux malheurs de la guerre de Cent Ans s’ajoute une calamité plus terrible encore. Des vaisseaux génois venus de Crimée apportent la « Grande Peste » qui va se développer en Sicile, en octobre 1347. À la fin de l’année, le fléau se répand sur l’Italie du Nord et la Provence. Marseille est la première ville touchée en France.
En 1348, cette peste noire sévit sur une vaste partie de l’Europe. Les ravages de l’épidémie sont tels, selon le chroniqueur belge, que « le nombre des personnes ensevelies est plus grand même que le nombre des vivants ; les villes sont dépeuplées, mille maisons sont fermées à clé, mille ont leurs portes ouvertes et sont vides d’habitants et remplies de pourriture. »
Selon Jean Froissart qualifié de grand reporter du Moyen Âge et qui cette fois n’exagère pas, un homme sur trois mourut. Dans certaines régions de France, deux sur trois. Pour l’ensemble de l’Europe, les pertes atteignent entre le quart et la moitié de la population.
« Les hommes et les femmes qui restaient se marièrent à l’envi. » 290
Jean de VENETTE (vers 1307-vers 1370), La Peste de 1348, chronique
Chroniqueur français du XIVe siècle et supérieur de l’ordre du Carmel à Paris, ses Chroniques latines couvrent les années 1340 à 1368. Témoin important de la peste de 1348 en France, il décrit de manière précise les aspects de la maladie dont on ignore les causes – on incrimine alors les juifs, les sorcières, les chats noirs… D’où des massacres en série. Quant aux remèdes de la médecine, ils font plus de mal que de bien, en affaiblissant les corps (saignées, laxatifs). Mais l’épidémie, devenue pandémie, se termine en quelques mois.
La vie reprend ses droits, avec une vigueur nouvelle. Avant la peste, le curé de Givry (en Bourgogne) célébrait une quinzaine de mariages par an. En 1349, il en bénit 86, alors même que la peste a tué la moitié de ses ouailles.
La famine va succéder à la peste : « On vit des pères tuer leurs enfants, des enfants tuer leur père ; on vit des malheureux détacher les corps suspendus aux gibets, pour se procurer une exécrable nourriture. Des hameaux disparurent jusqu’au dernier homme. » Le peuple, déjà appauvri, meurt littéralement de faim.
La mort est à ce point présente que les églises s’ornent de danses macabres. La Mort symbolique (squelette armé d’une faux) entraîne tous les hommes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, innocents ou coupables. Au total, la guerre de Cent Ans fera beaucoup moins de victimes que ces deux années terribles !!
Peste noire et famine ont vidé le Trésor public. Les impôts ne rentrent plus : situation financière si grave que le roi doit abaisser la teneur en métal précieux des monnaies qu’il fait frapper. On va recourir au faux-monnayage à grande échelle, comme sous Philippe le Bel.
Le mystère de Jeanne d’Arc : une page d’histoire médiévale qui nourrit tous les fantasmes, les rumeurs et la légende à venir.
« Une enfant de douze ans, une toute jeune fille, confondant la voix du cœur et la voix du ciel, conçoit l’idée étrange, improbable, absurde si l’on veut, d’exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays. » 334
Jules MICHELET (1798-1874), Jeanne d’Arc (1853)
Le personnage inspire ses plus belles pages à l’historien du XIXe siècle : « Née sous les murs mêmes de l’église, bercée du son des cloches et nourrie de légendes, elle fut une légende elle-même, rapide et pure, de la naissance à la mort. »
D’autres historiens font de Jeanne une bâtarde de sang royal, peut-être la fille d’Isabeau de Bavière et de son beau-frère Louis d’Orléans, ce qui ferait d’elle la demi-sœur de Charles VII. C’est l’un des mystères de l’Histoire. Mais princesse ou bergère, c’est un personnage providentiel qui va galvaniser les énergies et rendre l’espoir à tout un peuple –à commencer par son roi.
« En nom Dieu, je ne crains pas les gens d’armes, car ma voie est ouverte ! Et s’il y en a sur ma route, Dieu Messire me fraiera la voix jusqu’au gentil Dauphin. Car c’est pour cela que je suis née. » 335
JEANNE d’ARC (1412-1431), quittant Vaucouleurs, fin février 1429. Études religieuses, historiques et littéraires (1866), Par des Pères de la Compagnie de Jésus
Elle répond à ceux qui s’effraient en pensant qu’elle va devoir traverser la France infestée d’Anglais et de Bourguignons.
À peine âgée de 17 ans, elle parvient à persuader le sire de Baudricourt, capitaine royal de Vaucouleurs, de lui donner une escorte. Et elle se met en route pour Chinon où se trouve le dauphin !
« Gentil Dauphin, j’ai nom Jeanne la Pucelle […] Mettez-moi en besogne et le pays sera bientôt soulagé. Vous recouvrerez votre royaume avec l’aide de Dieu et par mon labeur. » 337
JEANNE d’ARC (1412-1431), château de Chinon, 8 mars 1429. Jeanne d’Arc, la Pucelle (1988), marquis de la Franquerie
Le dauphin, qui croit d’abord à une farce, est caché parmi ses partisans, et le comte de Clermont placé près du trône. Au lieu de se diriger vers le comte, Jeanne va directement vers Charles et lui parle ainsi, à la stupeur des témoins. Leur entretien dure une heure, et restera secret, hormis la dernière phrase.
« Je vous dis, de la part de Messire [Dieu], que vous êtes vrai héritier de France et fils du roi. » 338
JEANNE d’ARC (1412-1431), 8 mars 1429. Jeanne d’Arc (1870), Frédéric Lock
Tels sont les derniers mots qu’elle prononce lors de l’entretien avec le dauphin, et dont elle fera état plus tard à son confesseur.
Jeanne a rendu doublement confiance à Charles : il est bien le roi légitime de France et le fils également légitime de son père, lui qu’on traite toujours de bâtard.
« Dieu premier servi. » 339
JEANNE d’ARC (1412-1431), devise. Jeanne d’Arc : le pouvoir et l’innocence (1988), Pierre Moinot
Ni l’Église, ni le roi, ni la France, ni rien ni personne d’autre ne passe avant Lui, « Messire Dieu » , le « roi du Ciel » , le « roi des Cieux » , obsessionnellement invoqué ou évoqué par Jeanne, aux moments les plus glorieux ou les plus sombres de sa vie.
Exemples au printemps 1429, durant la chevauchée fantastique de Jeanne et ses compagnons qui remonte la Loire pour entrer par le fleuve dans Orléans assiégée : « Roi d’Angleterre et vous, duc de Bedford, rendez à la Pucelle qui est ici envoyée par le roi du Ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France » … « Vous, hommes d’Angleterre, qui n’avez aucun droit en ce royaume, le roi des Cieux vous mande et ordonne par moi, Jehanne la Pucelle, que vous quittiez vos bastilles et retourniez en votre pays, ou sinon, je ferai de vous un tel hahu [dommage] qu’il y en aura éternelle mémoire. »
Le 4 mai, à la tête de l’armée de secours envoyée par le roi et commandée par le Bâtard d’Orléans (jeune capitaine séduit par sa vaillance et fils naturel de Louis d’Orléans, assassiné), Jeanne attaque la bastille Saint-Loup et l’emporte. Le 5 mai, fête de l’Ascension, on ne se bat pas, mais elle envoie par flèche cette nouvelle lettre.
Le 7 mai, elle attaque la bastille des Tournelles. Après une rude journée de combat, Orléans est enfin libérée. Le lendemain, les Anglais lèvent le siège. Et toute l’armée française, à genoux, assiste à une messe d’action de grâce.
Nouvelle victoire, à Patay : défaite des fameux archers anglais et revanche de la cavalerie française. Ensuite, Auxerre, Troyes, Chalons ouvrent la route de Reims aux Français qui ont repris confiance en leurs armes et se réapproprient leur terre de France.
« Gentil roi, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre saint sacre, en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. » 343
JEANNE d’ARC (1412-1431). Jeanne d’Arc (1860), Henri Wallon
Jeanne a tenu parole, Charles est sacré à Reims le 17 juillet 1429 par l’évêque Regnault de Chartres. Alors seulement, Charles VII peut porter son titre de roi. Plusieurs villes font allégeance : c’est « la moisson du sacre » . En riposte, le duc de Bedford fait couronner à Paris Henri VI de Lancastre « roi de France » .
Les victoires ont permis de reconquérir une part de la « France anglaise » , mais Jeanne, blessée, échoue devant Paris en septembre. Après la trêve hivernale (de rigueur à l’époque), elle décide de « bouter définitivement les Anglais hors de France » , contre l’avis du roi qui a signé une trêve avec les Bourguignons.
Le 23 mai 1430, capturée devant Compiègne, elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres et emprisonnée à Rouen le 14 décembre. Les Anglais veulent sa mort. Les juges français veulent y mettre les formes.
« Jeanne, croyez-vous être en état de grâce ?
— Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre ; si j’y suis, Dieu veuille m’y tenir. » 344JEANNE d’ARC (1412-1431), Rouen, procès de Jeanne d’Arc, 24 février 1431. Jeanne d’Arc (1888), Jules Michelet, Émile Bourgeois
Jeanne va subir une suite d’interrogatoires minutieux et répétitifs, en deux procès. Les minutes sont les sources originales et précieuses, mais la traduction du vieux français est plus ou moins fidèle et claire. D’où le recours à diverses sources, pour plus de clarté.
Son premier procès d’« inquisition en matière de foi » commence le 9 janvier 1431, sous la présidence de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais (diocèse où elle a été faite prisonnière). Ce n’est pas sa personne que l’Église veut détruire, c’est le symbole, déjà très populaire.
Qu’est-ce que l’Église lui reproche ? Le port de vêtements d’homme, sacrilège à l’époque, une tentative de suicide dans sa prison, et ses visions considérées comme une imposture ou un signe de sorcellerie.
Jeanne est seule, face à ses juges. Charles VII qui lui doit tant, et d’abord son sacre, l’a abandonnée. Il ne reste plus à Jeanne que sa foi, son Dieu. Elle va résister jusqu’au 24 mai.
[Question à l’accusée] « Dieu hait-il les Anglais ?
— De l’amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je n’en sais rien ; mais je sais bien qu’ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui y périront. » 345JEANNE d’ARC (1412-1431), Rouen, procès de Jeanne d’Arc, interrogatoire du 17 mars 1431. Dictionnaire de français Larousse, au mot « bouter »
Pour Pierre Cauchon, rallié à la couronne d’Angleterre comme un tiers de la France à cette époque, Jeanne est rebelle au pouvoir légitime, au terme du traité signé et ratifié par les deux pays en 1420.
Le procès se déroule selon les règles – de peur d’une annulation ultérieure. Mais la partialité est évidente dans la conduite des interrogatoires et dans la manière dont on abuse de l’ignorance de Jeanne, qui n’a pas 20 ans. Et la simplicité de ses réponses est admirable.
« Me racontait l’ange, la pitié qui était au royaume de France. » 346
JEANNE d’ARC (1412-1431), Rouen, procès de Jeanne d’Arc, 9e interrogatoire du 15 mars 1431. Dictionnaire de français Larousse, au mot « pitié »
Elle évoque longuement et à plusieurs reprises ses voix, et rapporte ce que lui disait saint Michel. L’extrême piété est ce qui frappe le plus, dans les témoignages relatifs aux premières années de Jeanne.
Le calme bon sens de la jeune fille l’emporte sur tous les pièges du frère qui l’interroge. Le théâtre et le cinéma ont repris, presque au mot à mot, ce dialogue littéralement inspiré – par sa foi en Dieu.
« Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » 348
Secrétaire du roi d’Angleterre, après l’exécution de Jeanne, Rouen, 30 mai 1431. Histoire de France, tome V (1841), Jules Michelet
Le mot est aussi attribué à l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon.
En fin de procès, le 24 mai, dans un moment de faiblesse, Jeanne abjure publiquement ses erreurs et accepte de faire pénitence : elle est condamnée au cachot. Mais elle se ressaisit et, en signe de fidélité envers ses voix et son Dieu, elle reprend ses habits d’homme le 27 mai. D’où le second procès, vite expédié : condamnée au bûcher comme hérétique et relapse (retombée dans l’hérésie), brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, ses cendres sont jetées dans la Seine. Il fallait éviter tout culte posthume de la Pucelle, autour des reliques.
Charles VII qui n’a rien tenté pour sauver Jeanne fit procéder à une enquête quand il reconquit Rouen sur les Anglais. Le 7 juillet 1456, on fit le procès du procès, d’où annulation, réhabilitation de sa mémoire. Jeanne ne sera béatifiée qu’en 1909 – et canonisée en 1920.
« Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie, chez nous, est née du cœur d’une femme, de sa tendresse, de ses larmes, du sang qu’elle a donné pour nous. » 349
Jules MICHELET (1798-1874), Jeanne d’Arc (1853)
Princesse (bâtarde de sang royal) ou simple bergère de Domrémy, petit village de la Lorraine, le mystère nourrit la légende et la fulgurance de cette épopée rend le sujet toujours fascinant, six siècles plus tard. La récupération politique est une forme d’exploitation du personnage, plus ou moins fidèle au modèle.
L’histoire de Jeanne inspirera aussi d’innombrables œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques, signées : Bernard Shaw, Anatole France, Charles Péguy, Méliès, Karl Dreyer, Otto Preminger, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luc Besson, Jacques Rivette, Jacques Audiberti, Arthur Honegger, etc. Et L’Alouette de Jean Anouilh : « Quand une fille dit deux mots de bon sens et qu’on l’écoute, c’est que Dieu est là. […] Dieu ne demande rien d’extraordinaire aux hommes. Seulement d’avoir confiance en cette petite part d’eux-mêmes qui est Lui. Seulement de prendre un peu de hauteur. Après Il se charge du reste. » Dieu est décidément la clé du Mystère (et de tous les mystères) de Jeanne d’Arc.
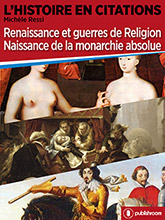 RENAISSANCE ET GUERRES DE RELIGION
RENAISSANCE ET GUERRES DE RELIGION
« Mal de Naples » ou « mal français » ? La rumeur court et le débat est de de bonne guerre, entre adversaires.
« Les Français ne se plaisent qu’au péché et aux actes vénériens. » 426
Jean BRAGADIN (seconde moitié du XVe siècle), fin février 1495. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Ce patricien fait son rapport devant la seigneurie de Venise et les griefs sont nombreux, contre les Français : « Ils prennent les femmes de force sans nulle considération, les volent ensuite et leur enlèvent leurs bagues ; et celles qui résistent, ils leur coupent les doigts. Il faut aussi pour eux que la table soit toujours ouverte, ils n’ôtent jamais leur manteau et restent couverts, prennent les meilleures chambres aux propriétaires, se jettent sur le vin et le blé. »
Michelet explique, avec le recul de l’historien : « Telle armée et tel roi, sensuel, emporté… La découverte de l’Italie avait tourné la tête aux nôtres ; ils n’étaient pas assez forts pour résister au charme. Le contraste était si fort avec la barbarie du Nord que les conquérants étaient éblouis, presque intimidés, de la nouveauté des objets. »
Rappelons que la France a vécu rien moins que 11 guerres d’Italie, de 1492 à 1559. Dès le début, ce pays tourna la tête aux jeunes conquérants : « La conduite des Français était contradictoire. Ils voulaient tout, arrachaient tout, emplois et fiefs, et, d’autre part, ils ne voulaient pas rester ; ils n’aspiraient qu’à retourner chez eux ; ils redemandaient la pluie, la boue du Nord sous le ciel de Naples » (Jules Michelet, Histoire de France).
« Partout, [le mal] éclate et comme la corruption des mœurs était générale, l’infection syphilitique se produisit presque partout simultanément. » 428
HESNAUT (pseudonyme d’un auteur inconnu qui rassemble des documents d’époque), Le Mal français à l’époque de l’expédition de Charles VIII en Italie (1886)
La syphilis – appelée « mal de Naples » par les Français, alors que les Italiens parlent du « mal français » – existait déjà dans notre pays, mais au mois d’octobre 1495, elle décime les rangs des soldats du roi Charles VIII de retour vers la France : partout ils agonisent, au milieu de la route, à l’entrée des villages.
Cette maladie, dite aussi la (grande) vérole, serait originaire d’Amérique, passée en Europe au retour des marins de Christophe Colomb et touchant d’abord l’Italie – d’où le premier nom de « mal de Naples » .
Maladie vénérienne extrêmement contagieuse, traitée par le mercure et le cyanure (hautement toxiques !), elle fera des ravages, jusqu’à la découverte des antibiotiques, vers 1940. Parmi les victimes célèbres, François Ier et Charles Quint, Shakespeare, Schubert, Baudelaire, Flaubert, Dostoïevski et Tolstoï, Édouard Manet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Verlaine, Feydeau, James Joyce, Lénine…
Les « mignons » d’Henri III n’étaient pas ce que l’on croit.
« Ce sont eux [les mignons] qui à la guerre ont été les premiers aux assauts, aux batailles et aux escarmouches, et s’il y avait deux coups à recevoir ou à donner, ils en voulaient avoir un pour eux, et mettaient la poussière ou la fange à ces vieux capitaines qui causaient [raillaient] tant. » 559
BRANTÔME (1540-1614). Lexique des œuvres de Brantôme (1880), Ludovic Lalanne
Homme de cour autant que de guerre, il défend ici, en témoin, la réputation des mignons du roi. Henri III les couvrit de biens et d’honneurs, ils furent en retour très fidèles au roi, et vaillants au combat.
Michelet confirme dans son Histoire de France : « Puisque ce mot de mignon est arrivé sous ma plume, je dois dire pourtant que je ne crois ni certain ni vraisemblable le sens que tous les partis, acharnés contre Henri III, s’acharnèrent à lui donner […] Plusieurs des prétendus mignons furent les premières épées de France. » Ainsi, le duc Anne de Joyeuse qui meurt à 26 ans, à la tête des ligueurs : la bataille de Coutras (20 octobre 1587) est une victoire pour Henri de Navarre.
Il faut quand même citer le plus illustre poète contemporain qui brocarde le roi et ses mignons…
« Le roi comme l’on dit, accole, baise et lèche
De ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour ;
Eux pour avoir argent, lui prêtent tour à tour
Leurs fessiers rebondis et endurent la brèche. »Pierre de RONSARD (1524-1585), « Henri III et la propagande de l’obscène » , article de David Laguardia, Réforme, Humanisme, Renaissance, Année 2009
Le roi des poètes se fait volontiers libertin et même érotique, à ses heures.
Cependant que la propagande des Ligueurs ultra-catholiques s’acharne à discréditer le roi « sodomite » avec ses « mignons de couchette » . Henri III finira assassiné par un moine ligueur, Jacques Clément, son successeur étant également victime d’un catholique fanatique – Henri IV ayant une solide réputation de Vert-Galant avec les femmes.
Reste le contexte, la mode italienne (à l’image de la reine mère, Catherine de Médicis) et les mœurs du temps qui peuvent prêter à confusion, si l’on se fie aux apparences restituées par les tableaux. Costumes raffinés à l’extrême, bijoux portés par des hommes prompts à sortir leurs pendentifs endiamantés aussi bien que leurs dagues, travestissement mettant en valeur une minceur efféminée. La complexité du personnage d’Henri III prête aussi à confusion.
Finalement, qu’importe sa liberté de mœurs et sa sexualité réelle ou supposée ! Seule certitude, ses Mignons surent se battre et mourir comme les plus vaillants guerriers du temps.
NAISSANCE DE LA MONARCHIE ABSOLUE
L’assassinat d’Henri IV : à qui profite le crime ? Mais « le bon roi Henri » entre dans la légende.
« Le personnage du Béarnais grandit en Majesté débonnaire et naturelle au fur et à mesure que s’étend le rôle qui lui est dévolu par l’Histoire. » 604
Emmanuel LE ROY LADURIE (1929-2023), L’État royal : de Louis XI à Henri IV, 1460-1610 (1987)
La personnalité d’Henri IV est forgée par les circonstances, à commencer par la situation très particulière et fort difficile dans laquelle ce « roi de droit et fort peu de fait » prendra possession du royaume. Il lui faut tout simplement le conquérir, ce qui lui demandera dix ans !
Indulgent et politique, généreux et sachant pardonner, mêlant l’humour à la bonhomie, mais autoritaire, versatile et capable des pires coups de tête, il a – dirait-on aujourd’hui – un évident charisme. Aisance personnelle déconcertante, panache militaire éclatant, prise directe sur les hommes, telles seront les clés de la réussite du nouveau roi.
Passionnément discuté de son vivant, adulé des Béarnais de Paris qu’il couvre de ses faveurs, il devient l’objet d’un véritable culte national après sa mort. L’assassinat par Ravaillac y contribue. Si la popularité se mesure au ton et au nombre des chansons, Henri IV est sans doute le premier de nos rois. Mais de son vivant, il fut aussi très attaqué, surtout par les catholiques.
« Tu fais le catholique
Mais c’est pour nous piper
Et comme un hypocrite
Tâche à nous attraper,
Puis, sous bonne mine,
Nous mettre en ruine. » 626Pamphlet ligueur (anonyme). La Satire en France ou la littérature militante au XVIe siècle (1886), Charles Félix Lenient
Ni la conversion ni le sacre ne peuvent rallier les « papistes » irréductibles : les tentatives d’assassinat qui marqueront tout le règne d’Henri IV le prouvent assez.
Les assassinats, comme tous les complots et attentats contre les rois de l’époque, s’inspirent de la théorie du tyrannicide dont Jean Gerson fut l’un des prophètes : « Nulle victime n’est plus agréable à Dieu qu’un tyran. » Reste le « mystère Ravaillac » .
« Ôtez tout cela de votre esprit. Dites des chapelets, mangez de bons potages et retournez en votre pays ! » 660
Père d’AUBIGNY (fin XVIe-début XVIIe siècle) à Ravaillac, au matin du 14 mai 1610. La Politique des jésuites (1955), Pierre Dominique
Successivement valet de chambre, maître d’école, convers chez les Feuillants qui le chassèrent, François Ravaillac, comme Jacques Clément vingt ans avant, a la tête tournée par ceux qui prêchent la légitimité du tyrannicide et haussent le ton : Henri IV s’apprête à entrer en guerre contre les Habsbourg (Espagne et Pays-Bas), trop puissants en Europe, et à s’allier aux princes protestants. L’idée d’un nouveau conflit avec la très catholique Espagne fait horreur aux extrémistes catholiques de France. Assassiner le roi paraît une solution.
Ravaillac, sûr de sa mission, exalté par ses visions, se dit l’homme du destin et va confesser son intention : ne pouvant approcher le roi pour lui parler, il veut le poignarder. Le père n’y croit pas – ou feint de ne pas le croire. Cette affaire arrange bien les catholiques.
« Je mourrai un de ces jours et, quand vous m’aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais et la différence qu’il y a de moi aux autres hommes. » 661
HENRI IV (1553-1610), à ses compagnons, au matin du 14 mai 1610. Mémoires (posthume, 1822), Maximilien de Béthune Sully
Ce jour-là, de très bonne heure, le roi est assailli de pressentiments. Il se sait menacé, après douze tentatives en dix ans – dix-huit, selon d’autres calculs, et vingt-cinq durant son règne !
Outre la théorie du tyrannicide qui causa la mort d’Henri III, d’autres motifs existent : la fiscalité qui s’alourdit pour préparer la guerre, le mécontentement croissant du peuple, les nobles jaloux des honneurs qu’ils n’ont pas, une affaire de cœur avec une très jeune maîtresse mariée au prince de Condé et qui se complique, une conspiration avec l’Espagne, née dans l’entourage de la reine et que le roi ne doit pas ignorer.
« Ce n’est rien. » 662
HENRI IV (1553-1610), mot de la fin, 14 mai 1610. Histoire du règne de Henri IV (1862), Auguste Poirson
Il vient d’être poignardé par Ravaillac : l’homme a sauté dans le carrosse bloqué par un encombrement, rue de la Ferronnerie, alors que le roi se rendait à l’Arsenal, chez Sully son ministre et ami, souffrant. Le blessé a tressailli sous le coup, et redit « Ce n’est rien » , avant de mourir.
Le régicide sera écartelé, après avoir été torturé : il affirma avoir agi seul. Sully, dans ses Mémoires, n’y croit pas. Le mystère demeure, sur la mort d’Henri IV le Grand. C’est l’une des grandes énigmes de l’histoire de France.
« Il faut que je dise ici que la France, en le perdant, perdit un des plus grands rois qu’elle eût encore eus ; il n’était pas sans défauts, mais en récompense il avait de sublimes vertus. » 665
Agrippa d’AUBIGNÉ (1552-1630). Histoire de France au dix-septième siècle, Henri IV et Richelieu (1857), Jules Michelet
Protestant ardent, mais resté fidèle au roi même après l’abjuration et l’édit de Nantes (qui ne le satisfaisait pas), d’Aubigné énonce une grande vérité à la mort d’Henri IV le Grand.
L’assassinat frappe la France de stupeur et fait du roi un martyr. Ce drame change aussitôt son image, fait taire toute critique et donne au personnage une immense popularité. La légende fera le reste. D’autant que la régente qui lui succède manque totalement de ces vertus politiques qui font les grands règnes.
« Bienvenue dans le mystère Ravaillac. Il prend racine entre Dieu et diable, à l´époque de la sorcellerie vivace et des extases spirituelles, des flamboyants adultères royaux et des philtres d´amour. Il n´a cessé d´alimenter, depuis quatre siècles, les thèses les plus diverses. »
Jean-François BÈGE (né en 1949), Ravaillac, l’assassin d’Henry IV (2022)
« Ce régicide était-il le geste d´un exalté mystique mû par sa propre folie ou l´acte d´un maniaque ‘instrumentalisé’ – dirait-on aujourd´hui – par les auteurs de sourdes menées ? A-t-on voulu enterrer un vaste complot incluant des proches du « bon roi » ? Cherchait-on plus simplement à éviter que les interrogations du bon peuple de France n´en viennent à mettre à mal la continuité monarchique et l´héritage dynastique des Bourbon ?
Comparaison n’est pas raison, mais comment ne pas rapprocher le mystère de cet assassinat et l’entrée dans la légende du roi avec le personnage et l’assassinat de John F. Kennedy, trente-cinquième président des États-Unis, abattu le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), bastion de la droite républicaine, dans sa voiture et en public, par Lee Harvey Oswald, tué ensuite par Jack Ruby… Affaire et mystère non résolu après un demi-siècle d’enquêtes.

