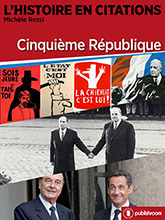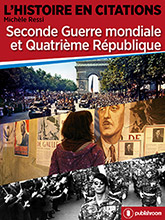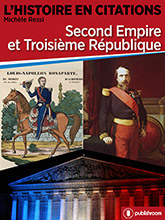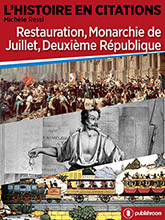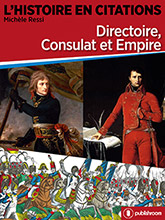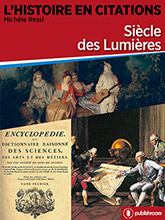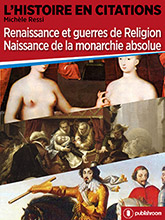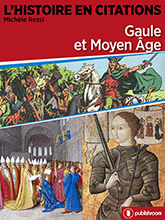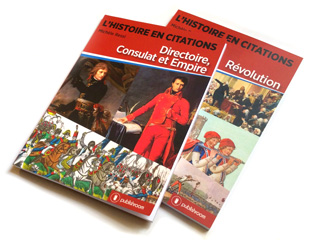« J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. »
Charles BAUDELAIRE (1821-1867). Le Spleen de Paris (recueil posthume de poèmes en prose, 1869)
Les mystères ont défrayé la chronique en leur temps, nourris par la rumeur - bien avant la presse, les réseaux sociaux et toutes les « autoroutes de la désinformation » !
Petits et grands mystères alternent, souvent associés à des Affaires majuscules - des Templiers à l’Affaire Dreyfus. Tant de fois commentées, souvent fascinantes, elles sont un vivant reflet de leur époque, mais aussi de « l’âme humaine » qui ne varie guère.
Certains mystères sont aujourd’hui résolus – l’épidémie de peste noire, le Collier de la Reine, l’Affaire du Rainbow warrior. D’autres demeurent – l’assassinat d’Henri IV, l’énigme du Masque de fer et l’Affaire des poisons au siècle de Louis XIV, l’affaire du petit Grégory de nos jours.
Quelques personnages restent à jamais (et volontairement) mystérieux - du roi Philippe le Bel à François Mitterrand, en passant par le marquis de Sade… et de Gaulle : « La grandeur a besoin de mystère. On admire mal ce qu’on connaît bien. » Quant à Molière, objet des pires fake-news de son temps, sa vie comporte toujours certains mystères.
De nos jours, les « affaires » se multiplient, le journalisme d’investigation devient un genre prospère et les procès font la une des médias. Faut-il y voir un progrès dans la justice, la « transparence » et la démocratie, ou une dérive sociétale dangereuse ?
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
Mitterrand parvient au pouvoir en 1981 : un personnage tout en mystères, une énigme pour ses biographes. Et le temps des affaires est plus que jamais d’actualité.
« Outre son talent littéraire incontestable, ce qui m’a toujours frappé chez François Mitterrand, c’est l’extraordinaire patience qui lui a permis de rester vingt-trois ans dans l’opposition à attendre son heure, la capacité qu’il a de rebondir dans les situations les plus compliquées, son goût subtil pour les jeux les plus raffinés de la politique. Je l’ai qualifié, quand il était chef de l’opposition, de « Prince de l’Équivoque », propos qui n’était point dépourvu d’une part d’admiration. »3105
Raymond BARRE (1924-2007), Questions de confiance. Entretiens avec Jean-Marie Colombani (1988)
« Laisser du temps au temps », précepte mitterrandien, d’ailleurs emprunté à Cervantès (« Dar tiempo al tiempo »). La longue marche vers le pouvoir d’un grand professionnel de la politique a pu surprendre Raymond Barre, cet universitaire devenu Premier ministre, mais qui ne sera jamais rompu à ces jeux politiciens.
« Cet homme est un mystère, habité par mille personnages, du tacticien sceptique au socialiste saisi par la ferveur. On a beaucoup dit que François Mitterrand était insaisissable ; il n’est simple ni à déchiffrer ni à défricher. À la fois personnage authentique et artiste en représentation. »3106
Franz-Olivier GIESBERT (né en 1949), François Mitterrand ou la Tentation de l’histoire (1977)
Son biographe fait le portrait d’une personnalité affirmée (à 60 ans), mais pas encore président. Sphinx, Florentin, Machiavel et autres Prince de l’équivoque ou de l’esquive, ces surnoms reviennent sans fin sous la plume des observateurs. Ils qualifient ses volte-face idéologiques de « convictions moirées ». Le président au pouvoir ne fait rien pour lever le voile, cultivant un certain silence, usant d’un sens inné du secret, et n’abusant pas du petit écran qui finit par être fatal à son prédécesseur.
Autre biographe, Catherine Nay : Le Noir et le Rouge (1984) et Les Sept Mitterrand ou les métamorphoses d’un septennat (1988). Elle reconnaît la profondeur des engagements partisans, l’obstination des choix. Pourtant, nul plus que ce président n’a su se plier aux circonstances et rebrousser chemin selon les données de la conjoncture ou les fatalités du mauvais sort. Ce diable d’homme a savamment joué sept rôles, désormais sept masques plaqués sur un visage dont on chercherait en vain l’ultime vérité. Personnage éminemment romanesque, il aura dérouté, irrité, mais fasciné tous ceux qui l’ont approché.
« Vous êtes purs, parce que vous n’avez pas eu l’occasion de ne pas l’être. »3107
François MITTERRAND (1916-1996), au Congrès des Jeunesses Socialistes (JS), Pau, 1975
Étrange aveu, face aux jeunes socialistes qui vont devoir l’aider dans la course au pouvoir ! Premier secrétaire du PS, il vient de perdre la présidentielle face au centriste Giscard d’Estaing et il opère une « refondation » : il dissout les JS et les ES (Étudiants socialistes), le Mouvement de la jeunesse socialiste (MJS) devenant une simple courroie de transmission du PS.
À 59 ans, Mitterrand a déjà un long parcours politique. Pour avoir été député, sénateur, et onze fois ministre sous la Quatrième République, que de compromis, que d’accommodements, que d’opportunisme !
Ce qui lui sera surtout reproché, c’est une jeunesse liée à l’extrême droite : en 1934, à 18 ans, il adhère au mouvement de jeunes des Croix-de-Feu et devient volontaire national, dans la droite nationaliste du colonel de La Rocque. Il manifeste contre « l’invasion métèque » en février 1935. Il se lie avec des membres de La Cagoule. Il écrit dans le quotidien L’Écho de Paris d’Henry de Kérillis, proche du Parti social français. Enfin, au printemps 1943, il est décoré de l’ordre de la Francisque. Après quoi, il deviendra un authentique résistant.
Affaire et authentique mystère déjà traité : le « vrai faux attentat » de l’Observatoire en 1959, Mitterrand victime ou coupable, vraisemblablement plus ou moins responsable… qui traînera longtemps cette « casserole » très médiatisée.
« De deux choses l’une : ou j’étais abattu, et je ne pouvais plus parler ; ou j’en réchappais, ce qui était le cas, et je tombais dans cette machination. »
François MITTERRAND (1916-1996), cité dans Le Monde, 24 octobre 1959
Il s’est défendu. Il a soutenu que l’attentat n’a pas été un complot ourdi par lui-même, et qu’il est tombé dans une machination qui ne pouvait, une fois lancée, que se conclure par sa défaite. Certains témoignages disent son désespoir, à l’idée que sa carrière politique est terminée. Mais le combat continue… et des années de procédures où cet avocat de sa propre cause se montre plus ou moins adroit.
Quoiqu’il en soit, le mot « pureté » sied mal à Mitterrand. Il gardera toujours des amitiés douteuses (Bousquet), des liaisons dangereuses (avec les puissances d’argent), des pratiques plus que contestables (écoutes téléphoniques, financement occulte du PS, réseaux maintenus en « Françafrique »…) et une double vie privée, tenue secrète, mais financée sur fonds publics (affaire Mazarine Pingeot). Est-ce pour cela qu’il admirait des « purs » comme Jaurès, Blum, Mendès France ?
L’affaire Jean-Edern Hallier : l’enlèvement, puis la mort de l’homme qui en savait trop sur Mitterrand, mais faisait tout pour entretenir le mystère et provoquer le pouvoir.
« On ne reprend jamais une femme. Comme un cigare refroidi, ça ne se rallume pas. »2
Jean-Edern HALLIER (1936-1997), Fulgurances (1996)
Ce surdoué littéraire est l’auteur d’une série de « sorties de route » en tous genres qui finiront par lui être fatales… Son sexisme ne passerait plus la rampe médiatique aujourd’hui, pas plus que son autocongratulation ricanante.
« La mémoire de mes couilles est remplie de mille prénoms adorables. »
« Si je dis que je suis le plus grand écrivain de ma génération, c’est parce que c’est vrai… »
Dans son genre, le pamphlet contre Mitterrand est quand même un petit chef d’œuvre du genre assassin… Au final, une carrière gâchée, une suite de scandales, jusqu’à une mort présumée accidentelle à 60 ans.
Entre Jean-Edern Hallier et François Mitterrand, tout avait pourtant bien commencé - par une amitié littéraire. Avant son élection, l’écrivain iconoclaste mit sa plume au service du candidat socialiste, non sans en attendre quelque récompense : un secrétariat d’État à la Culture (que de Noms se sont imaginés ministre, avant la nomination de Jack Lang) ou à défaut, la direction de la Villa Médicis, résidence d’artistes à Rome…
Mais en 1981, il n’est même pas invité à la première garden-party du septennat. Et nul retour d’ascenseur espéré… Dépité, furieux, Jean-Edern Hallier rumine sa vengeance. Elle va prendre la forme d’un violent pamphlet, bourré de révélations explosives.
« Tonton et Mazarine » ou « L’Honneur perdu de François Mitterrand »
Jean-Edern HALLIER (1936-1997) – non édité
L’auteur a longtemps travaillé sur son ouvrage le plus sulfureux : pendant des années, il réunit des informations sur Mitterrand et met en place les éléments d’un livre intitulé dans un premier temps « Tonton et Mazarine », allusion au secret le plus cher au président… devenu finalement « L’Honneur perdu de François Mitterrand » pour mieux révéler : l’existence de sa fille cachée, dont le grand public n’aura connaissance qu’en 1994 ; le cancer tenu secret qui finira par l’emporter début 1996 ; son passé vichyste – que la biographie de Pierre Péan éventera en 1994 sous le titre d’Une jeunesse française.
Ce manuscrit a suscité tous les fantasmes. Les journalistes du magazine « Affaires sensibles » (coproduit par France Télévisions, France Inter et l’INA d’après l’émission originale de France Inter) l’ont retrouvé quarante ans plus tard dans une ancienne abbaye, vouée à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC). Voici filmées pour la première fois les pages de ce brûlot contre Mitterrand : première version annotée par l’auteur d’un texte remanié maintes fois par la suite.
« Je ne considère pas que ce soit le manuscrit le plus intéressant, et de loin, chez Jean-Edern. C’est vraiment, pardon, un dégueulis de ressentiment. »
Frédéric HALLIER (1971-2024), fils de l’écrivain, témoignant dans « Affaires sensibles »
L’amour filial n’aveugle pas le second père de l’Idiot international, journal pamphlétaire créé par Jean-Edern au lendemain de Mai 68, disparu en février 1994 à la suite de nombreuses condamnations judiciaires et financières et ressuscité par son fils… l’espace-temps de trois numéros en 2014.
Frédéric Hallier lit un extrait de ce « vrai pamphlet », le passage révélant le cancer de Mitterrand qui se savait malade avant même son élection de 1981. Les termes sont choquants, mais l’auteur a la plume pour ce genre de littérature. À vous de juger…
« Sur son lit de mort, il aura sa vraie force tranquille enfin ! »
Jean-Edern HALLIER (1936-1997), manuscrit de L’Honneur perdu de François Mitterrand
« Ce qui est sûr, c’est que ses bulletins de santé sont autant de mystifications. Ils parlent d’examens approfondis. Comment peuvent-ils oublier l’appareil uro-génital, la prostate d’un homme de 70 ans ? Mort, il l’est déjà. Partout où il va, ce zombie, ce cocu ténébreux poursuit ce travail de deuil. Il est même le premier homme politique à s’être collé un masque mortuaire de son vivant. Sur son lit de mort, il aura sa vraie force tranquille enfin. »
Notons l’allusion au slogan publicitaire de Jacques Séguéla qui eut le privilège de travailler pour Mitterrand durant ses deux septennats, l’expression « force tranquille » marquant la campagne présidentielle gagnante, en 1981.
« Que François Mitterrand ait craint ce livre, c’est évident. Si on avait su le cancer, en 88, c’est-à-dire sept ans plus tard, il est à peu près sûr qu’il n’aurait pas été réélu. »
Laurent HALLIER (né en 1937), frère de l’écrivain et témoignant dans « Affaires sensibles »
Voilà pourquoi le livre ne sortira jamais.
La cellule de l’Élysée est alertée par des indics. Censée lutter contre le terrorisme après l’attentat de la rue des Rosiers en 1982, commandée par Christian Prouteau, la cellule se mobilise pour empêcher sa publication. Jean-Louis Esquivié, son numéro deux, ex-mousquetaire de Mitterrand, général de division de la gendarmerie, mais aussi Alain Le Caro, alors responsable de la sécurité du président, considèrent qu’il était de leur devoir de protéger l’image présidentielle. Pour ce faire, plusieurs éditeurs (17, selon le frère de l’auteur, 19 selon d’autres sources) auraient été « découragés » de publier L’Honneur perdu… « pour protéger la vie privée du président ».
Les hommes de Christian Prouteau finissent par mettre la main sur une copie du manuscrit qui circule sous le manteau dans Paris. Pierre Joxe, à l’époque ministre de l’Intérieur, reconnaît avoir « essayé d’éviter que cette publication ait lieu. Parce que c’était répugnant, injurieux, et que, pour des raisons évidentes, puisque j’avais eu le privilège rare de le lire, je pensais qu’il valait mieux que ça ne paraisse pas »… Il en témoigne aussi.
« J’ai pu convaincre, en effet, certaines personnes, comme moi, que ce n’était pas urgent que ça paraisse, que la littérature française pouvait se passer de ce chef-d’œuvre. »
Pierre JOXE (né en 1934), ministre de l’Intérieur (de juillet 1984 à mars 1986) dans « Affaires sensibles »
Mais un autre avis est possible, en démocratie : « Pour un amoureux de la littérature comme François Mitterrand, vouloir empêcher un auteur de publier ? C’est nul ! Inadmissible… d’une très grande médiocrité ». Parole du journaliste Edwy Plenel (cofondateur de Mediapart en 2008), lui-même victime à l’époque des « grandes oreilles » de l’Élysée.
Pour tout savoir de ce que manigance un Jean-Edern Hallier désormais fou de rage et donc prêt à tout et surtout n’importe quoi, sa ligne téléphonique va être mise sur écoute, de 1983 à 1986. C’est le début d’un des grands scandales de la Cinquième République… Voir « Les écoutes de la République », 13 décembre 2021 dans « Affaires sensibles », magazine présenté par Fabrice Drouelle d’après son émission originale de France Inter - radio publique, mais naturellement libre d’expression, après avoir été « la voix de la France » sous de Gaulle.
« Ce cavalier seul est tombé de vélo. »
L’Humanité, 13 janvier 1997, Faire-part de décès de Jean-Edern Hallier
« L’histoire se répète toujours deux fois, la première comme une tragédie, la seconde comme une farce » selon Karl Marx. Il s’était rêvé Chateaubriand face à Bonaparte ou Hugo face à Napoléon III - il ne fut qu’Hallier face à Mitterrand… Un écrivain de talent que la fréquentation du pouvoir détruisit à petit feu.
Quand il s’est tué à vélo, au petit matin du 12 janvier 1997 à Deauville, Jean d’Ormesson croit à un nouveau coup monté du « Breton mégalo ». Mais il est bien mort ce jour-là en Normandie. Sans témoin, d’où les plus folles rumeurs. AVC ? Assassinat politique ? Après l’accident, le bruit court que le coffre-fort de sa chambre d’hôtel a été vidé et son appartement parisien visité. On a dit aussi non sans raison que, lorsqu’on carbure à deux litres de vodka et quatre paquets de cigarettes par jour, disparaître à soixante ans, ce sont des choses qui arrivent.
« La mise à mort de Jean-Edern Hallier. »
Dominique LACOUT (né en 1949) et Christian LANÇON (né en 1957), livre-enquête publié en 2006
L’hypothèse de l’assassinat fut quand même avancée par son frère Laurent Hallier, dans une entrevue accordée à Christian Lançon pour le magazine Généreux en novembre 1998. Le journaliste en tirera un livre co-écrit avec un ex-professeur de philosophie à la bibliographie très éclectique.
La face obscure du mitterrandisme est une fois de plus dévoilée. Tombé dans le piège obsessionnel tendu par un écrivain fantasque et talentueux, le président de la République, « aventurier sans principes et sans scrupules » selon Jacques Chirac lui aussi impliqué dans nombre d’affaires, se révèle aussi romanesque que dissimulateur. Face à un écrivain armé de sa seule plume, Mitterrand n’hésite pas à user contre lui de tout l’arsenal, légal et illégal, à sa disposition. Toute notion de morale, d’honneur, de sens de l’État est piétinée pour des raisons chaque jour plus troubles.
S’il faut conclure sur cette affaire, c’est sur l’impossibilité de résoudre le mystère final. Rappelons que quinze ans plus tôt, en 1982, l’écrivain fut soupçonné d’avoir simulé son propre enlèvement (le 25 avril), revendiqué par de mystérieuses « Brigades révolutionnaires françaises »… et d’avoir par la suite commandité un attentat contre l’appartement de Régis Debray, détruit par une explosion le 21 juillet. Mais Mitterrand n’y était pour rien.
Pas plus que dans l’affaire suivante… même si Mitterrand et Marguerite Duras se sont croisés dans un tout autre contexte humain : « Quel duo ! C’était à celui qui serait le plus intelligent, drôle, charmant, c’était un concours d’élégance de l’esprit » se rappelle Marie-Laure de Decker, interrogée par Le Monde en 2023. « Parfois, elle se mettait à dire n’importe quoi », nuance la photographe qui perçoit un léger agacement chez Mitterrand… Il y a plus grave.
1984. Affaire Grégory : crime « sublime » selon Marguerite Duras, mais quarante ans après, on cherche toujours la vérité sur ce drame familial.
« Sublime, forcément sublime. »3254
Marguerite Duras (1914-1996), tribune dans Libération, 17 juillet 1985
Serge July, patron de Libé, a envoyé Marguerite Duras sur le lieu du drame qui bouleverse la France, depuis le 16 octobre 1984. À Lépanges-sur-Vologne, on a retrouvé dans la Vologne le corps du petit Grégory assassiné. Duras demande à rencontrer la mère, qui refuse. Christine Villemin subit un harcèlement médiatique qui se nourrit du mystère et des rebondissements de l’affaire.
Duras, auteur obsessionnellement fascinée par les faits divers, adopte une méthode « d’imprégnation du réel ». Sans preuves, au mépris de la présomption d’innocence, elle se fait médium pour accéder à la vérité : « Dès que je vois la maison, je crie que le crime a existé. Je le crois. Au-delà de toute raison […] On l’a tué dans la douceur ou dans un amour devenu fou. » Et le « sublime, forcément sublime » devient « coupable, forcément coupable. »
Fort embarrassé, July rédige un avertissement sur « la transgression de l’écriture », rappelant la liberté inhérente à l’écriture de l’artiste. Mais vu la notoriété de l’artiste, et la médiatisation de l’affaire, une polémique s’ensuit.
« Marguerite Duras se défendra toujours de ce « sublime, forcément sublime ». »
Laure ADLER (née en 1950), Qui était Marguerite Duras ? (1998)
Selon sa biographe, « Marguerite Duras se défendra toujours de ce « sublime, forcément sublime » ; elle dira l’avoir barré avant de remettre son texte au journal et reprochera à Serge July de l’avoir rétabli sans l’avoir consultée. Mais pour le reste, elle confirmera ce qu’elle a alors, sous le coup de l’émotion, écrit, relu sous forme manuscrite, puis corrigé sur les épreuves d’imprimerie. »
En 2006, Denis Robert, écrivain et journaliste d’enquête qui suivait en 1985 l’affaire Grégory pour Libération, donne une version contraire : le texte est en réalité une « version allégée » d’une première tribune, refusée par la rédaction du journal, et dans laquelle Duras « développait l’idée qu’une mère qui donne la vie a le droit de la retirer ».
1985. L’affaire du Rainbow Warrior : sabotage décidé par le président, « bavure » des services spéciaux contre un écolo de Greenpeace, mystères et désinformations en série.
« J’ai demandé au Président s’il m’autorisait à mettre en œuvre le projet de neutralisation que j’avais étudié à la demande de Charles Hernu. Il m’a donné son accord en manifestant l’importance qu’il attachait aux essais nucléaires. Je ne suis pas entré dans un plus grand détail du projet, l’autorisation était suffisamment explicite. »3
Amiral Pierre LACOSTE (1924-2020), patron de la DGSE, reçu en audience par le président de la République, le 15 mai 1985. Le Monde, 9 juillet 2005
L› « affaire du Rainbow Warrior » désigne le sabotage du navire amiral de l’organisation écologiste Greenpeace, le Rainbow Warrior, par les services secrets français en date du 10 juillet 1985, ainsi que ses suites médiatiques, politiques et judiciaires.
Le navire à quai en Nouvelle-Zélande était paré à appareiller pour l’atoll de Moruroa. Il avait pour mission de gêner les essais nucléaires français – forme de protestation contre leur tenue. Le sabotage du navire fut commandité par le ministre de la Défense Charles Hernu, avec l’autorisation explicite du président de la République, selon le témoignage de Pierre Lacoste, patron de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure). Jusqu’ici, tout est clair. Mais l’opération va se révéler catastrophique.
Le 10 juillet, le matériel explosif est transféré d’une camionnette de location utilisée par deux agents dits les « époux Turenge », dans un canot pneumatique avec trois nageurs de combat (le pilote Gérard Royal étant le frère de Ségolène Royal). Ils plongent et collent sous la coque deux mines devant exploser à cinq minutes d’intervalle : la première de faible puissance, pour provoquer le sauve-qui-peut ou l’évacuation du navire (douze personnes, dont le capitaine). Comme prévu, l’équipage quitte le navire qui prend l’eau, mais le photographe néerlandais d’origine portugaise Fernando Pereira, membre de Greenpeace, descend dans sa cabine pour récupérer son matériel. À la seconde explosion, il meurt piégé à l’intérieur.
« La thèse de l’ignorance scandalisée tient lieu de ligne de défense officielle. »3255
Serge JULY (né en 1942), directeur de Libération. La Vie politique sous la Ve République (1987), Jacques Chapsal.
Avatar de la « raison d’État » dans la sphère des services secrets, l’« affaire Greenpeace » va faire la une de tous les journaux du monde dans l’été 1985. Elle n’est connue que le 8 août et ne sera jamais tout à fait éclaircie.
C’est la DGSE qui a « fait le coup » : la grosse bavure prend une ampleur internationale, avec répercussions politiques internes. La tactique du gouvernement, c’est d’en dire le moins possible… Et ça se sait de plus en plus. Le bouc émissaire sera finalement Charles Hernu, ministre de la Défense qui a couvert les militaires.
Autres victimes collatérales, les deux agents secrets dont l’identité est livrée à la presse, les faux époux Turenge, de leur vrai nom Alain Mafart et Dominique Prieur.
« Je suis atterrée, et surtout folle de rage. Jamais je n’avais pensé qu’on livrerait mon nom en pâture au public. La protection de l’identité d’un agent demeure le principe sacré de tout service de renseignements ! Pour la sécurité de l’agent et celle de sa famille. Quoi qu’il arrive, on ne livre jamais son vrai nom. »
Dominique PRIEUR (née en 1949), Agent secrète (2018)
Elle témoignera dans ce livre, plus de vingt ans après.
« C’est vrai que tu t’appelles Dominique ? Je viens de l’entendre à la radio. Je me précipite pour guetter les informations. En France, l’hebdomadaire L’Express vient de révéler mon véritable nom, après que le ministère de l’Intérieur français l’a communiqué officiellement depuis plusieurs jours à la police néo-zélandaise, ce que confirmera mon avocat. Sophie Turenge s’appelle en réalité Dominique Prieur.
À la DGSE, je changeais régulièrement de pseudonyme : Delphine, Sylvie, etc. La maison ne peut pas avoir laissé violer cette règle intangible, c’est impensable ! La mort dans l’âme, je comprends en cet instant que j’ai perdu à jamais ce métier que j’aime tant : sans secret, plus d’agent. »
Les « faux époux Turenge » furent facilement arrêtés par la police néo-zélandaise d’Auckland en juillet 1985. Logés le 12 juillet dans un hôtel, ils commettent l’erreur de passer un appel téléphonique à un numéro secret de secours de la DGSE menant à une ligne téléphonique du ministère de la Défense. Méfiant, le chef de la Criminal Investigation Branch envoie deux télex, l’un à Londres, l’autre à Berne. Réponse le 14 juillet : les passeports sont des faux. Le lendemain, ils sont arrêtés. La presse néo-zélandaise commence à mettre en cause les services spéciaux français.
Les deux agents sont inculpés le 23 juillet pour « meurtre, incendie volontaire et association de malfaiteurs ». Le Premier ministre néo-zélandais, David Lange, accuse des « éléments étrangers » d’avoir pris part à l’attentat, visant implicitement la France. Les deux agents sont incarcérés séparément, dans l’attente du procès.
Novembre 1985. L’attentat contre le navire amiral de Greenpeace apparaît rapidement comme une bavure survenue lors d’une opération d’espionnage montée par le gouvernement Français… Cet acte constitue une violation de la souveraineté de l’État néo-zélandais. Il sera à l’origine de tensions entre les deux pays, avec des conséquences sur leurs relations politiques et économiques. Quant aux conséquences médiatiques… le pouvoir va maladroitement jouer la manipulation.
« Contrairement au scandale du Watergate, qui avait provoqué, en 1974, la démission de Richard Nixon, l’affaire du Rainbow-Warrior n’aura fait qu’écorner l’image de François Mitterrand - lequel niera toujours avoir donné l’ordre de couler le navire de Greenpeace. »
Catherine SIMON (née en 1956), Le Monde, 4 août 2006
Les autorités françaises multiplient d’abord les écrans de fumée. Les ondes et la presse diffusent une litanie de fausses pistes : agents provocateurs, services secrets britanniques ou russes, militants d’extrême droite, agents de renseignement calédoniens loyalistes, etc., etc.
Pour calmer les médias, le ministre de l’Intérieur Pierre Joxe lance une enquête de police et organise la fuite des informations vers la presse. Ces fuites permettent à l’enquête néo-zélandaise de progresser rapidement et déclenchent un scandale médiatique. Le but de Pierre Joxe aurait été de se débarrasser de Charles Hernu, ministre de la Défense, proche de Mitterrand et rival politique au sein du gouvernement.
La concurrence politique entre ces deux ministres socialistes se double du vieil antagonisme entre militaires de la DGSE et fonctionnaires de police du ministère de l’intérieur ! Un grand classique des coulisses de l’État. Alors que Charles Hernu nie toujours toute implication de la DGSE, l’imminente publication de documents compromettants décide Mitterrand à commander le 6 août au conseiller d’État Bernard Tricot un rapport à diffuser dans la presse pour calmer la situation… Remis le 26 août, il blanchit la DGSE, suscitant les doutes du Premier ministre Laurent Fabius qui a déclaré ne pas avoir été mis au courant de l’opération relevant du « domaine réservé » présidentiel. « Lui c’est lui et moi c’est moi »… Dans une déclaration de presse, il nie toute implication de son gouvernement.
« Le Rainbow-Warrior aurait été coulé par une troisième équipe de militaires français. »
Bertrand LE GENDRE et Edwy PLENEL, Le Monde, 18 septembre 1985
Le scandale rebondit quand la presse infirme l’hypothèse paranoïaque d’une « troisième équipe » de nageurs de combat, « une totale invention » de la police judiciaire française s’acharnant « à mouiller » la DGSE [qui] ressemble à une trahison », comparable à celle de la collaboration de la police française avec l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale !!! Le 22 septembre, Fabius finit par admettre à la télévision que les services secrets français ont mené l’attaque du Rainbow Warrior.
4 novembre 1985, quatre mois après l’attentat, rappelons le procès à Auckland des deux agents de la DGSE. Leur avocat français Daniel Soulez Larivière a évité in extremis un « coup tordu » en préparation pour les faire évader… Ils plaident coupables d’homicide involontaire. Le 22 novembre, ils sont condamnés à dix ans de prison. Après négociation entre les États français et néo-zélandais, ils sont transférés sur l’atoll de Hao (Polynésie française) et affectés au 5e régiment étranger pour un emploi dans l’administration. Le gouvernement de Chirac (en cohabitation) exerce des menaces et prend des mesures de rétorsion économique pour débloquer la négociation concernant les deux agents : tracasseries douanières sur la laine, suspension d’achats de moutons néo-zélandais…
Ajoutons que le procès a été filmé malgré l’opposition des Français, diffusé sur une chaîne nationale à partir du 26 novembre 2006. Retraité de l’armée française le 30 décembre 1994 avec le grade de colonel, Alain Mafart est devenu photographe animalier. Colonel de réserve en 2008, Dominique Prieur a été DRH par intérim pendant huit mois de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sous le nom de Maire, son nom de naissance.
Un naufrage sur toute la ligne, un immense gâchis. Mais Mitterrand s’en sort quand même.
1994. L’affaire Mazarine Pingeot : vie privée des puissants instrumentalisée par le pouvoir politique et rôle de la presse (people et autre) plus ou moins complice du jeu.
« Le récit bouleversant d’une double vie. »4
Paris Match, titre à la une, 10 novembre 1994, numéro 2372
L’hebdomadaire publie une photo des paparazzi Pierre Suu et Sébastien Valiela : Mazarine et son père François Mitterrand à la sortie du restaurant Divellec, 7e arrondissement de Paris. Le président de la République a donné son assentiment. C’est donc la révélation « grand public » de l’existence de sa fille cachée pendant vingt ans. Avec en gros titre « Le tendre geste d’un père. » La ressemblance est frappante… Tout pour assurer une vente record.
Dans le milieu « bien informé » de la presse, ce secret n’en était pas un. Tous les journalistes savaient plus ou moins. Presque tous avaient choisi de se taire. Jean-Edern Hallier n’avait pas trouvé d’éditeur pour son Tonton et Mazarine, Françoise Giroud (journaliste et ex-ministre) avait fait éditer en 1983 Le Bon plaisir - aux éditions Mazarine ! ça ne s’invente pas. Mais ce président à l’enfant adultérin (le petit Mike) était un roman, donc une œuvre de fiction.
« Il y avait beaucoup de retenue, même peut-être une certaine lâcheté chez les journalistes à prendre de front un personnage aussi considérable que Mitterrand. »
Jean-Michel PEDRAZZANI, ancien directeur de la rédaction d’Ici Paris. L’affaire Mazarine. La vie privée au service du pouvoir, 18 janvier 2022. radiofrance.fr
Cet ex-patron de presse d’un des plus anciens hebdomadaires « people » français (créé en 1945) l’admet volontiers.
Alors que la surveillance policière est constante et la traque médiatique littéralement harcelante auprès de toute personnalité susceptible de « faire la une », on va découvrir que Mitterrand déploya durant des années une série de moyens illégaux pour verrouiller l’accès à une vie privée complexe : deux foyers, Anne Pingeot (née en 1943), historienne d’art, étant vraiment la seconde femme de sa vie, après (ou plutôt en même temps) que Danielle Mitterrand (résistante, femme politiquement très engagée à gauche, Première dame de France),
Qu’a-t-il pu se passer pour que le secret le plus su et le mieux défendu de France s’affiche en une de Paris Match ? L’itinéraire de cette photo en dit long sur l’histoire qui unit « presse people » (presse à scandales et à sensations) et pouvoir politique.
« Si à l’origine, il s’agit de photos volées, elles ont pu sortir par une volonté partagée de la presse et du principal intéressé – Mitterrand. »
Jamil DAKHLIA, président de l’université Paris 3 Sorbonne-nouvelle. L’affaire Mazarine. La vie privée au service du pouvoir, 18 janvier 2022, radiofrance.fr
Ce sociologue des médias parle d’une certaine révérence de la presse envers le pouvoir politique, et même d’une symbiose.
Pierre Suu, le paparazzi à l’origine de la photographie, affirme qu’avant l’affaire Mazarine, « dès qu’on apprenait que tel politicien était avec telle ou telle personne, on n’y touchait pas parce qu’il n’y avait pas de marché. » La publication de cette photographie a donc inauguré de nouvelles pratiques, encouragées aussi bien par les personnalités politiques que par la presse people.
La trajectoire de cette photographie raconte aussi comment se dessine, au gré des événements, la ligne de démarcation entre le domaine de la vie privée et celui de l’intérêt public. Le curseur qui doit guider les révélations des journalistes devrait demeurer l’intérêt public. On peut imaginer que ce n’est pas simple.
« La frontière entre privé et public, pour nous, journalistes, c’est de comprendre si ceux qui ont le pouvoir utilisent l’alibi du privé pour abuser de ce pouvoir. »
Edwy PLENEL (né en 1952), journaliste politique de gauche, cocréateur de Mediapart en 2008. L’affaire Mazarine. La vie privée au service du pouvoir, 18 janvier 2022, radiofrance.fr
« Si par exemple, dans le privé du pouvoir, quelqu’un promeut ses proches, fait des arrangements, etc., ce n’est pas sa vie privée, ça devient quelque chose de public. Là, il s’agit de l’abus de secret pour, dans l’alibi du privé, protéger son pouvoir. » C’est clair… Mais dans « l’Affaire Mazarine Pingeot », la réalité est plus complexe. Il faut rappeler le contexte médiatico-politique.
Fin août 1994 est née une polémique sur l’attitude de François Mitterrand sous Vichy - et notamment son amitié avec René Bousquet, haut fonctionnaire français, collaborateur avec l’occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, assassiné le 8 juin 1993 à Paris. Le président ne sait plus comment se dépêtrer de cette affaire qui s’ajoute à quelques autres… Il fait une émission radio-télévisée avec Jean-Pierre Elkabbach, style « interview-vérité ». Mais ça ne marche pas.
L’opinion publique, dûment sondée, est majoritairement hostile au président de la République à la fin de son second septennat – même phénomène avec Chirac et Macron, ce dernier battant des records d’impopularité (désormais non publiés, mais les indices se trouvent facilement sur Internet). Chaque président essaie à sa manière de retourner l’opinion. On se rappellera le « Pschitt ! » médiatique et chiraquien du 14 juillet 2001, un peu léger quand même, ou plus historique, les JO de 2024 et la reconstruction de Notre-Dame de Paris dans le bilan macronien.
« L’opération Mazarine va être une manière de détourner complètement l’attention des Français si critiques sur ce président. »
Christophe BARBIER (né en 1967), François Mitterrand et Mazarine Pingeot : les coulisses de la Une de Paris Match, 24 septembre 2021. https://www.rtl.fr/actu/politique
L’écrivain aventurierJournaliste éditorialiste, directeur de rédaction de L’Express (août 2006 à octobre 2016), éditorialiste politique et chroniqueur sur BFM TV (depuis septembre 2016), il connaît les coulisses du métier et peut en témoigner.
« Les paparazzi savaient que cette photo-là, à ce moment-là devenait publiable. Et Paris Match savait que c’était en effet publiable sans avoir de gros ennuis de procès de référés, à condition d’avoir au moins de l’Élysée, ce qu’on appelait jadis à Rome un nihil obstat, c’est-à-dire pas d’opposition. Ça ne veut pas dire une approbation, mais en tout cas, pas d’opposition et c’est ça qui se négocie. »
Dans cette logique, Paris Match récupère les photos et envoie un message à François Mitterrand – sans doute Stéphane Denis, éditorialiste, écrivain, collaborateur régulier de l’hebdomadaire. Il avait ses entrées à l’Élysée sous Mitterrand. Il n’a jamais accepté de confirmer cette version… De son côté, Paris Match explique que Roland Dumas, intime de Mitterrand et précédemment son avocat, aurait accepté de lui présenter les photos. Les deux versions concordent sur un point : « Mitterrand regarde ses photos et les trouve très belles (…) ce ne sont pas des photos dégradantes, ni pour lui, ni pour sa fille. » Et il aurait dit : « Les journaux font ce qu’ils ont à faire. » Cela veut dire « qu’il ne s’oppose pas, qu’il ne déclenchera pas la guerre. »
Bien joué ! Le public pardonnera au Président d’avoir une double vie. « C’est aussi accepté parce que c’est moderne, commente Christophe Barbier. En 1980 on est encore à une époque où les hommes politiques hésitent à divorcer (…) Mitterrand fait d’un seul coup un saut dans la modernité et la France du divorce, de l’amour post-68, lui dit : ‹Bravo, vous êtes comme nous. Arrêtez les politiques de faire semblant d’être prudes› » De là à conclure, presque trente ans après…
« L’affaire Mazarine. La vie privée au service du pouvoir. »
Documentaire de Manon Prigent, réalisé par Séverine Cassar, 18 janvier 2022, France Culture, Radio France
Mazarine, devenue femme, épouse et mère, plus ressemblante que jamais à son père, vient témoigner de sa vie d’après. Une vie fatalement différente. Philosophe (autre point commun), elle vient de publier Vivre sans – Une philosophie du manque (2024). Mais entre-temps…
« Mazarine Pingeot (…) parce qu’elle est la fille d’un des rares présidents français qui lisaient, a toujours cru et tenté de nous faire croire qu’elle « écrivait. »
Nelly KAPRIELIAN, critique littéraire, Les Inrockuptibles, le Masque et la Plume (France Inter)
Officiellement Mazarine Marie Mitterrand Pingeot depuis 2016 à l’état civil, née le 18 décembre 1974 à Avignon, professeur agrégée et docteure en philosophie, elle enseigne à l’université Paris-VIII à Saint-Denis et à Sciences Po Bordeaux.
Et elle écrit des romans : sur la famille, la maternité, l’enfance… Au début de sa carrière littéraire, elle ne bénéficie pas de l’indulgence des critiques. Disons même qu’on ne lui fait pas de cadeau. Jusqu’à ce titre qui touche enfin le grand public avec 200 000 exemplaires vendus… et une sincérité sur « l’affaire » dont elle a personnellement (et discrètement) souffert.
« Pour la première fois, je désire un enfant. Je fais ce livre pour toi, l’enfant qui viendra un jour, pour que tu échappes aux mots qui ont tissé ma muselière. Il y a des gens, que nous ne connaissons pas, et qui saccagent mes souvenirs. Je dois maintenant les reconstituer pour t’offrir un passé différent des livres d’histoire et des piles de journaux. »
Mazarine PINGEOT (née en 1974), Bouche cousue (2005)
Longtemps, Mazarine Pingeot a vécu « bouche cousue ». Dix ans après, elle rompt le silence et tente de percer sa mémoire emmurée par une histoire trop lourde à porter, s’adressant à son futur premier enfant, un fils né en 2007.
Depuis que son père est mort (en 1996), Mazarine a perdu l’un des deux principaux témoins et acteurs de son enfance. Les historiens et les journalistes continuent de s’approprier le personnage public de François Mitterrand, mais sa jeunesse à elle, vécue dans le secret le plus total auprès de cet homme, semble perdre peu à peu de sa réalité. Ce François Mitterrand des journaux et des livres d’histoire a-t-il bien été son père?
Pour lutter contre l’oubli, elle fait revivre la petite fille heureuse qu’elle a été, ses paysages et ses jeux d’enfant, ses parents amoureux, le trio idéal, jalousement gardés dans un coin de sa mémoire… Tissant les instants magiques, banals ou cruels d’une enfance pas comme les autres, passée auprès d’un père président de la République, Mazarine fait surgir la figure étonnante de l’homme qu’elle a connu, celle d’un père aimant et exclusif. C’est cette image émouvante, salvatrice, qu’elle s’autorise enfin à partager.
« Pendant cinquante-huit ans, il n’était pas mon père. Tu trouveras ces cinquante-huit ans autre part. Tu comprendras qu’ils ne m’appartiennent pas. Qu’ils me font concurrence. Longtemps, j’ai même ignoré l’orthographe exacte de son nom. Comme tout le monde, j’hésitais entre un R ou deux. J’en avais honte, aussi ne pouvais-je demander à ma mère, encore moins à mon père, comment écrire M-i-t-t-e-r-r-a-n-d. Il ne m’a pas tout raconté. Mais il ne faut pas croire ce que disent les autres. Les autres parlent toujours d’eux. Mon témoignage à moi est vivant. Et vivant restera ainsi ton grand-père. »
Ce témoignage en vaut bien d’autres, sur le personnage qui fut sans doute, avec tous ses défauts et ses qualités, le dernier grand président de la Cinquième République, conforme au mythe du monarque républicain créé par de Gaulle.
Affaire du sang contaminé dans les années SIDA : preuve que l’on peut être responsable, mais pas coupable de milliers de morts.
« Je suis responsable, mais pas coupable. »3296
Georgina DUFOIX (née en 1943), résumant sa position de ministre des Affaires sociales dans l’affaire du sang contaminé, TF1, 4 novembre 1991
Rappelons que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est une infection qui attaque le système immunitaire de l’organisme. Le stade le plus avancé de l’infection à VIH est le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Grâce aux progrès de la médecine, les malades peuvent vivre presque normalement avec. Mais dans les premières années de cette épidémie inconnue, les guérisons relevaient du miracle et tout le monde s’est trompé… y compris les autorités responsables.
En France, plus de 6 000 hémophiles ont été contaminés par le virus du SIDA, entre 1982 et 1985. Ces malades dont le sang ne coagule pas sont exposés à des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés, notamment au niveau des articulations. D’où la nécessité des transfusions. Et le risque de contamination.
Le scandale éclate en avril 1991 : un article dans L’Événement du jeudi incrimine le CNTS (Centre national de transfusion sanguine) qui savait le danger, dès 1984. Le dernier procès des trois anciens ministres impliqués date de 1999. Affaire complexe et tragique. L’opinion publique, sensible aux problèmes de santé, est choquée par ce long feuilleton.
La « petite phrase » qui résume le système de défense de la ministre a suscité d’innombrables réactions : incompréhension, indignation, injures et diffamation. Pourtant, en droit, il peut y avoir responsabilité sans culpabilité, droit civil et droit pénal ne devant pas être confondus. Mais il faut rappeler le contexte historique particulièrement tragique.
« Lorsque la mort par le sang réapparaît dans la société comme c’est le cas dans l’affaire du sang contaminé, le trouble est profond car l’ancienne équation du pouvoir et de la mort, de la guerre, de la violence et du sang, remonte à la surface de l’actualité. »
Alain CUBERTAFOND (1944-2019), Le Pouvoir, la politique et l’État en France (1994)
Tribunal administratif de Paris, jugement du 20 décembre 1991 : « La révélation de l’ampleur de la catastrophe sanitaire annoncée commandait qu’il soit mis fin autoritairement et sans délai à la distribution de produits sanguins contaminés. » Pas coupables, mais responsables.
Autre nuance juridique : « Les pouvoirs publics ont moins été les initiateurs du processus décisionnel que les récepteurs des demandes concurrentes des différents lobbies. » Revue Juridique de l’Ouest. 1996.
Fait capital, compte tenu de l’importance dans le secteur médical des lobbies dont il faut rappeler la définition : « groupement, organisation ou association défendant des intérêts financiers, politiques ou professionnels, en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, notamment les organes de presse. »
Procès OM-Valenciennes, une affaire sans vrai mystère : Tapie coupable fait encore et toujours le spectacle au procès de 1995.
« Tout le monde a menti dans ce procès, mais moi j’ai menti de bonne foi. »3314
Bernard TAPIE (1943-2021), lors du procès OM-Valenciennes, mars 1995. Le Spectacle du monde, nos 394 à 397 (1995)
Diversion bienvenue dans la campagne présidentielle - Édouard Balladur, favori des sondages, contre Chirac à droite qui l’emportera finalement au second tour face à Jospin le 7 mai.
C’est surtout l’épilogue du feuilleton médiatico-juridico-sportif qui passionne le public, avec deux stars à l’affiche : le foot et « Nanard », empêtré dans une sale affaire, au tribunal de Valenciennes.
Le mot, qui vaut aveu, définit ce personnage atypique, cynique, talentueux dans son genre, popu et bling-bling à la fois, ogre hyperactif, qui touche à tous les métiers, est présent dans tous les milieux : chanson, télévision, sport, économie et politique. De 1988 à 1992, le voilà député des Bouches-du-Rhône, député européen, ministre de la Ville, conseiller régional. Parallèlement, il a dirigé avec brio l’Olympique de Marseille jusqu’en 1993, date où commencent les ennuis judiciaires.
Accusé par ailleurs d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale, le présent procès l’implique dans une tentative de corruption, lors du match OM-VA (Olympique de Marseille contre Valenciennes-Anzin). Voulant protéger ses joueurs qui vont affronter le Milan AC dans la Coupe des clubs champions, le patron de l’OM a payé des joueurs de Valenciennes pour qu’ils « lèvent le pied ». L’OM a gagné sur les deux tableaux en 1993 (Coupe d’Europe et Coupe de France), mais des joueurs ont parlé. Tapie a démenti, avant de céder : « J’ai menti, mais… »
Condamné à deux ans de prison, dont un an ferme pour corruption active et subornation de témoin, il fait appel. Condamnation définitive en 1996. Il vivra une résurrection médiatique et financière, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui commence en 2007.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.