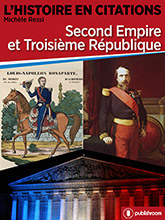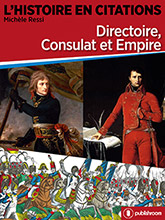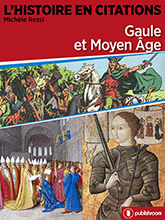L’histoire d’un peuple reflète ce qu’il a dans son assiette et vice versa, mais l’histoire de notre table est la fois française et mondiale, mélange d’influences et d’apports variés qui s’assemblent pour former une gastronomie unique au monde et constitutive de notre identité.
Au menu du jour, voici donc quelque 300 entrées, plats et desserts avec leur petite histoire et leur légende. C’est amusant, mais anecdotique dans une histoire qui nourrit l’Histoire de France des origines à nos jours.
Le pain tient un grand rôle. Omniprésent à table, il manque cruellement au peuple durant les disettes et les famines, d’où les Jacqueries de paysans, émeutes, révoltes périodiques jusqu’à la Révolution. Mais le pain des travailleurs ne quitte pas la scène politique et la baguette nationale s’affiche comme candidate au patrimoine culturel immatériel de l’humanité pour 2022 !
Les trois stars de l’Histoire – Napoléon, Hugo, de Gaulle – sont bien là, mais leur rôle reste secondaire, pour des raisons d’ailleurs différentes.
Un nouveau personnage entre en scène, le chef cuisinier ou maître-queux, à la fois artisan, artiste et chef d’entreprise. Dans une galerie de grands talents, citons le premier, Taillevent l’auteur du mystérieux Viandier, Antonin Carême « roi des chefs et chef des rois » associé à Talleyrand pour mettre la gastronomie au service de la diplomatie et Paul Bocuse le « Cuisinier du siècle » qui fait toujours référence.
L’évolution de la gastronomie se dessine du « repas gothique » à la fast-food contemporaine, en passant par le « service à la française » opposé au « service à la russe », le culte du « bon goût », le classicisme raffiné à l’extrême, les dîners et soupers devenus spectacle sous Louis XIV, la convivialité bourgeoise dans les nouveaux restaurants et cafés au siècle des Lumières, les plaisirs de la chair et de la (bonne) chère qui se mêlent pour faire rimer restauration et prostitution dans la vie parisienne de la Belle Époque.
La mondialisation de la cuisine commence avec la conquête du Nouveau Monde, la découverte des épices, les fruits et légumes exotiques. Les reines étrangères viennent enrichir les menus royaux avec leurs cuisiniers. La démocratisation des voyages vulgarise le « gastronomadisme » cher à Curnonsky, mais la mondialisation associée à l’agriculture productiviste pose problème.
La médiatisation de l’art et des pratiques culinaires change la donne, lance des modes, fait la fortune de quelques chefs et porte le livre de cuisine au rang des best-sellers, tandis que les Top Chef ! et autres mises en scène gastronomiques sont plébiscitées par le public.
Certaines tendances se retrouvent des origines à nos jours : diététique et souci de la santé, végétarisme et mauvaise conscience face à la souffrance animale, locavorisme de règle dans une France agricole à 90 % jusqu’au XIXe siècle.
La tradition l’emporte sur le long terme, les innovations se succèdent, mais les révolutions sont rares. La cuisine moléculaire des années 2010 paraît anecdotique et la viande celllulaire (in vitro) est toujours à l’étude - pour un marché potentiel de 140 milliards de dollars.
Reste la place des femmes souvent paradoxale ! Nombre de plats et de desserts leur sont dédiés - souveraines ou favorites, actrices ou demi-mondaines. Les cuisinières exercent leur talent dans le cercle de famille, la cuisine régionale leur doit beaucoup et parfois une pâtisserie porte leur nom, mais les chefs sont majoritairement des hommes dans un milieu machiste. Durant l’entre-deux-guerres, le cas des « mères » lyonnaises est l’exception qui confirme la règle.
L’histoire se met à table, retrouvez nos quatre éditos :
I. Des origines au Siècle de Louis XIV
II. Siècle des Lumières, Révolution et Empire
III. De la Restauration à la Quatrième République.
IV. Cinquième République.
III. De la Restauration à la Quatrième République.
Première Restauration
« Le Congrès ne marche pas, mais il danse. »1920
Prince de LIGNE (1735-1814), au Congrès de Vienne, 1814. De la réorganisation de la société européenne (1925), Augustin Thierry
Âgé de 80 ans, Charles-Joseph de Ligne, feld-maréchal autrichien devenu un cosmopolite éclairé, lié avec toutes les élites de son temps, de Voltaire à Goethe, parle du Congrès réuni à Vienne de septembre 1814 à juin 1815. Son but : établir une paix durable et refaire la carte politique de l’Europe.
Outre les souverains, les princes et les hommes d’État, les diplomates et les observateurs, une foule d’intrigants et de jolies femmes sont au rendez-vous viennois. Le prince de Metternich, chancelier d’Autriche (chef du gouvernement) et maître des lieux, organise une succession de fêtes et réceptions, bals et concerts, opéras et revues militaires. Le plaisir est roi, mis en scène à la française ou à la viennoise, avec un luxe et un talent éblouissants.
Le Congrès danse, mais il travaille aussi et Talleyrand y veille, en tant que ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII. Il faut solder ce que les historiens appelleront la « seconde guerre de Cent Ans » : de 1688 à 1815, soit en cent vingt-sept ans, la France soutint contre l’Angleterre sept grandes guerres qui durèrent en tout soixante ans. Elle sort vaincue et humiliée à la fin de l’épopée napoléonienne. Le « Diable boiteux » va devoir négocier habilement !
Talleyrand, bien inspiré comme souvent, est venu avec son chef cuisinier attitré.
« Le meilleur auxiliaire d’un diplomate, c’est son cuisinier. »
TALLEYRAND (1754-1838)
Prenant Carême à son service, il lui proposa un défi : créer une année entière de menus sans répétition et en utilisant uniquement des produits de saison. Il passe le test brillamment et complète sa formation dans les cuisines de Talleyrand, la plus « fine gueule » de l’époque avec Cambacérès. Loin de se comporter en simple employeur, il encouragea chaudement son jeune chef dans la création d’un nouveau style de restauration plus raffiné, avec l’utilisation d’herbes et de légumes frais, ainsi que de sauces simplifiées faites avec peu d’ingrédients.
En 1814, au moment de partir de Paris pour Vienne, Talleyrand a réclamé au roi Louis XVIII plus de casseroles que d’instructions écrites. Il savait qu’il emmenait dans ses fourgons le plus grand cuisinier de son temps, Antonin Carême qui avait déjà servi en Angleterre chez le prince de Galles et séduit le tsar Alexandre lors de l’invasion de Paris par les alliés à l’issue de la campagne de France - toujours à la demande de Talleyrand. On a pu dire que Carême fut autant un espion qu’un cuisinier génial. Il va se surpasser à Vienne. Comme Talleyrand qui échoua à faire véritablement couple avec Napoléon et va se rattraper avec le « roi des chefs et chef des rois ».
Bien que représentant d’une nation vaincue, Talleyrand s’est immiscé à la table des négociations. À charge pour Carême de profiter des longs mois à venir pour éblouir les convives par ses mets : si les pourparlers sont souvent difficiles, ces messieurs n’hésitent jamais à partager ensuite un bon repas ! Carême et Talleyrand subjuguèrent Vienne, les altesses et les plénipotentiaires par la magnificence de leurs menus et la qualité des plats mitonnés par la brigade du « roi Carême » qui a codifié la cuisine décorative de tout le XIXe siècle.
Dans les cuisines du palais Kaunitz loué par notre ministre à Vienne, se déroulait tous les jours un ballet tout autant politique que gastronomique. Talleyrand descendait tous les matins en cuisine, ordonnait avec Carême le dîner du jour et recueillait toutes les informations recueillies par le personnel de salle fort nombreux qui assurait autant les soins – obséquieux – du service que le renseignement. Dans la chaleur des mets et des vins, les langues se déliaient et Talleyrand savait tout le lendemain matin.
Pour en revenir à l’art de la cuisine… Antonin Carême invente un pudding à servir froid - avec le concours de Talleyrand qui veille à tout. Il se rappelle ses débuts en tant qu’apprenti pâtissier pour concocter ce dessert susceptible de satisfaire tous les palais. Il s’inspire du « cabinet pudding » très répandu en Europe à cette époque (le pudding, sucré ou salé en provenance du Royaume-Uni, s’apprêtait de mille et une manières). Il en tire une version à base de brioche émiettée agrémentée d’une crème, de fruits confits, le tout arrosé de kirsch et baptisé « à la diplomate ». Il se servait froid, contrairement au cabinet pudding, qui, succès de Carême oblige, prit le nom de « pudding diplomate chaud ».
=> pudding à la diplomate.
Le Brie de Meaux
Le Brie de Meaux est couronné roi des fromages - « le seul souverain que Talleyrand n’ait pas trahi » aux dires de ses nombreux ennemis.
Aux origines, la croyance populaire attribuait à Io, jeune prêtresse et princesse aimée de Zeus, la maternité des vaches dont le lait servait à la fabrication du Brie. Sous Charlemagne, il commence à faire carrière dans l’histoire de France. Blanche de Navarre, comtesse de Champagne et mère de Saint-Louis, envoyait des fromages de Brie au roi Philippe Auguste. Et Charles d’Orléans en faisait présent aux dames de la Cour pour leurs étrennes.
Sous la plume de Rabelais, Gargantua en offre à ses parents « pour leur faire plaisir ». Au banquet qui suit la bataille de Rocroi, en 1643, Condé fit amener des fromages de Brie afin de fêter sa victoire. Pour Marie Leczinska, on inventa les bouchées à la Reine farcies au Brie de Meaux. Louis XVI en demanda une part à l’épicier Sausse, après avoir été reconnu et arrêté à Varennes ! Et la Révolution en fit le fromage du peuple. Un révolutionnaire gastronome proclamait: « Le fromage de Brie, aimé par le riche et le pauvre, a prêché l’égalité avant qu’on ne la soupçonne possible ».
Mais c’est en 1815 au congrès de Vienne que ce fromage des rois reçoit sa consécration. Au cours d’un dîner offert par Talleyrand, une controverse naît avec le prince de Metternich, ministre de l’empereur d’Autriche : quel est le meilleur fromage d’Europe ? Talleyrand en tient pour le Brie, lord Castlereagh qui représente l’Angleterre défend le Stilton, le baron de Falk, des Pays Bas, vante le Limbourg. Cinquante des meilleurs fromages de toute l’Europe sont alors réunis, arrivés par courrier diplomatique, et ce jury tout aussi diplomatique se prononça à l’unanimité pour la suprématie du Brie, désigné « roi des fromages ». Le Brie venait de Villeroy, près de Meaux, produit dans la ferme d’Estourville par le sieur Baulny.
La victoire gastronomique de Talleyrand ne fut pas totale. Le prince de Metternich contre-attaqua avec les pâtisseries viennoises qu’il affirme être les meilleures du monde. Son chef pâtissier, Franz Sacher, inventa la Sachertorte qui recueillit tous les suffrages. C’est un gâteau formé de deux abaisses de pâte légère fourrées de marmelade d’abricot et glacé au chocolat – toujours servi à Vienne, notamment à l’hôtel Sacher.
Il ne reste malheureusement aucun menu de la table de Talleyrand à Vienne, mais Talleyrand et Carême, de même que le couple Metternich et Sacher, ont donné raison à cette maxime d’Escoffier bientôt baptisé l’« empereur des cuisiniers » par Guillaume II : « L’art de la cuisine est peut-être une des formes les plus utiles de la diplomatie ».
Seconde Restauration et Monarchie de Juillet
« Retomber de Bonaparte et de l’Empire dans ce qui les a suivis, c’est tomber de la réalité dans le néant. »
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Parole d’un génie de notre littérature, premier grand romantique avant Hugo qui voulait « être Chateaubriand ou rien » et qui deviendra l’homme du siècle – mais pas côté cuisine !
En politique, Chateaubriand a surtout une vocation d’éternel opposant. Émigré sous la Révolution, sévère pour Napoléon à qui il ne pardonne pas l’assassinat du duc d’Enghien, il commence par être ultraroyaliste sous les Bourbons revenus, ayant bientôt rang de ministre, pair de France, ambassadeur, avant de se retrouver dans l’opposition au pouvoir en place, aux côtés des libéraux luttant pour la liberté de la presse qui lui tient tant à cœur.
C’est en l’honneur de son maître que le cuisinier Montmireil (parfois écrit Montmirail) crée une belle grillade à son nom. Après des années difficiles, la Restauration réinstalle Chateaubriand dans sa dignité de pair de France et lui permet de se retrouver un train de maison digne de son nom. Les minces grillades de bœuf se changent en « grillade de bœuf à la Châteaubriand » taillée en plein cœur du filet. La renommée le fera « château ». Le chateaubriand deviendra la spécialité du restaurant Magny (1862), rue Contrescarpe. Il est toujours servi accompagné de pommes soufflées.
=> le Châteaubriand (ou Châteaubriant).
« Celui qui naît dans un monde déjà occupé, s’il ne peut obtenir de quoi subsister de ses parents à qui il est en droit d’en demander et si la société n’a pas besoin de son travail, n’a pas le moindre droit de prétendre à la plus petite portion de nourriture; et dans le fait il est de trop dans ce monde. Au grand banquet de la nature, il n’y a point de couvert pour lui. »:
Thomas MALTHUS (1766-1834 ), Essai sur le principe de population ou exposé de ses effets sur le bonheur humain dans le passé et le présent avec des recherches sur nos perspectives de supprimer ou de diminuer à l’avenir les maux qu’il occasionne (réédité de 1798 à 1826)
C’est « l’apologue du banquet » : pas de couvert pour les pauvres ! Rappelons que cet économiste britannique de l’École classique est également prêtre anglican.
Premier grand traité sur la population, il influencera Charles Darwin et sa théorie de la sélection naturelle. Son analyse profondément pessimiste s’oppose à l’optimisme d’Adam Smith croyant à la possibilité d’un équilibre harmonieux et stable.
Le retentissement est considérable. L’auteur fournit une explication du fonctionnement impitoyable des sociétés. Sans frein, « la population augmente de manière géométrique, et la nourriture de manière arithmétique ». Il faut donc une politique dite « malthusienne » pour freiner la surpopulation par rapport aux subsistances. La limitation des naissances s’impose – seule la Chine devra y recourir. Dans les autres pays, la théorie de Darwin est infirmée par les faits et la régulation se fait naturellement. Reste que l’inégalité entre les pauvres et les riches perdure, l’injustice étant d’autant plus choquante que nul n’en ignore à présent.
« Plus riche qu’un Stroganov, tu meurs. »
Vieux dicton russe
Le célèbre bœuf au paprika est né chez un aristocrate russe de la famille Stroganov. Depuis le milieu du XVIIe siècle, les Stroganov sont la famille la plus riche de l’Empire, appartenant à cette élite qui peut s’offrir de la viande, le bœuf (sauté au paprika) étant assurément un plat de prestige.
On hésite entre Pavel Alexandrovitch Stroganov (1774-1817) ou plus vraisemblablement Alexandre Grigorievitch Stroganov (1795-1891). A.G. Stroganov, longtemps gouverneur général de la Nouvelle Russie, passa toute sa vie à Odessa, nommé citoyen d’honneur de la ville à sa retraite.
Personnage richissime, dernier héritier sans enfants de la lignée des Stroganov, il tenait table ouverte. Toute personne cultivée ou convenablement habillée pouvait s’inviter au repas. C’est pour ces tables ouvertes que fut inventé par un de ses chefs une sorte de plat hybride franco-russe : de petits morceaux de viande cuit dans une sauce. Plat rapide et facile à réaliser qui permettait de tenir un standing élevé tout en étant facile à servir en portions. La recette a gardé le nom de Stroganov, la tradition russe voulant que le chef d’un aristocrate donne à ses plus belles créations le nom de la noble personne qui l’employait.
À partir de là, le bœuf Stroganov fait le tour du monde. Chassés de Russie par la révolution de 1917, les Russes blancs se réfugient en Chine et l’on commence à servir du bœuf Stroganov dans les hôtels et restaurants chinois. Plus tard, il sera importé aux États-Unis, sans doute par des militaires américains stationnés en Chine, et connaîtra un succès fou dans les années 1950, avant d’investir les tables européennes.
L’internationale gastronomique est un phénomène récent, capable du pire, du médiocre et parfois du meilleur. Inscrit par l’UNESCO en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le repas gastronomique des Français est un vecteur de rayonnement et un précieux atout économique.
=> bœuf Stroganov (ou Stroganoff).
« Aux époques ordinaires, roi convenable ; à une époque extraordinaire, homme de perdition. »1910
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Il juge Charles X (né comte d’Artois) lors de son accession au trône à la mort de son frère Louis XVIII : « Incapable de suivre jusqu’au bout une bonne ou une mauvaise résolution ; pétri avec les préjugés de son siècle et de son rang. » Mais à côté de cela : « doux, quoique sujet à la colère, bon et tendre avec ses familiers, aimable, léger, sans fiel, ayant tout du chevalier, la dévotion, la noblesse, l’élégante courtoisie, mais entremêlé de faiblesse… » Bref, pas né pour être roi en 1824 ! On ne peut s’empêcher de penser à la situation de son frère aîné, Louis XVI accédant au trône en 1774, si mal armé, si faible, dans une situation prérévolutionnaire.
Déçu par la politique, l’auteur des Mémoires avouera : « J’ai vu de près les rois, et mes illusions politiques se sont évanouies. » Quant au nouveau roi, il sera emporté par la prochaine révolution en 1830. Le comte d’Artois (futur Charles X) inspira quand même quelques créations gastronomiques qui survivent à tous les régimes suivants.
=> darnes de saumon, poulet sauté, ris de veau Artois.
« Manger et aimer, chanter, digérer : tels sont les quatre actes de cet opéra bouffe qu’on appelle la vie, et qui s’évanouie comme la mousse d’une bouteille de champagne. »..
Gioachino ROSSINI (1792-1868), Lettres
Profession de foi sans complexe d’un des plus grands compositeurs lyriques du siècle, né en Italie et mort à Paris. Tous ses portraits en témoignent et Théophile Gautier ne peut s’empêcher d’écrire : « Il est de la plus monstrueuse grosseur. Il y a six ans qu’il n’a pas vu ses pieds. Le cuivre de son orchestre montre une certaine préoccupation de casserole qui ne le quitte pas, même dans ses inspirations les plus sublimes. »
L’auteur du Barbier de Séville était d’une gourmandise égale à son génie. Habitué des plus grands restaurants de la capitale - La Tour d’Argent, Chez Bofinger, la Maison dorée -, il recherche les mets les plus rares et n’hésite pas à donner des idées de recettes. Au Café Anglais, l’une des adresses les plus prisées du Boulevard des Italiens, il demanda à se faire servir une viande de bœuf taillée en rond dans le filet, chapeautée d’une tranche de foie gras et d’une rondelle de truffe - gourmand de tout, il raffolait du foie gras et des truffes baptisées « les Mozart des champignons ».
Effaré, le maître d’hôtel dit la vérité au Maître, ce mets est imprésentable : « Qu’à cela ne tienne, faites passer le plat dans le dos des convives ». Est-ce pour cela que ce plat au succès jamais démenti s’appelle tournedos ? Peut-être. On avance aussi une origine peu ragoûtante : sous ce nom se cachaient les viandes à la fraîcheur douteuse, planquées dans la réserve des bouchers des Halles – le « ventre de Paris ».
Cela dit, le tournedos Rossini a bien été créé par Casimir Moisson, chef de la Maison Dorée, en l’honneur de l’illustre compositeur. Il y avait sa table attitrée, mais avant de prendre place, à son entrée du restaurant, il tenait à serrer la main du maître d’hôtel, du sommelier, des serveurs et du chef. Presque toute la brigade passée en revue !
Rossini est décrit par ses biographes de façon diverse : hypocondriaque, colérique mais sujet à de profondes dépressions, ou encore joyeux, bon vivant, amoureux de bonne chère et de belles femmes ; paresseux, mais capable d’une production lyrique incomparable - bien que riche de nombreux centoni ou parodie musicale, avec des fragments musicaux antérieurs réutilisés pour de nouvelles œuvres où le compositeur emprunte à lui-même dans une sorte d’auto-plagiat. Surnommé il Signor Crescendo, il pouvait accoucher d’un opéra en quinze jours, orchestration comprise ! L’inspiration gourmande lui dictait en même temps ses « bouchées de la Pie voleuse », sa « tarte Guillaume Tell ».
Cette facilité de création inégalée et ce train de vie gastronomique ont fini par le fatiguer. Il prit sa retraite à 38 ans pour avoir enfin le temps de bien vivre jusqu’à 76 ans. Toujours amateur de gastronomie fine et de vins rares avec sa légendaire cave à vin, il écrit un livre de cuisine et compose quelques dernières œuvres musicales - ses « Péchés de vieillesse » baptisés avec humour « Hachis romantique », « Petite valse à l’huile de ricin ». Mais un seul plat est resté célèbre.
=> tournedos Rossini.
« L’histoire naturelle connaît trois grands estomacs : le requin, le canard et Victor Hugo. ».
Charles-Augustin SAINTE-BEUVE ( 1804-1869), cité dans Les Contemplations gourmandes, Florian V. Hugo, arrière-arrière-arrière- petit-fils en ligne directe
Auteur et célèbre critique à la dent dure, Sainte-Beuve prétendait avoir vu de ses yeux son illustre confrère faisant dans son assiette de fabuleux mélanges de côtelettes, haricots à l’huile, bœuf à la sauce tomate, omelette au jambon, café au lait relevé d’un peu de vinaigre, de moutarde et de fromage de Brie, le tout avalé indistinctement très vite et très longtemps.
Il avait une recette très personnelle pour aider à la digestion de ses repas pantagruéliques : à la fin du déjeuner, il se faisait apporter sur un plat un morceau de charbon de bois qu’il croquait en entier pour détruire les « corruptions, miasmes et pestilences de son estomac. »
On cerne mieux le Hugo amateur de bonne chère (et de chair) : « Il mangeait comme il embrassait la vie : passionnément et pas toujours dans la finesse », décrit son descendant. Dès le matin, il gobait des œufs au petit déjeuner. Il dévorait souvent des côtelettes ou du bœuf en sauce après des asperges en entrée. Sans oublier les soupes.
« Mon ancêtre était un gros mangeur. Un homme plus gourmand que gourmet. Il voulait voir beaucoup de plats à table pour faire des gribouillis, comme il disait : il piochait dans tous les plats et mangeait un peu de tout. » Il raffolait de homard dévoré dans sa carapace, ou d’oranges croquées à même la peau. « Il n’aimait pas le chichi, comme on dit chez nous à Marseille. » C’est là que Florian V. Hugo a grandi, débutant des études de droit… avant de bifurquer vers la cuisine.
« La sincère amitié qui m’unit à la reine de la Grande-Bretagne et la cordiale entente qui existe entre mon gouvernement et le sien me confirment dans cette confiance. »2115
LOUIS-PHILIPPE (1773-1850), Discours du trône, 27 décembre 1843. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps (1858-1867), François Guizot
Les mots de « cordiale entente » font leur entrée dans l’histoire des relations franco-anglaises. Qui l’eut pensé il y a quelques siècles ou même quelques décennies ? Mais le Roi des barricades doit se faire accepter des cours européennes et l’Angleterre est la grande puissance mondiale du siècle : l’alliance avec elle est indispensable, malgré une certaine anglophobie que l’opposition sait parfois exploiter (affaire Pritchard). Guizot, dès 1841, encouragea cette politique d’entente cordiale qui ne dit pas encore son nom, d’ailleurs inspirée de feu-Talleyrand.
En septembre 1843, la reine Victoria visite Paris. Louis-Philippe lui rendra la politesse à Londres en octobre 1844 et replacera la formule : « La France ne demande rien à l’Angleterre. L’Angleterre ne demande rien à la France. Nous ne voulons que l’Entente cordiale. »
Victoria (1819-1901), une longue vie et un très long règne sur un très vaste territoire : reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (1837-1901) ), reine du Canada, impératrice des Indes à partir de 1876, reine d’Australie le 1er janvier 1901. Quelques plats rendent toujours honneur à la souveraine, contenant les ingrédients fétiches de cette époque : artichaut, champignon, homard, truffe, langouste, sole. Notons aussi la glace très appréciée à l’époque.
=> barquettes, sauces, garnitures, salades Victoria
=> bombe Victoria aux marrons glacées.
« L’agriculture manque de bras. »2203
Alphonse Valentin Vaysse de RAINNEVILLE (1833-1894), Rapport au ministre de l’Agriculture. Le Moniteur universel, 21 juillet 1850
Petite phrase devenue mot célèbre.
La France, paysanne à 90 % depuis le Moyen Âge, reste un pays essentiellement rural, mais l’activité industrielle progresse deux fois plus vite que l’activité agricole, dans la décennie 1835-1845. Cela provoque un exode de la main-d’œuvre des campagnes vers les villes où les salaires sont plus élevés, mais le chômage et la misère beaucoup plus difficiles à supporter que dans les campagnes. C’est dans ce prolétariat victime du capitalisme industriel que le socialisme fait des émules. De son côté, la production agricole ne s’est pas suffisamment mécanisée. Il faut donc encore beaucoup de bras à cette agriculture, pour nourrir l’ensemble de la population.
Second Empire
« Je n’ai pas rédigé une seule de mes indications élémentaires sans avoir constamment l’horloge sous les yeux et la balance à la main. »
Jules GOUFFÉ (1807-1877), Le Livre de Cuisine : comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine avec 25 planches imprimées en chromolithographie et 161 gravures sur bois dessinées d’après nature par E. Ronjat, Paris,Hachette (1867)
Fils de pâtisser, l’illustre Carême « le roi des chefs et le chef des rois » l’initia au métier pendant sept ans. Sacré « apôtre de la cuisine décorative » et spécialiste de la pièce montée, Jules Gouffé ouvre une pâtisserie rue du Faubourg-Saint-Honoré dans les beaux quartiers de Paris, devenant le pâtissier de Napoléon III en 1855.
Il rédige son Livre de Cuisine en deux parties. La première est destinée à la cuisine des ménages qui se veut « sans complications d’aucun genre » et met les recettes « tout à fait à la portée des débutants et des apprentis », l’autre à celle des « extras », la grande cuisine avec « tous ses développements et ses perfectionnements ». Il détaille les ustensiles et les appareils utilisés, indique les quantités de denrées et les temps de cuisson. « Je m’empresse d’ajouter qu’on n’est pas obligé d’avoir constamment recours, dans la pratique, à ces moyens de vérification absolue, du moment où l’on est devenu un ouvrier habile et consommé. Mais lorsqu’il s’agit de formuler pour les personnes qui n’ont pas encore de connaissances acquises, je déclare qu’on ne saurait procéder d’une façon trop rigoureuse. » Il confirme l’idée chère à Raymond Oliver : « La pâtisserie est véritablement une science exacte, alors que la cuisine est plutôt une science d’instinct et de jugement personnel. ».
Gouffé fait réaliser dessins et planches dans un but didactique : innovation reprise dans la littérature culinaire et portée à son comble médiatique dans les « Top Chef » et autres émissions télévisées qui ne ratent pas un gros plan sur la recette en cours de réalisation, sans parler des You Tube et autres tutoriels qui abondent sur le Net.
Le Livre de cuisine donne plus de 500 recettes, certaines fournies par des confrères, à commencer par son frère Alphonse Gouffé, officier de bouche à la cour d’Angleterre. La cuisine est aussi une affaire de famille. La publication suivra en anglais : The Royal Cookery Book.
Il enchaîne avec ses Recettes pour préparer et conserver les Viandes et les Poissons salés et fumés, les terrines, les galantines, les légumes, les fruits, les confitures, les liqueurs de famille, les sirops, les petits fours, etc., en trois parties : les conserves de toute nature, l’office (« confection des petits fours, des bonbons, des fruits confits et diverses préparations pour les bals et soirées »), les recettes alimentaires des malades et des convalescents. Suivront Le Livre de Soupes et des Potages contenant plus de 400 recettes de potages français et étrangers, puis Le Livre de pâtisserie, toujours illustrés et édités par Hachette.
C’est une somme documentaire, un étonnant voyage au pays de toutes les gastronomies en général et de la pâtisserie en particulier, une référence absolue que consultent les grands chefs actuels. Innovation radicale, la « cuisine moléculaire » se réclame de cet héritage dans l’esprit plus que dans la lettre, et Thierry Marx dit son admiration pour ce maestro des casseroles, cet horloger de la gastronomie chez qui tout est toujours contrôlé, précis, minuté à la seconde, pesé au gramme, cuit au degré : la technicité au service du produit. Mais Gouffé est surtout un homme de son temps, dans la foulée du baron Haussmann qui transforme Paris, précédant la vague d’innovations de la fin du XIXe siècle.
« J’y suis, j’y reste. »2264
MAC-MAHON (1808-1893), au fort de Malakoff, surplombant la citadelle de Sébastopol, 8 septembre 1855. Le Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta (1960), Jacques Silvestre de Sacy
Mot attribué au général qui a fini par prendre le fort de Malakoff et ne veut pas le rendre, alors que les Russes annoncent qu’ils vont le faire sauter. Le siège de Sébastopol durait depuis 350 jours, quand Mac-Mahon prend la tête des colonnes d’assaut et part à l’attaque, entouré de ses zouaves.
Le commandant de l’armée de Crimée, Pélissier, va y gagner son bâton de maréchal, le titre de duc de Malakoff, sa place au Sénat, une pension annuelle de 100 000 francs et d’autres honneurs. Mac-Mahon, pour ce mot et ce fait de guerre, entre dans l’Histoire – il aura d’autres occasions de se manifester, comme président de la République sous le prochain régime.
=> gâteau Malakoff.
« Nos cœurs ont suivi le cours de nos rivières. »2280
Parole des Savoyards, devenu proverbe, printemps 1860. Napoléon III et le Second Empire : le zénith impérial, 1853-1860 (1976), André Castelot
Selon les sources, la forme peut varier : « Nos cœurs vont là où vont nos rivières », « Notre cœur va du côté où coulent nos rivières », etc. Pour dire que les Savoyards votent leur rattachement à la France, par plébiscite des 22 et 23 avril 1860, en vertu du traité de Turin du 24 mars 1860 (épilogue de la campagne d’Italie de 1859). Avec 250 000 oui, contre seulement 230 non !
Le plébiscite de 1860 peut être présenté comme l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais les Savoyards ont en fait ratifié une cession de territoire, décidée en 1858 par accord secret, lors de l’entrevue de Plombières du 20 juillet : Cavour, au nom du roi Victor-Emmanuel II, se rend dans cette petite station thermale des Vosges où Napoléon III est en cure pour ses problèmes rénaux. Ils conviennent d’un troc, dans le cadre des négociations diplomatiques relatives à l’unification de l’Italie : en échange de l’aide diplomatique et militaire pour libérer la péninsule de l’occupation autrichienne, le comté de Nice et le duché de Savoie reviennent à la France.
Les Niçois feront le même choix, le 15 avril 1860. Ces conquêtes pacifiques sont à porter au crédit du Second Empire. Côté cuisine, on lui doit aussi le « riz à l’impératrice », dédicace moins originale à Eugénie de Montijo.
=> glace plombière.
« Un croissant, c’est tactile, charnel, sensuel. Il doit sentir, bon, se tripoter avec les doigts, être rebondissant, avoir fait peu de gonflette. »
François-Régis GAUDRY (né en 1975) critique gastronomique hebdomadaire sur France-Inter
Cette viennoiserie bien connue illustre l’impossibilité de sourcer avec précision l’apparition de certains mets. Seule certitude, le croissant est né autrichien et fait référence au croissant de lune face à une étoile, sur le drapeau turc.
Origine la plus fréquemment citée : en 1683, la ville de Vienne est assiégée par les Ottomans. Dans le silence de la nuit, un boulanger nommé Adam Spiel perçoit un bruit bizarre et donc suspect. Il en fait part à la municipalité, l’on découvre aussitôt le travail des ennemis creusant un tunnel pour envahir la ville à l’aube. Il est alors possible de repousser l’envahisseur. En récompense, les autorités autorisent l’artisan à fabriquer des petits feuilletés en forme de croissant, symbole du drapeau ennemi.
Bien avant, sous la Renaissance et le règne d’Henri II, en 1549, une quarantaine de gâteaux en croissant sont servis dans un banquet offert par la reine Catherine de Médicis, pour commémorer l’alliance de François Ier avec le Grand Turc en 1536. Mais… une pâtisserie traditionnelle en forme de croissant de lune existe en Autriche avant l’an 1 000, fabriquée à Pâques dans les couvents avec une simple pâte levée, proche des kipferls actuels.
Autre origine possible, en 1770, Marie-Antoinette d’Autriche aurait officiellement introduit le croissant à la cour de France et popularisé cette « viennoiserie ». C’est alors que se serait répandue l’histoire du boulanger autorisé à fabriquer les croissants un siècle plus tôt à Vienne.
Les premiers croissants se vendent à Paris dans la Boulangerie viennoise ouverte au 92 rue de Richelieu par deux Autrichiens, avant 1840. Dix ans après, le succès est tel que le croissant est déjà imité un peu partout. Notre croissant se retrouve pour la première fois dans un dictionnaire en 1863 : « Petit pain ou petit gâteau qui a la forme d’un croissant » (Littré). En 1869, « Petit pain dont la forme est celle d’un croissant : Les croissants se font avec de la farine de première qualité travaillée avec une eau qui contient des œufs battus ». Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse.
Le grand succès de la petite pâtisserie qui change plusieurs fois de recette passant de la pâte briochée à la pâte feuilletée lui ouvre le Larousse gastronomique en 1938. Il y a « cinquante paramètres à maîtriser pour faire un bon croissant (dont) la qualité de la farine et du beurre utilisée, le temps de fermentation de la pâte, la façon d’incorporer le beurre, de façonner le croissant, la chaleur du four, la durée de cuisson… » Au final, le beurre de qualité, la chaleur du four et le temps de cuisson en font un produit trop cher pour rester rentable. Résultat ? 80 % des croissants vendus dans les boulangeries dites artisanales sont des produits industriels surgelés. Bon appétit quand même !
Troisième République
« Nous mangeons du cheval, du rat, de l’ours, de l’âne. »2347
Victor HUGO (1802-1885), L’Année terrible (Lettre à une femme, janvier 1871)
Guerre de 1870-71 et siège de Paris. Hugo, revenu d’un exil de presque vingt ans à la chute de l’Empire, reste volontairement enfermé dans Paris bombardé pendant un mois (10 000 projectiles et 60 morts ou blessés chaque jour) et assiégé pendant cinq mois (au total).
Il souffre des souffrances de la ville en cet hiver 1871 – où la consommation d’absinthe est multipliée par cinq ! Il fait don de ses droits d’auteur sur Les Châtiments pour la fabrication de deux canons (le Victor Hugo, le Châtiment) et pour le secours aux victimes de guerre.
Jules Ferry, chargé du ravitaillement de la population (et du maintien de l’ordre), est surnommé Ferry la Famine. Et le gouverneur de la capitale est complètement discrédité.
« D’vant l’boucher, d’vant l’boulanger,
On grelotte dans la rue :
Ni pain ni viand’ pour changer,
Mais quelqu’fois y’a d’la morue.
C’est dans l’plan de Trochu.
Refrain
Savez-vous l’plan de Trochu ?
Grâce à lui rien n’est fichu. »2348Le Plan de Trochu, chanson (1871) - « œuvre collective des journalistes du Grelot ». Les Communards (1964), Michel Winock, Jean-Pierre Azéma
Paris trouve encore la force de rire et de chanter. Trochu, gouverneur de la capitale, est sa tête de Turc favorite, lui qui répète encore et toujours : « J’ai un plan, j’ai un plan. »
Rien moins que 30 couplets détaillent avec un humour parfois noir les misères quotidiennes des Parisiens ! On voit aussi venir la défaite. « Le jour où Paris n’aura / Plus d’quoi nourrir une puce / S’disait chacun, l’on fera / Semblant d’se rendre à la Prusse / Ça doit être l’plan de Trochu. »
L’obsession, c’est la nourriture –ne parlons plus de gastronomie ! Le Siège de Paris par les Prussiens entraîne une authentique famine. Les communications avec l’extérieur étant totalement coupées, le bœuf, le porc, les volailles sont introuvables. Les Parisiens doivent se rabattre sur la viande de chats, de chiens, de chevaux et de rats – qui donne son nom au rationnement. Le peuple des arrondissements les plus pauvres en consomma beaucoup et leur prix monta jusqu’à 3 francs la pièce.
Quand toutes ces viandes vinrent à manquer, à l’approche de Noël 1870, on s’est rabattu sur les animaux du Jardin des Plantes. Le menu d’un restaurant parisien pour le 25 décembre propose : âne, éléphant, chameau, kangourou, ours, loup et antilope, avec un « Chat flanqué de Rats ».
Le Jardin d’Acclimatation abritait des animaux exotiques plus rares et donc très chers. Certains furent envoyé en province dès le début du siège et laissèrent leur place à des animaux plus communs et plus comestibles. D’autres furent épargnés : les singes (trop proches des hommes), les lions et les tigres (trop dangereux) et les hippopotames (trop coûteux). Castor et Pollux les deux éléphants furent quand même abattus fin décembre pour être vendus en boucherie et servis dans les plus grands restaurants. La Gazette nationale du 22 décembre note : « On fait même en ce moment à Paris des festins tels que jamais, dans aucun temps et à n’importe quel prix, on n’en a pu faire. Ainsi, l’un de nos amis nous écrit qu’il a mangé, il y a huit jours, un cuissot d’antilope flanqué de rognons de kanguroo [sic]. »
« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me parait être la gourmandise. »;
Guy de MAUPASSANT (1850-1893), Amoureux et primeurs (Chroniques journalistiques 1856-1890)
Paradoxe très chrétien, la gourmandise est l’un des sept péchés capitaux, en mauvaise compagnie avec l’avarice, l’›envie, la paresse, l’orgueil, la luxure, la colère. Une hypothèse : c’est peut-être une faute de traduction. Goinfrerie, gloutonnerie semblerait plus justes. Le comble, c’est que le dictionnaire donne un autre synonyme : gastronomie !
Rappelons au passage la nuance qui est d’importance : « La goinfrerie est à la gastronomie ce que la muflerie est à la courtoisie. » Signé Pierre Dac.
L’art de transformer la Visitandine en financier.
Encore une anecdote historique et savoureuse !
À Nancy au XVIIIe siècle, les religieuses de la Visitation fabriquaient des petits gâteaux en l’honneur du roi Stanislas de Pologne, devenu duc de Lorraine et père de la reine Marie Leszczynska (épouse de Louis XV). Selon d’autres sources, ces Visitandines viennent du Moyen Âge, créées dans un couvent de Nancy.
En 1890, le financier fait son apparition dans le paysage pâtissier devenu prospère. C’est en réalité un retour gagnant. Lasne, pâtissier parisien, se lance le défi de remettre au goût du jour ces gâteaux. Pas question de toucher à la recette de base : des amandes, du sucre, du beurre, de la farine et des blancs d’œufs. Mais la boutique est à deux pas de la Bourse, ses clients sont donc principalement des financiers à la recherche d’en-cas faciles à manger et non-salissants. Le gâteau correspond exactement à leur attente. Le pâtissier décide de modifier la forme du financier. Habituellement ovale, il devient rectangulaire, en forme de lingot d’or. C’est un succès, toujours apprécié de nos jours.
=> financier.
« Les soupeuses : « fille[s] raccrochant dans les établissements où l’on soupe. »
Lorédan LARCHEY (1831-1902), Dictionnaire historique d’argot (plusieurs éditions)
Les plaisirs de la (bonne) chère se mêlent aux plaisirs de la chair : c’est la Belle Époque – pour un certain milieu.
Le phénomène n’est pas nouveau : à la fin de l’Ancien Régime, les galeries du Palais-Royal avaient déjà bonne (ou mauvaise) réputation, mais les orgies et la débauche ne concernaient qu’un milieu de connaisseurs. Sous le Directoire, « la goinfrerie est la base fondamentale de la société actuelle », note Louis-Sébastien Mercier dans le Nouveau Paris (1799-1800) et selon un policier, « le débordement des mœurs dépasse toute idée ». Réaction normale, après la Révolution, la Terreur, les années de guerre et d’austérité. Mais la fête reste l’apanage d’une minorité.
Fin du XIXe et début du XXe siècle, le phénomène est beaucoup plus répandu à Paris et attire une clientèle internationale. Les « soupeuses » ne rentrent chez elles qu’au petit jour, dorment toute la journée, dînent à la va-vite en début de soirée, endossent leur élégante toilette de travail et sortent vers dix heures pour se rendre dans l’un des établissements où elles ont leurs habitudes. Elles commandent un repas léger et attendent l’arrivée les clients venus pour souper. Les archives de la PP (Préfecture de Police de Paris) possèdent un registre avec des renseignements sur 72 femmes galantes considérées par le service des mœurs comme habituées des établissements publics.
Les soupeurs sont des étrangers (Grecs, Anglais, Espagnols, Roumains, « Orientaux »), des étudiants du Quartier latin, des fils de famille venus à Paris manger leur patrimoine et des « dépensiers ». Ajoutons « le Brésilien » cousu d’or de la Vie parisienne, opéra bouffe d’Offenbach, livret de Meilhac et Halévy repris ensuite au théâtre.
Les grands restaurants sont donc à la fois espace de racolage et lieu de prostitution. Les soupeuses peuvent se rendre dans un cabinet particulier pour une demi-heure ou plus, afin d’y faire une passe avec le ou les clients. Les filles travaillant dans les restaurants font souvent des « couchers », chargées de faire la noce, de divertir leur(s) « hôte(s) », de les pousser à la consommation, puis de le(s) ramener chez elle(s) à la fin du souper. À la fermeture des établissements, les soupeuses restantes peuvent proposer aux derniers clients de finir la nuit chez elles à condition de régler leur addition. Aux dires de la police, les restaurants qui avaient « le monopole des soupers » étaient d’une immoralité incroyable, la gastronomie n’étant bien souvent qu’une question secondaire et le cabinet particulier presque une chambre d’hôtel meublé. Mais leur réputation et le prestige de leurs clients en faisaient des établissements intouchables, à l’inverse des cafés et des cabarets de bas étage, régulièrement surveillés par le service des mœurs.
« La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seule. »
La BELLE OTERO (1868-1965), mot souvent cité, jamais sourcé
Née Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, chanteuse, danseuse de cabaret, native de Galice, elle symbolise la Belle Époque : chrononyme commode qui résume en deux mots et donc simplifie ce début du XXe siècle.
« C’est là que nous avons le plaisir de rencontrer souvent des princes et même des Altesses en compagnie de toutes nos beautés artistiques et mondaines, les Otero, les Liane de Pougy, les Émilienne d’Alençon, les Jeanne d’Erval, les Irma de Montigny, et tutti quanti. » Guide des plaisirs à Paris (1908). Il vante le restaurant-bar Tamarin, 58 rue Pigalle. La Belle-Époque bat son plein dans les beaux quartiers de Paris sur la Rive droite, notamment les Grands Boulevards jusqu’à la Madeleine, les Champs-Élysées, Montmartre – et Montparnasse sur la Rive gauche, vitrine de la « déco Art nouveau ».
Parmi les restaurants de nuit « bien fréquentés », citons la brasserie Fontaine, la brasserie Moderne, le Gaulois, le Sylvain, la Maison Dorée, le Garcin, Maxim’s, Paillard, Lucas, le Grand-Comptoir, le Café Américain, le Hill’s. Certains établissements périclitent à l’orée de la Première Guerre mondiale, mais la renommée d’autres restaurants – comme Maxim’s – perdurent au XXe siècle et jusqu’à nos jours.
Des plats sont dédiés aux grandes mondaines dont le nom reste dans l’histoire. La Belle Otero est aussi… une sauce béchamel à la crème garnie de crevettes roses décortiquées, le tout saupoudré de fromage râpé, arrosé légèrement de beurre fondu et glacé vivement à la salamandre ou au grill du four. D’autres desserts lui sont dédiés, comme jadis aux reines et aux favorites.
=> « Belle Otero », pâtisseries, crêpes et glaces à la Belle Otero.
« La composition d’un menu est l’un des aspects les plus difficiles du métier de restaurateur ; il faut en effet trouver le juste équilibre entre les produits disponibles, les spécialités qui font le renom de l’établissement, le renouvellement indispensable et le bon plaisir du client (repas copieux ou léger, traditionnel ou original). »
Auguste ESCOFFIER (1846-1935), Le Guide culinaire (1903)
Baptisé « empereur des cuisiniers » par l’empereur Guillaume II d’Allemagne et surtout « roi des cuisiniers, cuisinier des rois » après Antoine Carême. Dans le même esprit, il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers, créé nombre de recettes reprises par d’autres chefs, imposé la cuisine française dans le monde.
Il développe le concept de brigade en rationalisant la répartition des tâches : « Le cuisinier doit être propre, méticuleux, ne buvant pas, ne fumant pas, ne criant pas. » Il précise ce que doit être un chef digne de ce nom : « Une seule règle reste absolument fondamentale : aucun plat ne doit voir le jour sans que le chef n’en soit absolument sûr, et celui-ci passe souvent des mois, voire des années, à essayer une nouvelle création avant de décider qu’elle est digne de prendre place sur le menu. » Chef le plus célèbre de son temps, il sera le premier cuisinier fait officier de la Légion d’honneur.
Collaborateur de César Ritz (hôtelier et entrepreneur suisse), on le retrouve chef de cuisine du Grand-Hôtel de Monte-Carlo, du Grand National de Lucerne, du Carlton de Londres, des hôtels Ritz à Paris et à New York. Il est le créateur de trois desserts devenus classiques, dédiés à des femmes et empruntés à la vie artistique et mondaine de sa belle époque.
La poire Belle-Hélène est créée en 1864, en l’honneur La Belle-Hélène qui triomphe partout en Europe. La musique composée par Offenbach et la voix de la cantatrice Hortense Schneider ont envouté le public. Escoffier imagina de pocher une poire et de la napper d’une sauce au chocolat chaud. Aujourd’hui, la poire Belle-Hélène se consomme accompagnée d’une boule de glace à la vanille et de chocolat amer.
La pêche Melba sera créée en 1893 ou 1896 au lendemain d’une représentation de Lohengrin donnée au Covent Garden de Londres. Escoffier dirige les cuisines de l’Hôtel Carlton. Admirateur de Nelly Melba, il va rendre hommage au talent de la cantatrice, avec un entremets mariant la finesse à l’élégance. Les pêches fraîches et entières sont pochées dans un léger sirop vanillé, puis dressées sur un lit de framboises. L’ensemble est incrusté dans un bloc de glace sculpté en forme de cygne, rappelant l’oiseau mythique de l’œuvre de Wagner. Un voile de sucre filé recouvre délicatement l’ensemble. La Melba fut très sensible à cet égard.
Comme pour beaucoup de recettes du répertoire français, historiens et gastronomes avertis discutent encore quant à la véritable origine des crêpes Suzette. Vraisemblablement inventées à Monte-Carlo en janvier 1896 par Escoffier, chef de cuisine au Grand Hôtel, à l’intention du Prince de Galles (fils de la reine Victoria et futur roi Édouard VII), accompagné par une certaine Suzette - Suzanne Reichenberg qui n’était même pas sa petite amie. Escoffier propose au Prince de lui dédier personnellement la recette, ce à quoi il aurait répondu : « Je n’en suis pas digne, nous donnerons plutôt à cette chose exquise le nom de cette jeune personne qui est avec moi ». La crêpe Édouard, c’eut été moins sexy ! Les comédiens du Théâtre-Français s’emparent de cette anecdote en mettant en scène une jeune Suzette qui sert des crêpes aux autres personnages. D’où la légende.
Selon d’autres sources, c’est un élève d’Escoffier, Henri Charpentier qui aurait servi les crêpes au Prince. Mais il n’avait que 16 ans à l’époque et c’est donc peu probable ! Quoi qu’il en soit, il s’est attribué l’invention des crêpes Suzette, quand il était cuisinier de l’industriel américain Rockefeller aux États-Unis.
Escoffier donne la recette : « Appareil parfumé au curaçao et suc de mandarines. Tartiner les crêpes avec le beurre composé suivant : travailler en pommade 100 g de beurre et 100 g de sucre en poudre. Ajouter un demi-décilitre de curaçao et le zeste d’une mandarine. Plier les crêpes en quatre ; les saupoudrer de sucre. Elles sont parfois flambées à la fine. » L’art culinaire français.
=> poire Belle-Hélène, pêche Melba, crêpe Suzette.
« S’il y a un plat universel, ce n’est pas le hamburger mais bien la pizza, parce qu’elle se limite à une base commune - la pâte - sur laquelle chacun peut disposer, agencer et exprimer sa différence. »
Jacques ATTALI (né en 1943), écrivain, chef d› entreprise, économiste et haut fonctionnaire français, conseiller de Mitterrand
Et entre toutes, la pizza Marghetrita a tout pour plaire.
C’est la plus populaire du monde. Née à la fin du XIXe siècle, la Margherita tient son nom de la reine Marguerite de Savoie. Elle et son époux, le roi Umberto Ier d’Italie, étaient alors en visite à Naples et s’étaient arrêtés dans un restaurant pour manger. Pour rendre hommage au couple royal, le chef imagine une pizza aux couleurs du drapeau italien, le pays venant tout juste d’être unifié. Il a donc choisi des ingrédients de couleur verte (basilic), blanche (fromage) et rouge (sauce tomate).
La reine apprécia tout particulièrement cette nouvelle création et le restaurateur l’a nommée pizza Margherita. La recette a ensuite été rapidement popularisée en Italie puis dans le reste du monde, pour sa simplicité de préparation et son très faible coût.
« La cuisine française est la meilleure du monde ! Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres, lorsque l’humanité plus sage, mettra le service de la broche au-dessus du service de l’épée. »
Anatole FRANCE (1844-1924), La Révolte des anges (1914)
Autorité morale et littéraire de son temps, il adopte un mode à la fois fantastique et ironique pour aborder les thèmes qui lui sont chers : critique de l’Église catholique et de l’armée, complicité de ces deux institutions. Et la cuisine s’invite en chantre du pacifisme, à la veille de la Grande Guerre.
L’histoire est simple : des anges rebellés contre Dieu descendent sur terre - à Paris -, pour préparer un coup d’État qui rétablira sur le trône du ciel le diable, qui est en fait l’ange de lumière, symbole de la connaissance libératrice… Les tribulations des anges dans le Paris de la Troisième République donnent l’occasion d’une critique sociale féroce. Finalement, Lucifer renoncera à détrôner Dieu, car ainsi Lucifer deviendrait Dieu et perdrait son influence sur la pensée libérée… Très lu et célèbre de son vivant, Anatole France vit une sorte de purgatoire, provisoire ou non ? Dieu seul le sait.
« J’ai appris la cuisine en faisant la cuisine. »
Eugénie BRAZIER (1895-1977)
C’est la plus connue des « mères » lyonnaises. À juste titre, par sa forte personnalité, sa réussite exceptionnelle et une notoriété qui transcende les modes et les générations.
L’univers de la gastronomie est-il à ce point sexiste ? En tout cas, la « mère Brazier » est la première femme dont le nom s’impose depuis Taillevent - premier chef cuisinier professionnel français du XIVe siècle, auteur du Viandier (livre de recettes et de technique).
Première femme à obtenir trois étoiles au Guide Michelin en même temps que Marie Bourgeois, suivie par Marguerite Bise en 1951 et Anne-Sophie Pic en 2007. La mère Brazier va même obtenir deux fois trois étoiles, suivie par six noms très connus, dont Alain Ducasse, Marc Veyrat, Joël Robuchon.
Son histoire tient du conte de fées – genre Cendrillon. Née dans une famille de paysans bressans, placée à 10 ans (à la mort de sa mère) dans des fermes de la région où elle garde les vaches et les cochons, elle apprend les bases de la cuisine de Bresse. Fille-mère à 19 ans, chassée de la maison par son père et contrainte d’abandonner son bébé à une nourrice, débarquée à Lyon sans le sou, elle se retrouve nourrice (ironie du sort !) dans une famille bourgeoise. La cuisinière tombe malade, elle la remplace. À 20 ans, elle a trouvé sa vocation. Embauchée à la fin de la Guerre mondiale chez la mère Fillioux, elle fait son apprentissage. Sa réputation naît à la Brasserie du Dragon et deux ans après, elle crée son restaurant, un bouchon lyonnais situé 12 rue Royale, nommé la Mère Brazier. Grâce au bouche-à-oreille et aux éloges du critique gastronomique Curnonsky, sa table devient la plus courue de Lyon. Un second restaurant suivra au col de la Luère, annexe du bouchon lyonnais les week-ends et au retour des beaux jours.
La Mère Brazier devient l’emblème de Lyon et de la cuisine lyonnaise au niveau international. « Elle fait plus que moi pour la renommée de la ville. » Parole d’Édouard Herriot, maire de Lyon (et président du Conseil, député, sénateur, ministre). En 1946, Paul Bocuse, 20 ans, héros démobilisé de la Seconde Guerre mondiale, poursuit son apprentissage chez « la Mère » au col de la Luère. Il entretient aussi le jardin potager, trait les vaches, fait la lessive et le repassage. À 72 ans, la mère Brazier cèdera la place à son fils Gaston. Son restaurant lyonnais momentanément fermé renaît en 2007 sous le signe du chef Mathieu Viannay (« Meilleur Ouvrier de France »), retrouve ses étoiles et garde sa réputation.
Des grands classiques qui ont fait la réputation de la Mère Brazier, Viannay n’en garde que quelques-uns, mais « réinventés au gré des saisons et de la fantaisie » : l’artichaut au foie gras réunit un artichaut poivrade, surmonté d’une bille de foie gras avec un émincé de fond d’artichaut accompagné d’une tranche de foie gras rôti parfumé de balsamique ; la célébrissime « volaille de Bresse Demi-Deuil » (du nom des lamelles de truffes glissées sous la peau) rajeunit grâce aux légumes de saison. Le secret de sa réussite est simple : tradition et innovation. Avec une « attention particulière aux cuissons, ajustées au degré près », aux « produits de saison » et aux « alliances », à l’image de ses coquilles Saint-Jacques au citron confit.
Une dizaine d’autres « mères lyonnaises » ont contribué au rayonnement de la ville, mais quelques centaines l’ont nourri et animée au sens étymologique : donner une âme.
« Qu’elles aient basculé dans le luxe, façon Brazier, ou soient restées fidèles à une cuisine plus économe, les mères avaient nourri la ville entière. On passait de l’une à l’autre comme on change de chemise, se régalant ici d’une tarte légère à la praline, là d’un saint-marcellin crémeux ou d’une salade de cochonnailles. Elles formaient à elles seules une famille méconnue, hétéroclite et laborieuse, dessinant une géographie sociale de la ville, déroulant un siècle d’histoire. Elles avaient façonné les quartiers, les avaient bercés, accompagnés. »
Catherine SIMON, Mangées : Une histoire des mères lyonnaises (2018)
Lyon leur doit beaucoup de sa réputation, quelques grands cuisiniers leur doivent d’être devenus des « chefs », les clients n’oublieront jamais cette époque, mais leur cuisine appartient à un passé révolu et elles n’ont pas vraiment fait école dans la carrière de femmes chefs… Contrairement à bien des chefs, les « mères » étaient des femmes discrètes qui ne faisaient pas parler d’elles. À l’exception de la mère Brazier, elles n’avaient aucun sens de la com’. Les journalistes les ont laissées dans l’ombre. Les universitaires, les romanciers ne se sont pas intéressés à elles, à leur vie. Eugénie Brazier, une self-made-woman étonnante, n’a pas été interviewée une seule fois par un journal, une radio ou une télé !
Dans une France encore très misogyne, ces femmes n’étaient pas des féministes, mais elles ont réalisé ce que très peu ont osé faire : être leurs propres patronnes, dans un domaine, la cuisine et la restauration, où les hommes dominaient et continuent à dominer.
D’origine campagnarde, souvent très modeste, ce sont des pionnières. Elles ont inventé les « tables d’hôtes ». Elles se sont révélées chefs d’entreprise à une époque où les femmes n’avaient pas le droit de disposer d’un carnet de chèques. Elles ont innové en cuisine, certaines posant les bases de ce qu’on appellera plus tard la « cuisine light ». Préférant s’approvisionner directement auprès des producteurs, elles ont tout naturellement créé le « circuit court ». Les femmes, Lyon et la gastronomie doivent beaucoup à ces « mères » audacieuses.
La « mère Guy », surnommée « la grand-mère », c’est la pionnière ! Elle tint une guinguette en bord de Saône ouverte en 1759, servant des spécialités de poisson (son mari est pêcheur), dont sa fameuse matelote d’anguilles. La clientèle y venait pour manger, boire, danser et faire du canotage. Déjà, les peintres de l’école lyonnaise fréquentaient l’adresse, ainsi qu’un certain Jean-Jacques Rousseau… Un siècle plus tard, dans les années 1860, les petites-filles de la Mère Guy reçurent toute la bonne société lyonnaise dans un véritable restaurant fréquenté par l’impératrice Eugénie, avant les maires Édouard Herriot puis Louis Pradel.
Surnommée la « Maman des Poilus », Clotilde Bizolon est l’une des mères lyonnaises les plus aimées de son vivant. Restée seule après le décès de son mari et de son fils au début de la Grande guerre, elle ouvrit une buvette de fortune pour servir en plein air le vin et le café aux soldats revenus des tranchées. Elle les réconforta bientôt avec un déjeuner gratuit. Grâce au soutien des Lyonnais et du maire Édouard Herriot, sa buvette fut construite en dur. Elle s’installa ensuite dans un bouchon, rouvrant sa buvette quand la Deuxième Guerre mondiale commence.
Léa Bidaut, dite la « Mère Léa », reçoit une étoile du Guide Michelin pour son restaurant La Voûte Chez Léa, ouvert en 1943 à quelques mètres de la place Bellecour. Défendant ardemment la tradition des bouchons lyonnais, elle présente le tablier de sapeur, le canard au sang, le gigot d’agneau à la moutarde et au champagne. Femme énergique, on la remarque au marché Saint-Antoine avec son écriteau : « Attention ! Faible femme mais forte gueule ! »
Alice Vittet (1905-1989) dite la « Mère Vittet » arrive à Lyon à 13 ans, juste après la Guerre mondiale pour travailler chez le fromager Reynier aux (premières) Halles des Cordeliers (ancêtres des Halles de la Part-Dieu). Elle y rencontre son mari, Henry. Le couple ouvre une fromagerie, avant de s’installer en 1945 au Café du Marché, rue de la Bourse. Veuve, la Mère Vittet rachète en 1957 l’établissement du 26 cours de Verdun pour en faire une véritable brasserie lyonnaise, ouverte 7j/7 et 24h/24. Chaque jour, plus de 500 convives y dégustent ses spécialités : gratin d’écrevisse, escalope de saumon à l’oseille, mousseline de sandre, turbot en écaille de pommes de terre. En 1981, son fils Jean renomma le restaurant « La Mère Vittet ».
La Mère Fillioux (1865-1925), installée dans le 6ème arrondissement de Lyon, reçut avec son mari une clientèle bourgeoise de négociants et industriels du quartier. D’abord simples et roboratifs, ses plats évoluent vers une cuisine plus recherchée. Elle aurait, dit-on, découpé un demi-million de poulardes ! Rappelons qu’elle accueillit et forma la Mère Brazier - qui lui « emprunta » la recette de ses fameux fonds d’artichauts au foie gras.
« Madame Andrée », élève de la Mère Brazier au chalet du col de la Luère, va briller comme elle au firmament Michelin, avec ses deux restaurants lyonnais gratifiés chacun de deux macarons.
Élève de la Mère Léa, Camille Fournier dite « Madame Camille » proposa pendant cinquante ans une cuisine lyonnaise de qualité dans son établissement du 44 rue Mercière. Parmi ses plus fidèles clients, Paul Bocuse aimait profiter de son copieux mâchon - du verbe « mâcher », tradition héritée des canuts, tisserands de soie à la Croix-Rousse, qui partageaient des repas traditionnels lyonnais dès l’aube, après des heures de travail. Le mâchon se veut simple et convivial, mais copieux : cervelle de canut, tablier de sapeur, tripes et grattons lyonnais, andouillettes tirées à la ficelle, le tout arrosé de pots de Beaujolais ou de Mâconnais.
Marcelle Bramy, dite la « Grande Marcelle », régala les Lyonnais pendant plus de cinquante ans avec sa cuisine simple et généreuse, servie dans son bouchon du 71 cours Vitton. Une voix un peu voilée, un sourire et des yeux amicaux… Un habitué fidèle, Raymond Barre amateur : foie de veau, andouillettes, tablier de sapeur.
La « Mère Richard », ce sont deux générations, Renée, mère et fille. On place encore son fromage sur les meilleures tables de Lyon. La reine du Saint-Marcellin a passé le flambeau à sa fille Renée, deuxième du nom. On trouve toujours sa crèmerie aux célèbres Halles Paul Bocuse. Le grand chef qui se fournissait chez elle pour le Saint-Marcellin l’a lui-même nommée « mère lyonnaise ».
« Afin d’séduire la petite chatte
Je l’emmenai dîner chez Chartier
Comme elle est fine et délicate
Elle prit un pied d’cochon grillé
Et pendant qu’elle mangeait le sien
J’lui fit du pied avec le mien. »FERNANDEL (1903-1971), Félicie aussi, chanson d’Albert Willemetz, 1939
Autre ton, autres mœurs : le Bouillon Chartier des Halles qui existe depuis 1896. C’est l’une des plus anciennes cantines de Paris. Elle propose des plats simples, bon marché mais de qualité, préparés surtout avec des produits frais. Le partage des tables et l’addition griffonnée sur la nappe en papier font partie de la tradition devenue folklore.
Le restaurant est ouvert 365 jours par an, la carte proposant de la cuisine française traditionnelle. Le service est assuré par des garçons de salle habillés en rondin (gilet noir près du corps à poches nombreuses) et long tablier blanc.
L’affluence contraint souvent le client à patienter dans la cour intérieure et sous le porche, à l’entrée du restaurant et parfois sur le trottoir, rue du Faubourg-Montmartre. Le placement en salle se fait sous la contrainte du nombre restreint de places, si bien que les tables sont partagées entre clients. Le service est rapide, car il s’interrompt à 22 heures. Mais le restaurant est désormais ouvert jusqu’à minuit.
D’autres Bouillons Chartier ont ouvert à Paris : bd St Germain en 1902, bd du Montparnasse en 1903. Deux Bouillons Racine ont également ouvert dans les 6e et 10e arrondissements. Preuve que la formule a trouvé sa clientèle.
« Le vrai clafoutis exige d’abord de savoureuses petites cerises noires que l’on ne trouve qu’en Limousin. Pour atteindre la perfection du clafoutis, il faut avoir du sang limousin dans les artères, du beau sang foncé comme le sang des cerises »,
CURNONSKY (1872-1956) – souvent cité, assurément dit, mais jamais sourcé
Romancier de talent, gastronome pratiquant, humoriste bon enfant et critique culinaire français, le Prince des gastronomes défend avant tout la cuisine simple, goûteuse et régionale : archétype du clafoutis, dessert simple et savoureux, né dans le Limousin au XIXe siècle et dont la qualité gustative dépend d’un certain type de cerises très locales - ne surtout pas dénoyauter avant cuisson ! Il faut que le fruit garde toute sa saveur et éviter que le jus se mélange à la pâte.
Le Dictionnaire de l’Académie des Gastronomes fait la part belle à Maurice Edmond Sailland dit (par hasard et par jeu) Curnonsky. Né à Angers d‘une vieille famille traditionaliste, il consacre sa vie aux lettres et au bien manger qu‘il associe au bonheur. Grand voyageur, il va goûter sur place la cuisine chinoise, réputée elle aussi « la meilleure du monde ». Ami, compagnon, collaborateur de P. -J. Toulet et nègre de Willy (premier mari de Colette), au lendemain de la Grande Guerre, il fait bénéficier un large public de son goût et de son expérience avec le Trésor gastronomique de la France - entre autres écrits.
Continuateur des écrivains du XIXe siècle qui ont donné à la gastronomie ses lettres de noblesse, créateur d‘un type nouveau, celui du « Gastronomade », cet homme de plume mène une vie nocturne. Il ne déjeune pas, ses soirées se passent dans les restaurants ou chez des hôtes où le bon vivant lie une multitude de contacts utiles et plaisants. La fin de ses nuits est consacrée à l’écriture, il ne se couche jamais avant 7 heures du matin. Son petit appartement n’a pas de cuisine.
Fondateur et premier président de l‘Académie des gastronomes (1930), un plébiscite de 3 338 toques blanches l‘a déjà sacré en 1927 « Prince élu des gastronomes ». Avec un enthousiasme et une bonne humeur conservés jusque dans la vieillesse (il meurt à 84 ans), il mit un talent fait de franchise, de malice et de finesse au service d‘une cause, celle de la bonne cuisine, marquée d‘honnêteté et de simplicité, celle qui présente les choses « avec le goût de ce qu‘elles sont ».
Curnonsky et son époque multiplient les académies, clubs, associations, confréries, etc. autant de prétextes à de bons repas entre membres. La gastronomie n’est pas une science spéculative : « La Gastronomie est vraiment une Religion au véritable sens de ce mot qui veut dire un lien entre les hommes » se plaît-il à répéter. Mais il ne faut pas lui parler de diététique, avec ses 126 kg parfaitement assumés.
« Une bouillabaisse à 32 francs, mon petit, c’est une plaisanterie. À 25 francs, c’est une escroquerie ! Parce que, à ce prix, il ne peut pas y avoir » ce qu’il faut dedans ». »
Marcel PAGNOL (1895-1974) César (1936)
Dans la trilogie marseillaise de Pagnol – Marius, Fanny, César – la version cinéma précède la pièce de théâtre créée après la guerre, en 1946. Immense succès. Dans le rôle-titre, Raimu est le patron du Bar de la Marine, sur le Vieux-Port de Marseille. Il sert naturellement de la bouillabaisse, mais de la vraie de vrai, rien à voir avec les mauvaises imitations qui lui font une concurrence déloyale. Raimu, alias César, alias Pagnol et tous les amateurs dignes de ce nom seront entendus : la plat sera strictement codifié dans la Charte de la Bouillabaisse en 1980. On ne plaisante pas avec cette star de la gastronomie régionale.
La bouillabaisse est un plat à base de soupe de poissons typiquement marseillais, qui trouve ses origines dans la Grèce Antique ! D’après la mythologie romaine, il s’agirait de la soupe que la sulfureuse Vénus fait manger à Vulcain pour l’endormir, afin de pouvoir s’ébattre tranquillement avec Mars.
Étymologiquement, la bouillabaisse vient du provençal « Lou Bouï Abaisso » qui signifie « quand ça boue, tu baisses » (en référence à l’eau frémissante en cuisson rapide). À l’origine, c’est un ragoût consommé par les pêcheurs des Calanques qui utilisent les restes de poissons ou les invendus (écrasés, abîmés …), les faisant bouillir dans de l’eau de mer. Après cuisson, ils versent le bouillon sur des croûtons de pain rassis frottés d’ail, accompagnés de rouille ou d’aïoli. L’eau de mer est remplacée par un fumet de poissons préparé avec des poissons de roche (qui vivent au fond de la mer), transformant ce plat des pauvres en grand classique de la gastronomie française.
Forte de son succès, la Bouillabaisse connaît presque autant de variantes que de cuisiniers. Mais la Charte dicte ses conditions ! Au moins quatre variétés de poissons différentes doivent être utilisées et coupées devant le consommateur. Quant au service, il se fait en deux temps : d’abord le bouillon, puis les morceaux de poissons, les pommes de terre, les croûtons frottés à l’ail et la célèbre rouille. La Méditerranée recréée dans toute sa splendeur !
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.