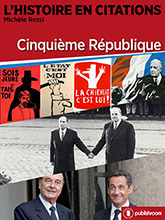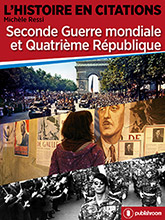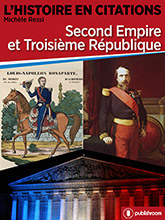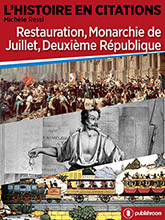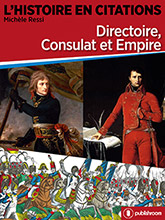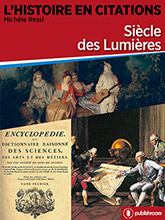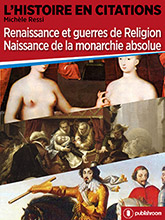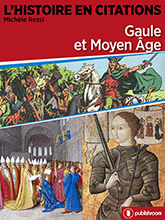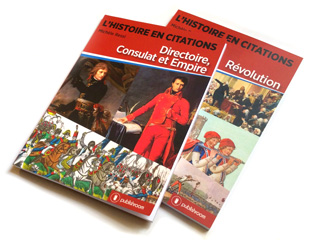« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
Albert CAMUS (1913-1960), Sur une philosophie de l’expression, revue Poésie 44
Et en d’autres mots : « Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, la grande tâche de l’homme est de ne pas servir le mensonge. »
L’Histoire nous donne des repères – encore faut-il qu’ils soient clairs… et historiquement exacts.
À l’époque de toutes les confusions, approximations, exagérations et autres fake-news, voici donc 55 repères historiques : points fondamentaux ou détails anecdotiques, amusants ou tragiques… à méditer et partager à l’occasion.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
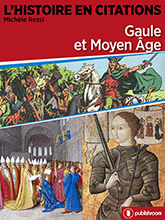 GAULE
GAULE
1. « Les Francs dont nous descendons… » : trop simple pour être vrai.
« Les Francs dont nous descendons. Eh ! mon ami, qui vous a dit que vous descendez en droite ligne d’un Franc ? Hildvic ou Clodvic, que nous nommons Clovis, n’avait probablement pas plus de vingt mille hommes […] quand il subjugua environ huit ou dix millions de Welches ou Gaulois. »51
VOLTAIRE (1694-1778), Dictionnaire philosophique (1764)
Au IIIe siècle, sous le Bas-Empire romain affaibli, les premières invasions germaniques franchissent le Rhin : Francs et Alamans, ces nouveaux peuples vont s’installer en Gaule, comme cultivateurs ou soldats au service des Romains. Après la chute de l’Empire romain d’Occident (476), les Francs vont conquérir la Gaule avec leur chef Clovis. Il deviendra roi en 481… et les Gaulois adopteront le nom de Francs.
Saluons au passage l’esprit de Voltaire, le grand philosophe du siècle des Lumières. Dans la même logique, on chansonnera au XXe siècle « nos ancêtres les Gaulois » (texte de Boris Vian, chanson composée et interprétée par Henri Salvador) qui se retrouveront en personnages de BD : Astérix signé Goscinny (dessinateur) et Uderzo (scénariste). Mais les Gaulois ont acquis leurs lettres de noblesse historique un siècle plus tôt, au XIXe qui a inventé l’Histoire en tant que science, et matière à enseigner aux enfants pour en faire de bons citoyens.
2. « Nos ancêtres les Gaulois » : fondement du « roman national » né au XIXe s.
« Autrefois, notre pays s’appelait la Gaule et ses habitants, les Gaulois. »500
Ernest LAVISSE (1842-1922), « Petit Lavisse », premier manuel d’histoire nationale (1884)
Ainsi débute le manuel de notre « instituteur national » (mot de Pierre Nora), catéchisme patriotique de la Troisième République, après la défaite de Sedan (1870).
Les historiens critiqueront ensuite cette formule : la « Gaule » est une fiction géographique, une invention des Romains pour désigner un peuple hétérogène, constitué d’ethnies différentes, les Ambiens, les Helvètes, les Pictes et autres Celtes. Jules César parle « des Gaules » pour désigner le territoire qu’il a conquis de 58 à 51-50 av. J.-C.
La « mode » des ancêtres gaulois est née sous la Révolution française : la noblesse est associée aux Francs de Clovis, fondateurs de la monarchie et le peuple triomphant assimilé aux Gaulois qui se veulent libres. L’abbé Sieyès appelle à « renvoyer dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d’être issues de la race des conquérants. » Qu’est-ce que le Tiers État, célèbre pamphlet de 1789.
Au XIXème siècle, le mythe gaulois devient sérieusement politique. Napoléon III qui se prend pour César ordonne des fouilles sur les sites de Gergovie et d’Alesia, terrains des deux batailles. Vercingétorix, chef gaulois vaincu par César est exhumé des oubliettes de l’histoire et rentre dans les manuels sous le Second Empire.
La Troisième République fera de Vercingétorix le premier héros national, chef d’une nation luttant dans l’adversité. Les Gaulois résistant aux Romains renvoie à la France vaincue par les Prussiens à Sedan et victime d’un siège long et pénible. On crée les contours d’une imagerie populaire, avec le Gaulois blond et bon sauvage, moustachu et ripailleur… qu’on retrouvera chez Astérix. Certains historiens nationalistes tentèrent de mesurer « scientifiquement » la part de sang gaulois qui coulait dans les veines de leurs contemporains…
« Le Français n’est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Burgonde. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière où, sous la présidence du roi de France, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers. »
Ernest RENAN (1823-1892), Qu’est-ce qu’une nation ? (1882), titre de sa conférence à la Sorbonne, publiée la même année
Les historiens de l’époque en sont bien conscients : l’ascendance gauloise des Français est une fiction qui n’a rien d’historique. L’objectif est idéologique : forger la nation à travers un récit commun, celui du « roman national ».
Ernest Lavisse l’explique d’ailleurs en bon instituteur national : « Il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu’il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroi de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d’Arc, Bayard, tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes, car c’est un malheur que nos légendes s’oublient, que nous n’ayons plus de contes du foyer, et que, sur tous les points de la France, on entende pour toute poésie que les refrains orduriers et bêtes, venus de Paris. Un pays comme la France ne peut vivre sans poésie. »
Les petits écoliers français apprendront cette leçon, jusque dans les colonies aux peuples indigènes.
« Le problème, c’est qu’on a occulté le récit véridique de notre histoire, beaucoup plus multiculturel et multiethnique. »
Suzanne CITRON (1922-2018 ), Le Mythe national. L’histoire de France revisitée (2017)
À partir des années 1960, « nos ancêtres les Gaulois » est une phrase critiquée d’un point de vue historique et idéologique. Elle ne permet pas l’inclusion des minorités, nourrit la xénophobie, nie les richesses du multiculturalisme.
Et malgré tout… La volonté de réécrire l’histoire dans un sens plus « lavissien » pour forger le roman national ressurgit régulièrement chez les politiques de droite, Nicolas Sarkozy et François Fillon, Emmanuel Macron prônant plus récemment le retour au récit chronologique et aux personnages.
C’est aussi le pari de l’Histoire en citations qui cumule autant que possible les deux approches, thématique et chronologique !
3. La théorie des « frontières naturelles » : une réalité essentiellement politique.
« La Gaule avait été fermée et fortifiée par la nature avec un art véritable. »1
Flavius JOSÈPHE (37-100), Guerres des Juifs
La constatation de cet historien juif du Ier siècle se retrouve chez son confrère latin Ammien Marcellin au ive siècle. Mais fleuves et montagnes ne sont pas infranchissables !
La Gaule (ancêtre de la France) a périodiquement subi des vagues d’invasions, profitant par ailleurs d’une exceptionnelle diversité de peuplements et de civilisations. Il faut attendre le Moyen Âge pour que le pays acquière un territoire à peu près hexagonal, en même temps que sa cohésion, sa conscience nationale et, plus tard, une notion précise de la frontière.
« Quand Paris boira le Rhin, toute la Gaule aura sa fin. »508
Jean LE BON (XVIe siècle), Le Rhin au Roy (1568). « La Monarchie d’Ancien Régime et les frontières naturelles », Gaston Zeller, Revue d’histoire moderne (1933)
Ce pamphlet est signé d’un Lorrain, connu aussi comme médecin de Charles IX et des Guise (branche cadette de la maison de Lorraine, politiquement très active et catholique).
Le Rhin au Roy rappelle les limites de l’ancienne Gaule et manifeste sa préférence pour une politique rhénane plutôt qu’italienne. Autrement dit, le Rhin est plus nécessaire que le Pô. On peut y voir une des premières expressions de la théorie des frontières naturelles de la France : Rhin, Alpes et Pyrénées forment ses limites continentales, mer du Nord et Manche (Channel), Atlantique et Méditerranée complétant l’hexagone.
La théorie des frontières naturelles existe sans doute à l’état latent dans la politique des rois de l’Ancien Régime, même si les historiens sont partagés sur ce point – comme sur beaucoup d’autres.
« Rendre à la France les frontières que la nature lui a assignées, confondre la Gaule avec la France et, partout où fut la Gaule antique, la reconstituer. »601
Cardinal de RICHELIEU (1585-1642), Testament politique
On peut voir dans cette phrase l’expression de la politique des frontières naturelles, récurrente dans l’histoire de France. Elle n’est pas systématique à l’époque, même si elle demeure à l’état latent dans les consciences. Au début du XVIIe siècle, les frontières de la France à l’est sont trop voisines de Paris, de sorte que la capitale est menacée en cas de conflit – cette évidence redeviendra sensible au XXe siècle, face à l’ennemi allemand.
Richelieu veut surtout occuper des points stratégiques importants, pour bloquer les routes de communication de l’adversaire et prévenir l’invasion.
« Les limites de la France sont marquées par la nature. Nous les atteindrons dans leurs quatre points : à l’Océan, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées »2
DANTON (1759-1794), Discours civiques de Danton sur les frontières naturelles, 31 janvier1793
Discours destiné à justifier la réunion de la Belgique à la France. L’orateur est loin d’être le seul à penser ainsi. La question des frontières et des limites naturelles sous-tend les débats sur la réunion d’Avignon ou de la Savoie à la France, dès 1792.
L’argument est largement repris dans le milieu politique comme dans la presse et guide la diplomatie et les campagnes militaires françaises contre la Prusse et l’Autriche jusqu’en 1797. Le Directoire concrétise les ambitions rhénanes de la France : à partir de territoires pris à l’Empire ausrro-hongrois, quatre nouveaux départements sont créés sur la rive gauche du fleuve, le Mont-Tonnerre, la Sarre, le Rhin-et-Moselle et la Roer - tirant son nom de la rivière Roer (Rur en allemand, Rour ou Roule en français).
Mais sous le Premier Empire, l’ambition de Napoléon n’aura plus de limites, jusqu’à la campagne de Russie en 1812. « La fortune m’a ébloui » avouera-t ’il à ses ministres en décembre, avant même de connaître le bilan total : 530 000 morts - victimes surtout du typhus, du froid et de la faim.
Rappelons qu’en 1871, le traité de Francfort entérine la perte par la France de l’Alsace et de la Moselle au profit du nouvel Empire allemand, proclamé quelques mois auparavant, dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Les deux provinces resteront annexées jusqu’à la fin de la Grande Guerre.
4. César « imperator » n’a jamais été empereur : contresens historique absolu sous la République romaine, allègrement popularisé par la BD.
« Sous la République romaine, un imperator est un magistrat titulaire de l’imperium, pouvoir suprême de commandement militaire et civil. Imperator est également un titre honorifique porté par certains commandants militaires, à la fin de la République. »3
Imperator (titre). Wikipédia
Après une grande victoire, les soldats rassemblés saluaient leur général du nom d’imperator, acclamation nécessaire afin d’obtenir l’accord du Sénat pour un triomphe. Le général acclamé « imperator » avait le droit de porter ce titre après son nom jusqu’à la célébration de son triomphe, après quoi il devait l’abandonner en même temps que son imperium.
Jules César marque un tournant quand le Sénat lui décerne le droit de porter le titre d’imperator en permanence et à titre héréditaire pour ses descendants. Mais César meurt assassiné en 44 av. J.-C. Le premier empereur romain sera Auguste qui met fin à la République en 27 av. J.-C.
La confusion lexicale entre le latin « imperator » et le mot français d’empereur est encore encouragée par la bande dessinée d’Astérix.
« Oh César, immortel Empereur, des cadeaux arrivent de toutes les provinces de l’Empire, nous organisons un spectacle en guise de soumission pour célébrer ta gloire. »
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR, film réalisé par Gaëtan Brizzi et Paul Brizzi (1985)
Astérix le Gaulois, devenu simplement Astérix, est une série française créée le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo, dans le n°1 du journal français Pilote. Les ventes cumulées des albums, traduits en 117 langues et dialectes, approchent aujourd’hui les 400 millions d’exemplaires, sans parler des versions filmées.
Difficile de lutter contre César, « immortel empereur » passé au rang de mythe. Ce sera « pire » encore avec Jésus, personnage réellement historique le plus mythifié au monde depuis deux mille ans…
5. Vercingétorix, notre premier héros national, est un guerrier vaincu (par César à Alésia en -52 av.J.-C.) : vrai paradoxe historique, daté du XIXe siècle.
« Prends-les ! Je suis brave, mais tu es plus brave encore, et tu m’as vaincu. »23
VERCINGÉTORIX (vers 82-46 av. J.-C.), jetant ses armes aux pieds de César, fin septembre 52 av. J.-C., à Alésia. Abrégé de l’histoire romaine depuis Romulus jusqu’à Auguste, Florus
Ces mots du vaincu rapportés par le vainqueur dans sa Guerre des Gaules servent d’épilogue à la brève épopée du guerrier gaulois, face au plus illustre des généraux romains. Il avait quand même remporté une belle victoire à Gergovie, en mai.
Grand stratège, César est parvenu à enfermer Vercingétorix et son armée à Alésia (en Bourgogne). L’armée de secours, mal préparée, est mise en pièces par César qui exagère les chiffres : 246 000 morts chez les Gaulois, dont 8 000 cavaliers. Vercingétorix juge la résistance inutile et se rend pour épargner la vie de ses hommes – quelque 50 000, mourant de faim après quarante jours de siège.
La chute d’Alésia marque la fin de la guerre des Gaules et l’achèvement de la conquête romaine. Mais le mythe demeure bien vivant, en France : Vercingétorix, redécouvert par les historiens au XIXe siècle et popularisé jusque dans la bande dessinée, est bien notre premier héros national.
Rappelons qu’il doit sa résurrection à Napoléon III. En 1865, l’empereur fait ériger à Alésia une statue de sept mètres représentant le chef arverne. Sur le socle, l’inscription : « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier l’univers. » Cette image de Vercingétorix, héros patriotique d’une nation gauloise unie, sera massivement popularisée sous la Troisième République dans le « Petit Lavisse ». Le chef gaulois y est dépeint en héros, finalement vaincu, mais courageux et digne dans la défaite, symbole de la résistance face à l’envahisseur.
6. Les bienfaits de la colonisation de la Gaule par les Romains : une exception à la règle historique.
« Ces théâtres, ces cirques, ces aqueducs, ces voies que nous admirons encore sont le durable symbole de la civilisation fondée par les Romains, la justification de leur conquête de la Gaule. »29
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de France, tome I (1835)
La Gaule romanisée s’est couverte de superbes monuments qui ont aussi leur utilité. Les thermes, aqueducs et égouts apportent le raffinement de l’eau courante. Le réseau routier rend le commerce florissant, la production de blé augmente, la culture de la vigne se développe - le vin remplace la bière, jusqu’alors boisson nationale des Gaulois. L’essor économique général enrichit le Trésor public : politique d’urbanisme et politique sociale en bénéficient. La Gaule romaine fut une Gaule heureuse.
Elle infirme l’idée qui fera loi plus tard de l’anticolonialisme formulé par Montaigne dans ses Essais (1580) : « J’ai peur que nous n’ayons les yeux plus grands que le ventre et plus de curiosité que nous n’avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n’étreignons que le vent. » Idée reprise par les philosophes des Lumières, à commencer par Diderot.
Ne cédons pas au péché de l’anachronisme et rappelons que toutes les grandes puissances européennes (Espagne, Portugal, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande) ont eu un empire colonial (ou deux) dont elles étaient fières. La vague de décolonisation, qui a changé la face de la planète, est née avec l’ONU et fut décrite à juste titre comme le « premier grand succès » de l’organisation mondiale.
7. Jésus n’est pas né le 25 décembre, ni en l’an I de notre ère : quelques explications s’imposent.
« Et le Christ ?
— C’est un anarchiste qui a réussi. C’est le seul. »11André MALRAUX (1901-1976), L’Espoir (1937)
Sous le règne du deuxième empereur romain Tibère (14-37) vit en Galilée un homme dont les enseignements vont bouleverser l’histoire du monde. De sa mort sur la croix va naître une religion qui lentement s’étendra sur l’Empire et essaimera dans le monde.
Pour les Romains, les premiers chrétiens ne sont qu’une secte juive dont le fondateur passe pour un agitateur politique. Pour les chrétiens, il est Dieu, fils de Dieu, ce Dieu étant un dieu unique, comme celui qu’adorent les juifs.
La réussite de l’« anarchiste » qui termina sa vie comme un criminel mis en croix entre deux « larrons » est due à ses disciples, et plus particulièrement à Paul de Tarse : il fera du message de Jésus une religion à vocation universelle. La Gaule sera tardivement acquise : l’évangélisation des villes, puis des campagnes, ne se fera qu’au ive siècle, le christianisme devenant religion d’État en 391.
« Une chose est sûre, Jésus n’est pas né le 25 décembre de l’an I, comme le veut la tradition. Ce n’est qu’au IVe siècle que le pape Libère (352-366) instaura la solennité de la Nativité, afin de christianiser la fête du solstice d’hiver, le Sol Invictus. »
Jean-Christian PETITFILS (né en 1944), historien et écrivain, auteur de Jésus (2011) et du Dictionnaire amoureux de Jésus (2015)
La fixation de la date de naissance de Jésus (la Nativité) au 25 décembre, à Noël, semble avoir été fixée dans l’Occident latin vers le milieu du IVe siècle, pour coïncider avec la fête romaine de la naissance de Sol Invictus - expression latine signifiant « Soleil invaincu », divinité solaire romaine dont le culte apparaît dans l’Empire romain au IIIe siècle, célébrée à cette date comme la naissance du dieu Mithra, né selon la légende un 25 décembre, à la remontée du soleil après le solstice d’hiver.
Quant à l’année de naissance de Jésus … « Selon les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, il serait né au temps du roi Hérode. Or, celui-ci est mort en l’an 4 (ou 2) avant notre ère. C’est par suite d’une erreur de calcul d’un moine du VIe siècle, Denys le Petit, que la date de l’an I a été arrêtée. » À quoi tiennent les dates historiques… et notre calendrier moderne. On peut quand même relativiser…
« Les historiens soulignent le peu d’importance que les évangélistes accordent à cette date de naissance, les récits édifiants de l’enfance des personnalités ne relevant pas de la « biographie » au sens où nous l’entendons aujourd’hui. »
Marie-Françoise BASLEZ (1946-2022), Bible et histoire : Judaïsme, hellénisme, christianisme (1998)
Ainsi ignore-t-on la date de naissance de nombre de personnages de l’Antiquité.
8. Geneviève de Paris : combattante et sainte patronne de la capitale sauvée par son courage face aux Huns, première héroïne d’une liste de femmes plus nombreuses qu’on ne le croit dans l’Histoire.
« Déjà les habitants se préparaient à évacuer leurs murs ; ils en sont dissuadés par les assurances prophétiques d’une simple bergère de Nanterre, Geneviève, devenue, depuis, la patronne de la capitale. »43
Louis-Pierre ANQUETIL (1723-1806), Histoire de France (1851)
L’historien Jules Michelet, lyrique pour évoquer Jeanne d’Arc, ne consacra qu’une ligne à cette première grande résistante de l’histoire : « Paris fut sauvé par les prières de Sainte Geneviève. »
En réalité, Paris n’est encore que Lutèce, bourgade de 2 000 habitants, dédaignée par Attila (le Fléau de Dieu) qui vient de piller Metz, Reims et Troyes, et fonce sur Orléans, en 451. Mais Geneviève sauvera réellement Paris de la famine, lorsque les Francs assiégeront la ville en 465.
« Simple bergère » pour certains historiens (comme Jeanne d’Arc… qui ne l’est d’ailleurs que par la légende), elle est plus probablement de haute naissance – aristocratie gallo-romaine. Geneviève (« jeune fille », en gallois) a pris très tôt le voile. Fille unique héritant de la charge de membre du conseil municipal (curia) détenue par son père, elle aurait exercé tout d’abord à Nanterre, puis à Paris, faisant partie des dix principales constituant l’aristocratie municipale après son installation dans cette ville, chez une « marraine » influente.
C’est à l’occasion du siège de Paris par les Huns que la pieuse Geneviève va s’illustrer : à 28 ans, elle réussit à convaincre les Parisiens de ne pas fuir et abandonner la cité à l’envahisseur – avec un argument déjà féministe, témoignant de sa force de caractère.
« Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications. »
Sainte GENEVIEVE (née en 422 à Nanterre – morte à Paris en 512). Sainte Geneviève, la fin de la Gaule romaine (2008), Joël Schmidt
Elle ne se contente pas de prier ! Elle réquisitionne des bateaux et organise une expédition qui remonte par la Seine, allant chercher le ravitaillement jusqu’en Champagne. Elle va négocier le blé nécessaire, évitant ainsi la famine à Paris.
Une autre version raconte la ruse de Geneviève faisant courir le bruit chez l’envahisseur que la ville était touchée par une épidémie de choléra, de quoi faire fuir les plus braves. Quoiqu’il en soit, Paris est sauvé et suite à cet exploit, Geneviève jouit d’un grand prestige.
Elle entre en relation avec le roi Childéric et son fils Clovis qui admire la future sainte. Elle forme le projet de conduire Clovis au baptême et se lie d’amitié avec Clotilde, son épouse catholique, autre « femme puissante » de l’époque ! Elles préparent la future cérémonie avec l’évêque de Reims, saint Rémi.
Bref, une femme pleine de ressources qui vécut « plus de dix fois huit ans ». Sainte patronne de la capitale, elle protège aussi les gendarmes. La rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (Paris 5e) lui est dédiée, comme la place et l’Abbaye à son nom, construite par la future sainte Clotilde – on sanctifiait beaucoup dans cette France très chrétienne.
« Le présent enveloppe le passé et dans le passé toute l’Histoire a été faite par des mâles. »2854
Simone de BEAUVOIR (1908-1986), Le Deuxième Sexe (1949)
Livre événement dans l’histoire du féminisme.
Mais un récent édito (en ligne sur notre site), « Les femmes de l’histoire » de l’Antiquité à nos jours, en passant par toutes les époques, nous a permis de combattre l’idée reçue d’une histoire sexiste. Geneviève et la très influente Clotilde en sont les exemples.
MOYEN ÂGE
9. L’empereur à la « barbe fleurie » : détail légendaire, mais symbolique de Charlemagne.
« Il respirait dans toute sa personne, soit qu’il fût assis ou debout, un air de grandeur et de dignité. »63
ÉGINHARD (vers 770-840), Vie de Charlemagne (Vita Caroli magni imperatoris) écrite dans les années 830
« Ayant formé le projet d’écrire la vie, l’histoire privée et la plupart des actions du maître qui daigna me nourrir, le roi Charles, le plus excellent et le plus justement fameux des princes, je l’ai exécuté en aussi peu de mots que je l’ai pu faire ; j’ai mis tous mes soins à ne rien omettre des choses parvenues à ma connaissance, et à ne point rebuter par la prolixité les esprits qui rejettent avec dédain tous les écrits nouveaux. »
Ainsi commence la préface de cette biographie en deux parties : les guerres menées par Charlemagne ; le portrait de l’empereur, la vie à la cour, son testament. Très précieux document, contemporain des faits et gestes relatés.
« Gros, robuste, d’une taille élevée mais bien proportionnée […] les yeux grands et vifs, le nez un peu long, une belle chevelure blanche, une physionomie avenante et agréable »64
ÉGINHARD (vers 770-840), Vie de Charlemagne (Vita Caroli magni imperatoris) écrite dans les années 830
Secrétaire et ministre de Charlemagne, Éginhard nous décrit l’illustre Carolingien Mais nulle allusion à la légendaire « barbe fleurie ».
Le terme serait une interprétation déformée de l’ancien français « flori » qui évoque une barbe blanche, voire brillante. Cette barbe souvent associée à Charlemagne aurait fait son apparition tardive dans la Chanson de Roland (vers 1065) où Charlemagne était représenté comme un patriarche de la Bible. Mais cette « barbe fleurie » interroge aujourd’hui encore les historiens ! Elle relève probablement du mythe, la barbe n’étant pas répandue chez les Francs, contrairement à la moustache. La barbe est absente de nombreuses représentations de Charlemagne, en particulier sur des deniers impériaux.
« L’Empereur à la barbe fleurie. Charlemagne dans la mythologie et l’histoire de France. »
Robert MORRISSEY (né en 1954), titre de son livre publié chez Gallimard (1997)
Le règne de Charlemagne fut long : presque un demi-siècle. Son règne posthume sur l’Occident dura bien plus longtemps encore : un millénaire. Tout le monde peut le revendiquer : les Allemands comme un compatriote, les Italiens comme leur empereur et même l’Église comme un de ses saints. Quant à Napoléon, il se voit ou plutôt se rêve comme son héritier, à une époque où ce genre d’empire est révolu, le peuple ayant goûté à la liberté avec la Révolution !
Révélateur des conflits ou signe de ralliement, le personnage de Charlemagne apparaît dans la multiplicité de ses figures contradictoires : législateur et tyran, chevalier et barbare, père de l’école et empereur illettré, modèle de vertu et père incestueux, roi des nobles et héros du peuple.
Insaisissable et fondamental. Entre mythe et histoire, légende et vérité, c’est un cas type des rapports complexes des Français avec leur passé fondateur. Ce que confirme Daniel-Rops, jusque dans ce détail…
« Charlemagne, le sage empereur « à la barbe fleurie » de la Chanson de Roland, vit dans nos mémoires autant que le terrible soldat à longues moustaches qui fit massacrer dix mille saxons. »
DANIEL-ROPS (1901-1965), Le Peuple de la Bible, tome III
Et Joseph Bédier confirme à son tour dans La Chanson de Roland (1921) : « Sa barbe est blanche, et tout fleuri son chef. »
10. Charlemagne « illettré » : une banale erreur de traduction.
« Passionné pour la science, il eut toujours en vénération et comblait de toutes sortes d’honneurs ceux qui l’enseignaient. »65
ÉGINHARD (vers 770-840), Vie de Charlemagne (écrite dans les années 830)
Lui-même est fort savant, quoique autodidacte, ayant appris la rhétorique, la dialectique, le grec, le latin, l’astronomie, il compose même une grammaire de la langue franque.
Se fondant sur une remarque d’Éginhard, mal traduite (du latin) et mal comprise, certains vulgarisateurs ont prétendu qu’il savait à peine écrire. En réalité, cette remarque signifie que même à un âge avancé, l’empereur s’exerçait à la calligraphie, pour atteindre cette perfection propre aux scribes avec lesquels il ne put cependant rivaliser.
11. Charlemagne n’a pas « inventé l’école », mais on lui doit la « Renaissance carolingienne ».
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ?
C’est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. »6France GALL (1947-2018), paroles de Robert Gall et musique de Georges Liferman (1964)
Chanson écrite sur mesure pour sa voix d’enfant têtue, mais France Gall ne voulait pas la chanter. Son père Robert Gall a bien fait d’insister : troisième au hit-parade en France, elle lance la carrière internationale de la jeune artiste.
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? De nous laisser dans la vie, que les dimanches, les jeudis / De nous laisser dans la vie, que les dimanches, les jeudis / C’est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne / Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d’ennuis / Et nous avons cent griefs contre, contre, contre lui / Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? / Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? C’est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. » Qu’en est-il de la réalité ?
Vers 789, Charlemagne, le roi des Francs, décide effectivement d’ouvrir des écoles dans tout le royaume. Avant, seuls les religieux étaient éduqués. Avec Charlemagne, au Moyen Âge, les enfants des familles riches commencent à s’instruire. En 1816, une loi obligera toutes les communes françaises à ouvrir des écoles primaires. Enfin, Jules Ferry est à l’origine des lois de 1881-82 sur l’école laïque, gratuite et obligatoire, qui fondent le système scolaire tel qu’il existe encore aujourd’hui en France.
De manière plus générale, Charlemagne lui-même très savant, mais autodidacte, mène une véritable politique culturelle, au point que l’on voit en son siècle une « Renaissance carolingienne ».
« La renaissance carolingienne, première période de renouveau culturel majeur au Moyen Âge à l’échelle de l’Occident, est une période d’importants progrès intellectuels, notamment grâce à la redécouverte de la langue latine, à la sauvegarde de nombreux auteurs classiques, et à la promotion des arts libéraux. »
« Renaissance carolingienne », Wikipédia
Cette notion de « renaissance » fut pourtant remise en cause par l’historiographie contemporaine : cela présupposerait un effondrement de la culture entre l’époque romaine et l’époque carolingienne. Tel n’est pas le cas : le Haut Moyen Âge, autrefois qualifié d›« Âge sombre », fut en effet réhabilité.
Autre argument des médiévistes, on devrait parler de « renaissances carolingiennes » au pluriel, cette période comportant plusieurs phases. Il faudrait plutôt parler de « réforme carolingienne ». Philippe Depreux, « Ambitions et limites des réformes culturelles à l’époque carolingienne », Revue historique, 2002.
12. La monarchie n’est pas toujours héréditaire : en France, elle fut d’abord élective et pendant plus de cinq siècles.
« Dans la personne de Hugues Capet s’opère une révolution importante : la monarchie élective devient héréditaire ; en voici la cause immédiate : le sacre usurpa le droit d’élection. »155
François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Analyse raisonnée de l’histoire de France (1845)
Le grand écrivain romantique projetait une Histoire de France qui ne verra jamais le jour, mais il a publié quelques essais et réflexions sur les deux thèmes qui lui tiennent le plus à cœur : la religion et la monarchie.
C’est l’un des apports capitaux du règne d’Hugues Capet : il fonde une nouvelle dynastie et pour en assurer la pérennité, le jour de Noël suivant (25 décembre 987), il s’empresse de faire élire et sacrer par anticipation son fils Robert dit le Pieux, qu’il associe au trône.
13. Comment (y) allez-vous ? : une vraie question au Moyen Âge.
« Au Moyen Âge, on demandait « comment allez-vous ? » à une personne lorsqu’on voulait lui demander… à quoi ressemblaient ses selles (son caca) du jour ! »8
JDE, Journal des enfants, 08/02/2022
Voilà qui est clair ! Et mérite quand même une explication toute simple…
À l’origine, l’expression était « comment allez-vous à la selle ? » Une question bien indiscrète à notre époque. Et pourtant, c’était pratique courante au Moyen Âge et à la Renaissance. La médecine était peu évoluée… sans parler de la diététique inventée par le chimiste Lavoisier à la veille de la Révolution ! Inspecter la consistance, la couleur ou l’odeur des selles était la meilleure manier de veiller sur la santé. Les enfants rois étaient particulièrement surveillés sur ce point.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, demander à quelqu’un comment étaient ses selles était donc une marque d’attention !
14. La peur de l’An Mil : un fantasme… comme le bug de l’an 2000.
« C’était une croyance universelle au Moyen Âge, que le monde devait finir avec l’an mille de l’incarnation […] Cette fin d’un monde si triste était tout ensemble l’espoir et l’effroi du Moyen Âge. »140
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de France, tome III (1837)
Cette croyance en une fin du monde pour l’an mille aurait fortement marqué les esprits de cette époque.
Elle se fonde sur le millénarisme, doctrine selon laquelle le Jugement dernier devait avoir lieu mille ans après la naissance du Christ, d’après une interprétation du chapitre XX de l’Apocalypse de saint Jean (Nouveau Testament). Certes, la foi est grande alors, et les superstitions plus encore. Mais la majorité des contemporains, illettrés, ne sont pas sensibles aux dates.
Il faut ajouter que les auteurs romantiques du XIXe siècle auront contribué à renforcer ce mythe de « la Grande Peur de l’an mille », sur la foi de quelques textes douteux, mal interprétés et parfois postérieurs.
« La millième année après la Passion du Seigneur […] les pluies, les nuées s’apaisèrent, obéissant à la bonté et la miséricorde divines […] Toute la surface de la terre se couvrit d’une aimable verdeur et d’une abondance de fruits. »141
RAOÛL le Glabre (985-avant 1050), Histoires
Ce moine historien décrit ainsi la fin des terreurs du tournant millénariste. Rien ne s’est passé, comme il en a toujours été pour ce genre de superstition – devins et astrologues entretiendront à l’envi d’autres peurs, y compris dans les cours royales.
Raoûl le Glabre qui a craint le pire et contribué à la Grande Peur témoigne en termes poétiques d’un renouveau de civilisation : « Comme approchait la troisième année qui suivit l’an Mil, on vit dans presque toute la terre, mais surtout en Italie et en Gaule, rénover les basiliques des églises ; bien que la plupart, fort bien construites, n’en eussent nul besoin, une émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que celle des autres. C’était comme si le monde lui-même se fut secoué et, dépouillant sa vétusté, ait revêtu de toutes parts une blanche robe d’église. » Georges Duby, grand médiéviste du XXe siècle, appelle cela « le printemps du monde ».
L’an deux mille déclenchera moins de fantasmes, mais leur diffusion se fera à la vitesse d’Internet, l’obsession des dates est une nouvelle religion et une autre raison a pu expliquer cette peur millénariste.
« Le bug de l’an 2000. »3356
Non-événement vedette, à la une des médias depuis des mois - et le jour venu, rien
Dans une société massivement informatisée, on pouvait craindre le pire au 1er janvier 2000 : la pagaille dans le ciel aéronautique et sur le réseau ferré, voire des accidents d’avions et de trains en série. Moins grave, ascenseurs en panne, ordinateurs bloqués, distributeurs de billets refusant de livrer les derniers francs papiers… Même pas.
Alors, on parle de la plus grosse arnaque de ce nouveau millénaire.
En réalité, le bug, ou plutôt des milliards de bugs pouvaient survenir dans les logiciels manipulant des dates et provoquer des dysfonctionnements après le 31 décembre 1999, avec la donnée « année » codée sur deux caractères (les deux derniers chiffres de l’année), pour gagner de la place. Ainsi, le 01/01/00 pouvait nous faire revenir… au 1er janvier 1900 !
Bob Berner, co-inventeur de l’ASCII (American Standard Code for Information Interchange) avait prévenu la communauté internationale dès 1971 ! Cinq ans avant la date fatidique, Internet aidant, les entreprises de génie logiciel se sont mobilisées, à l’échelle mondiale. Coût total des travaux de contrôle et de maintenance préventive estimé à 500 milliards de francs (anciens), pour la France !
Notons au passage que le 1er janvier 2000 ne marque pas le début du troisième millénaire, fêté en France et dans le monde à cette date. Pour que s’achève la 2000e année, il faut attendre le 1er janvier 2001.
15. « Après la panse vient la danse » : contre l’idée d’un sombre Moyen Âge.
« Après la panse vient la danse. »138
Dicton populaire. Dictionnaire de l’Académie française (1694), au mot « panse »
On mange, on boit, on s’amuse bien au Moyen Âge, au château comme au village, hors les temps de famine, de peste, de guerre. Ces mille ans d’Histoire sont aussi riches que l’Antiquité et la Gaule qui précèdent (rappelons la ou les « Renaissances carolingiennes »), et la Renaissance qui suit au « beau XVIe siècle ».
« Aucune société n’est irrémédiable, aucun moyen âge n’est définitif. Si épaisse que soit la nuit, on aperçoit toujours une lumière. »
Victor HUGO (1802-1885), Choses vues (posthume)
L’appellation « Moyen Âge » est un chrononyme (concept introduit par la linguiste suisse Éva Büchi en 1961), une portion de temps à laquelle la communauté sociale attribue une cohérence, ce qui s’accompagne du besoin de la nommer – avec le recul de l’Histoire. Ainsi parle-t ’on de la « Belle Époque », des « Années Folles » et même de l’Entre-deux-guerres.
Le terme de « Moyen Âge » semble négliger l’importance de cette époque historique, la reléguant au rang d’âge moyen, intermédiaire, pris en étau entre l’Antiquité et la Renaissance. D’ailleurs, le terme de « Renaissance », qui évoque la résurrection de l’antique (dans les arts notamment) suppose sa mort pendant le Moyen Âge !
C’est oublier que l’époque médiévale est une période d’intense progrès, décisive dans l’histoire de l’humanité. La division du travail, l’ouverture des routes commerciales, le développement de la scolarisation (notamment dans les monastères), l’explosion des arts, le temps des cathédrales, la chevalerie et ses commandements, l’amour courtois… contrebalancent la vision d’une époque sombre et arriérée.
Laissons le mot de la fin à un historien médiéviste contemporain et bien considéré.
« Le Moyen Âge a été une période essentielle pour la formation de notre société et de notre culture, peut-être même la plus importante. »
Jacques LE GOFF (1924-2014), Le Monde de l’éducation, mai 2000
16. Loi salique née sous Clovis : détournée au Moyen Âge et prétexte à la Guerre de Cent ans contre l’Angleterre.
« Aucune terre ne pourra être dévolue par héritage à une femme ; toute la terre appartiendra aux héritiers de sexe viril. »53
Loi salique. Les Barbares (1997), Louis Halphen
C’est le plus célèbre des articles de cette loi dite aussi « loi des Francs saliens », dont la première rédaction remonte au règne de Clovis (481-511) : code de procédure criminelle et code de la famille, bases de la société franque.
La crise économique et sociale brise l’élan du « beau Moyen Âge ». Une crise dynastique va suivre. Philippe V meurt en 1322, ne laissant que des filles. Son frère Charles IV, troisième et dernier fils de Philippe IV le Bel, accède au trône et meurt à son tour sans descendance mâle, le 1er février 1328. C’est la fin des Capétiens directs.
Quelque peu oubliée, on va exhumer la loi salique (droit civil, secteur du droit privé qui régit les rapports d’un individu à un autre) et appliquer le principe de masculinité : les barons de France choisissent pour roi Philippe VI de Valois, fils du frère de Philippe le Bel, pour écarter celui qui en est le petit-fils par sa mère, Édouard III, roi d’Angleterre. C’est l’origine de la guerre de Cent Ans.
Le royaume se trouve en grand péril. Édouard III d’Angleterre revendique le titre de roi de France (1337) et commence contre Philippe VI de Valois une guerre si longue que les historiens lui donneront plus tard le nom de guerre de Cent ans (1337-1453).
Le roi d’Angleterre et son fils, le Prince Noir, commencent par battre les Français à Crécy.
17. Le vrai bilan du « massacre » de Crécy, assimilé à la fin de la chevalerie : 1 500 chevaliers tués. Malentendus sémantiques et statistiques toujours à suivre.
« Ces bombardes menaient si grand bruit qu’il semblait que Dieu tonnât, avec grand massacre de gens et renversement de chevaux. »283
Jean FROISSART (vers 1337-vers 1400), Chroniques, bataille de Crécy, 26 août 1346
Les canons anglais, même rudimentaires et tirant au jugé, impressionnent les troupes françaises, avec leurs boulets de pierre. L’artillerie anglaise, jointe à la piétaille des archers gallois, décime la cavalerie française réputée la meilleure du monde, mais trop pesamment cuirassée pour lutter contre ces armes nouvelles. À cela s’ajoutent un manque d’organisation total, l’incohérence dans le commandement, la panique dans les rangs…
C’est la fin de la chevalerie en tant qu’ordre militaire. C’est aussi une révolution dans l’art de combattre. Malheureusement, les Français n’ont pas compris la leçon, à cette première défaite.
« Ouvrez, c’est l’infortuné roi de France. »284
PHILIPPE VI de VALOIS (1294-1350), aux gardes du château de la Broye, le soir de la défaite de Crécy, 26 août 1346. Chroniques, Jean Froissart
Le roi demande asile. Après cette bataille mal préparée, mal conduite, mal terminée, il a dû fuir. Tous les chevaliers qui lui étaient restés fidèles sont morts ou en déroute. Il se repose au château jusqu’à minuit, avant de repartir pour Amiens. Quand il apprend l’étendue du désastre, il se retire à l’abbaye de Moncel, pour y méditer plusieurs jours.
Le bilan de Crécy est difficile à faire, les chiffres variant de 1 à 10 selon les sources ! Et Froissart exagère toujours dans ses Chroniques. Il y a vraisemblablement quelque 1 500 chevaliers français tués, dont 11 de haute noblesse. Parmi eux, Louis Ier, comte de Nevers et de Flandre, prend le nom posthume de Louis de Crécy.
On parle toujours du « massacre » de Crécy, synonyme de la fin de la chevalerie. Dix ans après, Poitiers confirmera le désastre. Mais les « grandes batailles » du Moyen Âge ne concernent qu’une minorité d’hommes. Sous Louis XIV, on atteindra les 400 000 soldats… et 4 millions de mobilisés en 1914 (pour un pays seulement deux fois plus peuplé).
18. Le mythe de Jeanne d’Arc : le plus inextricable mélange de vrai et de faux.
« Une enfant de douze ans, une toute jeune fille, confondant la voix du cœur et la voix du ciel, conçoit l’idée étrange, improbable, absurde si l’on veut, d’exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays. »334
Jules MICHELET (1798-1874), Jeanne d’Arc (1853)
Le personnage inspire ses plus belles pages à l’historien du XIXe siècle : « Née sous les murs mêmes de l’église, bercée du son des cloches et nourrie de légendes, elle fut une légende elle-même, rapide et pure, de la naissance à la mort. » Quel autre personnage historique peut-il être qualifié de son vivant de « légende » ? Proposons quand même une clé qui explique presque tout.
« Dieu premier servi. »339
jeanne d’Arc (1412-1431), devise. Jeanne d’Arc : le pouvoir et l’innocence (1988), Pierre Moinot
Ni l’Église, ni le roi, ni la France, ni rien ni personne d’autre ne passe avant Lui, « Messire Dieu », le « roi du Ciel », le « roi des Cieux », obsessionnellement invoqué ou évoqué par Jeanne, aux moments les plus glorieux ou les plus sombres de sa vie. C’est la raison même de sa passion, cette foi forte et fragile, à l’image du personnage. En cela, elle incarne bien le Moyen Âge chrétien, le temps des cathédrales et des croisades. C’est la seule vérité incontournable. Jeanne sera sanctifiée, mais très tardivement : en 1920 !
« [Je n’ai] jamais gardé les moutons et autres bêtes »9
JEANNE D’ARC (1412-1431) à son procès
Elle l’a répété à deux reprises, irritée de cette question.
C’est aujourd’hui une certitude. Jeanne est issue d’une famille de laboureurs aisés – son père a officié dans son village comme « doyen » (équivalent de maire). Elle n’était donc pas bergère, mais elle connaissait la vie de la campagne – comme la plupart des gens en son temps.
Le mythe de la pauvre petite bergère est propagé par les partisans de Charles VII au printemps 1429, pour accroitre la popularité́ de Jeanne. Dans les Évangiles, Jésus se compare à un berger. Qualifier la jeune fille de bergère, c’était souligner la dimension divine de sa mission aux côtés du souverain français.
Certains historiens font d’elle une bâtarde de sang royal, peut-être la fille de la reine Isabeau de Bavière et de son beau-frère Louis d’Orléans, ce qui ferait de Jeanne la demi-sœur de Charles VII. Impossible à prouver.
Autre hypothèse : ce serait un homme, fils illégitime de la reine et de Louis d’Orléans. Donc, le demi-frère du futur Charles VII. D’où les habits d’homme, l’aisance à cheval, ses qualités au combat. On ne le saura jamais…
Reste le personnage providentiel qui va réellement galvaniser les énergies et rendre l’espoir à tout un peuple – et d’abord à son roi.
Si Jeanne d’Arc s’est ensuite imposée parmi les principales figures de l’histoire de France, c’est en partie dû aux nombreux relais littéraires et artistiques, religieux et politiques, qui mirent en avant le personnage au fil des siècles : Wikipédia en recense une douzaine (liste non exhaustive, oubliant sa récupération politique par l’extrême droite comme par la gauche) :
- femme indépendante et forte pour Christine de Pizan, première écrivaine à vivre de sa plume ;
- « Jeanne la bonne lorraine » pour le poète François Villon né vraisemblablement l’année de sa mort ;
- sorcière maléfique pour le très anglais William Shakespeare ;
- héroïne épique pour Jean Chapelain, initiateur de l’Académie française avec Richelieu ;
- personnage burlesque pour Voltaire (qui ne respecte rien ni personne) ;
- guerrière mourant sur le champ de bataille pour Schiller, préromantique allemand ;
- incarnation du peuple français pour Jules Michelet qui en est vraiment amoureux ;
- instrument d’un complot clérical pour Anatole France, maître-penseur de la Troisième République anticléricale ;
- sainte nationale pour l’évêque d’Orléans Félix Dupanloup au XIXe siècle ;
- résistante patriotique pour Bernard Shaw et Sacha Guitry ;
- féministe avant l’heure pour les suffragettes ;
- sainte de l’Église universelle et personnalité de stature internationale pour Guido Görres, historien allemand du XIXe s.
- femme opprimée et victime pour l’auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen, le réalisateur français Luc Besson (film de 1999).
19. Agnès Sorel, première favorite en titre sous Charles VII : la « Dame de beauté » à double sens.
« C’est mon seigneur, il a tout pouvoir sur mes actions, et moi, aucun sur les siennes. »355
Marie d’ANJOU (1404-1463), reine de France. Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’à la mort de Louis XVI (1822), Louis-Pierre Anquetil
La reine, qui donna 13 enfants en vingt-trois ans à Charles VII, lui pardonne en ces termes sa liaison commencée vers 1444 avec Agnès Sorel. Elle préfère cette « rivale soucieuse du bien de l’État à une femme ambitieuse qui aurait dilapidé les biens du royaume » et les historiens reconnaîtront la bonne influence de la Dame de Beauté.
« Vous êtes deux fois ma dame de beauté. »
CHARLES VII (1403-1461) à Agnès Sorel. Cité par Herodote.net, « Agnès Sorel (1422-1450), La Dame de Beauté. »
Ce surnom sied naturellement à la beauté d’Agnès Sorel, saluée par tous les contemporains, immortalisée (entre autres) par le tableau de la Vierge à l’Enfant de Jean Fouquet. Mais il vient surtout du château de Beauté-sur-Marne dont Charles VII lui fit don.
Très patriote, elle influence heureusement la politique du roi. Elle redonne aussi confiance à l’homme. Charles VII n’a pas eu de chance avec ses parents : sa mère Isabeau de Bavière l’a déshérité comme dauphin et traité en bâtard, son père Charles VI est le roi fou (quoiqu’aimé du peuple). Quant à son premier fils, le futur Louis XI, il ne cessera de comploter contre lui, Dauphin en son Dauphiné – dix ans gouverneur de cette province. Fait rare dans l’histoire où ce sont surtout les frères du roi qui jouent contre lui. D’où l’importance du rôle de la Dame.
Fille d’honneur d’Isabelle de Lorraine, duchesse d’Anjou, Agnès a vingt et un ans quand elle rencontre, à Toulouse, Charles VII qui en a quarante. Sa beauté fait de lui un amant subjugué, le transfigurant : de terne, inquiet, défiant, malchanceux, il devint joyeux, hardi, plein d’allant, habile.
Première d’une très longue liste de favorites officielles des rois de France, reconnue officiellement, affichée, comblée de titres et de biens, elle s’identifia si parfaitement au siècle charnière qui fut le sien qu’elle en reflète le double aspect : médiévale par la foi et la gaieté, déjà moderne par le goût du confort et les besoins matériels.
Le Roi chevalier de la Renaissance rendra un juste hommage à la femme.
« Gentille Agnès, plus d’honneur tu mérites,
La cause étant de France recouvrer,
Que ce que peut dedans un cloître ouvrer
Close nonnain, ou bien dévot ermite. »Citation en quatrain du roi François Ier en hommage à Agnès Sorel. Essai critique sur l’histoire de Charles VII, d’Agnès Sorel et de Jeanne d’Arc (2009), Joseph Delort
20. Car tel est notre plaisir : ni frivolité, ni fantaisie dans cette formule royale et récurrente née sous Louis XI.
« Car tel est notre plaisir. »378
LOUIS XI (1423-1483), édit du 31 octobre 1472, forme des placets royaux. Histoire des institutions politiques et administratives de la France (1966), Paul Viollet
Vers 1470, le pouvoir royal ne cesse de s’affermir et pèse de plus en plus lourd sur le clergé, l’Université, l’économie, la justice. Comme l’écrit Georges Duby dans son Histoire de la France : « Tout dépendait du Conseil du roi : diverse, tempérée par ses propres agents, la monarchie tendait vers la centralisation ; elle devint autoritaire sous Louis XI, absolue sous ses successeurs. »
Charles VIII, François Ier, Louis XIV reprendront la formule. Dans les dernières années du règne de Louis XVI, l’expression deviendra « Car tel est notre bon plaisir », adoptée par Napoléon et maintenue jusqu’à la Restauration comprise.
Le mot « plaisir » a souvent été mal compris. Il ne renvoie pas à une forme d’arbitraire royal, ni de caprice du souverain. Il exprime la volonté, la détermination d’un homme d’État.
21. « À cœur vaillant, rien d’impossible » : proverbe né d’une fière devise.
« À cœur vaillant, rien d’impossible. »360
Jacques CŒUR (vers 1395-1456), devise. Le Grand Cœur (2012), Jean-Christophe Rufin
Cette devise illustre à merveille l’esprit d’entreprise sans limite de cet homme d’affaires aux multiples activités (banque, change, mines, métaux précieux, épices, sel, blé, draps, laine, pelleterie, orfèvrerie), banquier de Charles VII et qui finança comme tel la reconquête de la Normandie en 1449.
Maître des monnaies en 1436, argentier du roi en 1440, puis conseiller en 1442, chargé de missions diplomatiques à Rome, Gênes, il aide aussi le roi à rétablir une monnaie saine et à redonner vie au commerce français.
Soupçonné de malversations et crimes vrais ou supposés (et même d’avoir empoisonné Agnès Sorel, la maîtresse du roi, morte le 9 février 1450), il est arrêté en 1451 et condamné par une commission extraordinaire le 29 mai 1453 : confiscation de ses biens et amende de 400 000 écus.
En 1454, il s’évade de prison, se fait innocenter par le Pape Calixte III qui lui confie le commandement d’une flotte pour guerroyer contre les Turcs. Il meurt en croisade à Chio, en 1456.
Son éphémère fortune symbolise la génération des nouveaux riches, issue de la guerre de Cent Ans. Mais cette vie en forme de roman d’aventures, qui a frappé ses contemporains, fait de lui un personnage de la proche Renaissance.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.