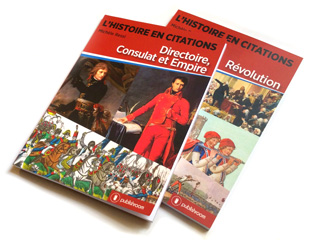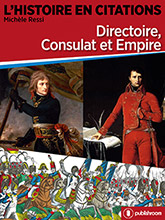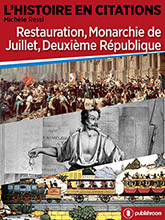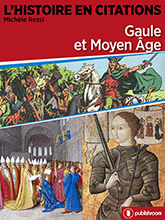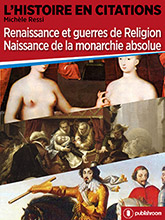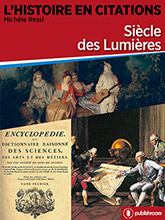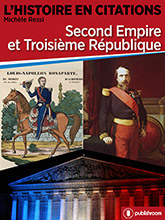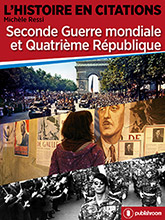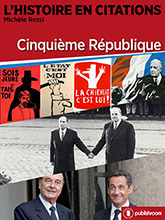Et les enfants, dans l’Histoire ? (sous la monarchie et l’Ancien Régime)
Au début de la monarchie et sous l’Ancien Régime, il y a les enfants du peuple et les petits rois.
On ne pense aux premiers qu’en cas de disette ou de famine, pour déplorer la cruauté de leur sort. Le reste du temps, ils doivent travailler comme leurs parents. Seuls, les petits rois monopolisent l’intérêt des contemporains et des historiens. Mais ils n’ont pas la vie facile !
Exception à la règle, la cour sous Henri IV. Les enfants y sont traités comme tels, le Bon Roi s’en occupe personnellement et les bâtards royaux sont pour la première fois légitimés.
Le petit roi peut être fiancé bien avant ses 10 ans et le mariage (souvent avec une princesse étrangère) n’est pas une question d’amour - la raison d’État s’impose. Majeur à 13 ans, il apprend ce métier depuis la prime enfance. À 5 ans, le Parlement s’adresse à lui comme à un adulte. À 8 ans, terrifié à l’idée de subir le même sort, le petit Louis XIII doit se conduire en roi devant le corps de son père Henri IV assassiné par Ravaillac. La régence s’impose, elle va se passer très mal sous le règne de sa mère Marie de Médicis. Mais peu de régences sont heureuses.
Seul Louis XIV s’en tire bien : roi à 4 ans, déjà impatient de régner, initié par Mazarin et seul roi de l’Histoire vraiment fait pour « ça ». Là est le secret d’une vie réussie, comme dans la plupart des métiers.
Autre souci qui tourne à l’obsession en monarchie héréditaire : la succession. Il faut avoir un fils et ce n’est pas toujours facile. Encore faut-il qu’il survive à une mortalité infantile très élevée (aggravée par la consanguinité dans les familles royales), au danger d’une guerre où il est engagé d’office ou à sa situation d’otage quand il remplace son père prisonnier (les deux fils de François Ier vaincu à Pavie).
Le problème de l’éducation des enfants commence à se poser au XVIIe siècle et l’éducation des filles vaut débat de société. Au siècle des Lumières, un seul philosophe s’en préoccupe : Rousseau. Même s’il abandonne ses cinq enfants naturels aux Enfants-trouvés, son traité sur l’éducation fait école auprès des parents. Mais la petite fille n’est pas traitée à l’égale des garçons.
À partir de la Révolution… tout change, ou presque. Louis XVII (fils de Louis XVI) sera le dernier dauphin martyr de l’Histoire.
Le problème de la succession se posera une fois encore sous l’Empire héréditaire : Napoléon divorce de Joséphine pour devenir enfin père. Mais son Aiglon adoré aura une vie brève et malheureuse.
Le problème de l’éducation est réglé de manière dictatoriale et quasi militaire par l’Empereur. La Troisième République s’y intéressera passionnément, les lois Ferry créant l’éducation nationale, gratuite et obligatoire à la fin du XIXe siècle. La politique de l’éducation fera chuter bien des ministres sous la Cinquième République, preuve que le sujet reste conflictuel !
La natalité devient pour la première fois un problème majeur – la dénatalité étant l’une des causes de la guerre perdue en 1939. Pétain s’empare du problème à sa manière, de Gaulle fait de même et le « règle » étonnamment vite et bien en 1946.
L’enfant et l’enfance conçus en tant que tels concernent de plus en plus d’auteurs et leur réalité infiniment diverse et complexe s’impose dans l’histoire au quotidien.
Seul point commun à toutes les époques, la métaphore de l’enfant et de l’enfance fait symbole et multiplie les allégories poétiques et populaires - surtout en temps de crise, de guerres ou de révolutions. La France est notre mère malade et nous sommes ses enfants depuis la Renaissance. De même face au Père, le roi dont le peuple attend tout et d’abord le pain nourricier.
Le mythe de Saturne dévorant ses enfants ressuscite sous la Révolution et reparaît pour fustiger le travail au nom du socialisme utopique né au XIXe siècle. Aujourd’hui encore, nous restons les « enfants de la patrie » avec la Marseillaise, hymne national toujours d’actualité.
Premier épisode : sous la monarchie et l’Ancien Régime.